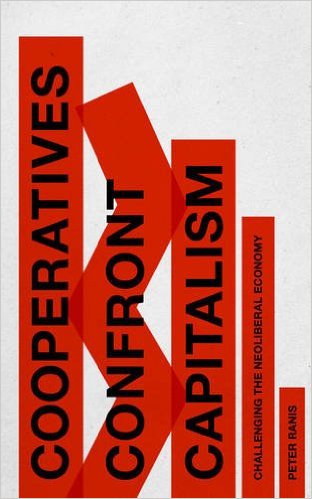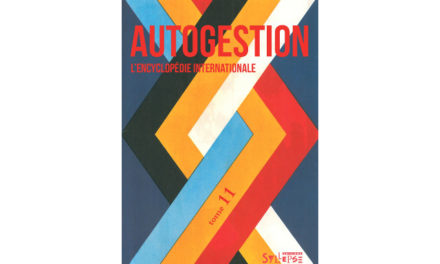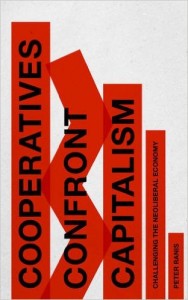 Ce livre de Peter Ranis, professeur émérite en sciences politiques au Graduate Center of the City University of New-York, écrit en anglais et paru aux Éditions Zed books, a un titre extrêmement proche du livre que j’ai rédigé, « Coopératives contre capitalisme » paru aux Éditions Syllepse. Ces deux livres interrogent le potentiel transformateur des coopératives de travail – que nous appelons Scop en France – partant chacun d’expériences diverses se déroulant, pour le livre de Peter, dans les Amériques et pour moi, en Europe. Si le phénomène des entreprises récupérées argentines nous est familier en Europe, le témoignage qu’il apporte sur le développement récent des coopératives de travail aux États-Unis et à Cuba vaut largement la lecture du livre en tant que tel. Si on assiste à quelques expériences de récupérations d’entreprises aux États-Unis (par exemple New Era Windows à Chicago), la majeure partie de ces initiatives sont des créations ex nihilo qui ont été initiées par des travailleurs licenciés et souvent soutenues par les collectivité locales au titre de la revitalisation industrielle. À Cuba, le fait coopératif est désormais directement soutenu par le parti communiste au pouvoir qui, dans le contexte de la normalisation avec les États-Unis et l’afflux prévisible des capitaux étrangers, y voit une alternative qui sera mieux capable de résister au capitalisme que le socialisme d’État aujourd’hui dominant.
Ce livre de Peter Ranis, professeur émérite en sciences politiques au Graduate Center of the City University of New-York, écrit en anglais et paru aux Éditions Zed books, a un titre extrêmement proche du livre que j’ai rédigé, « Coopératives contre capitalisme » paru aux Éditions Syllepse. Ces deux livres interrogent le potentiel transformateur des coopératives de travail – que nous appelons Scop en France – partant chacun d’expériences diverses se déroulant, pour le livre de Peter, dans les Amériques et pour moi, en Europe. Si le phénomène des entreprises récupérées argentines nous est familier en Europe, le témoignage qu’il apporte sur le développement récent des coopératives de travail aux États-Unis et à Cuba vaut largement la lecture du livre en tant que tel. Si on assiste à quelques expériences de récupérations d’entreprises aux États-Unis (par exemple New Era Windows à Chicago), la majeure partie de ces initiatives sont des créations ex nihilo qui ont été initiées par des travailleurs licenciés et souvent soutenues par les collectivité locales au titre de la revitalisation industrielle. À Cuba, le fait coopératif est désormais directement soutenu par le parti communiste au pouvoir qui, dans le contexte de la normalisation avec les États-Unis et l’afflux prévisible des capitaux étrangers, y voit une alternative qui sera mieux capable de résister au capitalisme que le socialisme d’État aujourd’hui dominant.
La proposition politique centrale de l’auteur est la mise en œuvre de l’expropriation (eminent domain). Face à des groupes multinationaux qui ferment des unités de production, laissant derrière eux chômage et désespérance sociale, Peter Ranis défend l’expropriation à l’initiative de l’État fédéral, des États et même des collectivités locales. Exemples réels à l’appui, il démontre que l’expropriation est totalement constitutionnelle et se justifie au nom du bien commun. Le cinquième amendement de la constitution étasunienne confirme cet aspect lorsqu’il stipule que ce droit constitutionnel – parmi d’autres – ne doit s’appliquer que s’il y a « juste compensation » (just compensation) pour l’exproprié. Lorsqu’un groupe ferme une unité de production, le politique est alors totalement fondé à préempter l’usine afin d’y maintenir les emplois. N’était-ce d’ailleurs pas l’objectif de la loi Florange qu’avait formulée le candidat Hollande ? Celle-ci prévoyait que si un groupe ferme une unité de production, celui-ci doit alors rechercher un repreneur et s’il y en a un, doit la céder. Cette promesse n’a jamais été tenue ou tout au moins dans une version tellement édulcorée qu’elle en est inexistante : c’est l’absence de cette loi qui explique que le groupe UPM ait pu fermer la papeterie de Docelles en interdisant à ses 160 salariés de reprendre une activité pourtant non concurrente. Certains expliquent que cette promesse aurait été retoquée par le Conseil constitutionnel car non conforme au droit de propriété. Si tel est le cas, cela nous pose l’urgence de revoir notre constitution et d’y intégrer cette dimension : pourquoi, ce qui est possible dans la constitution du premier pays capitaliste du monde, ne le serait-elle pas chez nous ?
La question de la compensation financière est un débat en soi. Dans les discours les plus radicaux, on fait valoir que l’expropriation doit se faire sans indemnité ni rachat, sachant que la valeur comptable de l’entreprise a essentiellement été réalisée par les profits accumulés et que ceux-ci sont le produit de l’exploitation des travailleurs. Très souvent, les apports nets des actionnaires – apports en capital diminués des dividendes – sont même négatifs. Cette position est donc totalement fondée mais c’est sans doute le rapport de force qui fera valoir ce point de vue : il faudrait que les salariés désobéissent à la direction de l’entreprise et reprennent le contrôle de celle-ci pour que la propriété privée soit remise en cause sans avoir versé quoi que ce soit. C’est tout simplement le scénario du grand soir… Aura-t-il lieu un jour ?
Il y a une autre façon, plus pragmatique, d’aborder cette question. C’est celle de cette promesse mort-née de loi Florange que nous venons d’évoquer qui veut que la compensation soit égale au prix que quelqu’un est prêt à payer en sachant que s’il n’y a qu’un seul repreneur, celui-ci dictera son prix, l’entreprise devant obligatoirement la céder. Donc, si un seul collectif de travailleurs veut reprendre l’unité de production, il y a fort à parier que le prix ne sera pas important. Les travailleurs de Docelles proposaient 3 millions d’euros à la multinationale UPM pour la papeterie dans un contexte d’absence de loi Florange. En terme de coût d’achat, celle-ci valait bien sûr plus mais sa valeur actuelle est toujours le prix que quelqu’un est prêt à payer. C’est une problématique qui a aussi été abordée dans « Coopératives contre capitalisme » : la valeur d’une société de capitaux est égale à la somme de la valeur actualisée de ses dividendes futurs correspondant à une opinion moyenne du marché. Si l’entreprise ne se voit pas capable de dégager des flux de trésorerie d’une unité de production, il préfère alors la fermer et ce, même si celle-ci est utile pour la société. Quelle est sa valeur ? Pas grand-chose, en tout cas certainement pas sa valeur comptable. Il est donc juste d’exproprier en cas de fermeture d’unité de production pour permettre aux travailleurs de conserver leur travail ou de réindustrialiser la zone économique. S’il doit y avoir une indemnisation, puisque prévue par la constitution américaine, celle-ci ne peut pas être importante.
Nos deux livres partent a priori de deux approches différentes. Dans le mien, la reprise en coopérative est vue comme un processus d’aboutissement de la lutte de classes : la hausse de la part des salaires dans la valeur ajoutée détruit la valorisation des sociétés de capitaux et c’est la transformation de celles-ci en unités autogérées par les travailleurs qui conclura cette lutte. Dans celui de Peter, c’est le capitalisme qui agresse les travailleurs et les communautés locales en fermant des unités de production, souvent pour délocaliser, pour rechercher une force de travail moins chère. Mais dans les deux cas, la transformation coopérative est le résultat d’une situation dans laquelle le capital ne peut plus exploiter comme avant.
Je terminerai par une réflexion générale sur les multinationales qui sont clairement abordées dans le livre de Peter. On reproche souvent à la reprise en coopérative d’être cantonnée à des petites unités de production et jamais à des multinationales. La perspective que brosse Peter Ranis est celle du maintien d’activités que les multinationales ne veulent plus réaliser. L’organisation de ces activités est alors confiée au collectif de travailleurs et souvent suscitée par les collectivités locales. Est-ce que cela ne préfigure pas une nouvelle société dans laquelle les besoins humains seraient à l’origine de l’activité économique ? Dans un tel cas, l’organisation des unités de production entre elles sera forcément différente – déterminée par des besoins sociaux – de celle des multinationales dont l’objectif est de conquérir des parts de marché. La socialisation d’une multinationale a-t-elle encore un sens ? Ne devrions-nous pas nous interroger sur leur démantèlement ?
Avec une approche très différente de la mienne, le livre de Peter Ranis confirme que les coopératives de travail constituent un horizon politique pour la classe salariée, une nouvelle forme d’expression de cette classe dans le contexte d’un capitalisme qui laisse des pans entiers de la population dans le chômage et la misère. En filigrane, la possibilité d’une autre économie basée sur la décision politique. Un livre qui mériterait sans doute d’être traduit et publié en français…
Cooperatives confront capitalism,
Challenging the neoliberal economy,
Peter Ranis,
Zed Books, London – zedbooks.net
Politics / Economics
ISBN 978-1-78360-649-8
171 pages