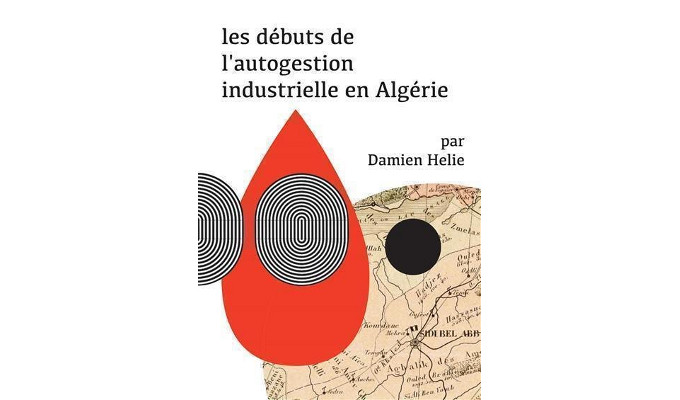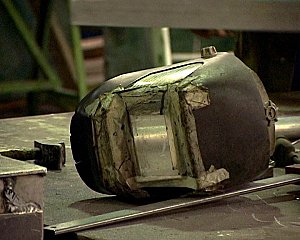Damien Hélie, L’autogestion industrielle en Algérie. Introduction de : Marieme Helie Lucas. Coédition entre Pecos&Robin-Publications et les Editions de l’Asymétrie, Paris. A paraître. Date de sortie en librairie : 22 novembre.
Ce texte de Damien Hélie demeure l’unique étude in vivo de l’autogestion industrielle, telle qu’elle a été pratiquée dans l’immédiate post indépendance. Il est peu probable qu’on se souvienne aujourd’hui des circonstances dans lesquelles l’autogestion a été mise en œuvre en Algérie, d’autant plus qu’on l’a ensuite interprêtée comme un choix politique conscient et planifié. C’est ce que je voudrais rappeler ici.
Pendant les dernières années de la guerre d‘indépendance, certes il se trouvait, parmi les réfugiés algériens au Maroc, quelques individus qui s’intéressaient à l’autogestion ; mais c’était loin d’être un choix officiel pour l’après-libération.
Ce que les jeunes générations ne peuvent réaliser aujourd’hui, c’est l’état dans lequel la colonisation avait laissé l’Algérie : nous n’avions pas de cadres supérieurs et pratiquement pas de cadres moyens.
Pour en donner un exemple graphique, nous avions seulement quatre (oui : 4 !) ingénieurs de très haut niveau, exactement autant de sociologues, etc… Parmi les rares Algériens à avoir une formation supérieure universitaire, la plupart étaient avocats ou médecins, la colonisation ayant toléré l’accès à ces professions pour servir les besoins spécifiques des ‘indigènes’.
De même, il n’existait pratiquement pas d’industries et nous avons dû les créer de toutes pièces dans les années qui suivirent la libération.
Les industries alimentaires des pâtes et couscous et de l’huile d’olive existaient depuis longtemps, aux mains de propriétaires privés, mais pour le reste, la France avait refusé l’industrialisation de l’Algérie. En effet, laisser industrialiser l’Algérie aurait permis aux colons ‘européens’ d’être autosuffisants et de se séparer d’avec la ‘métropole’, sur le modèle sud africain. La deuxième guerre mondiale avait mis en lumière le fait que l’Algérie, privée de contacts avec sa base française, ne disposait plus des produits manufacturés les plus basiques, tous importés : il n’y avait, par exemple ni tissu ni vêtements ni chaussures, car l’Algérie ne possédait ni filature ni tissage ni bonneterie ni industries des peaux, etc. Les colons européens voulurent donc dès la fin de la deuxième guerre mondiale s’autonomiser – économiquement mais aussi politiquement – par rapport à la France en créant des industries locales ; mais la métropole s’y opposa le plus possible.
A l’indépendance donc, les entreprises agricoles et les très rares entreprises industrielles existantes se trouvèrent soudainement, avec le départ massif des européens, sans direction, sans cadres supérieurs et même sans cadres intermédiaires, tous ces postes se trouvant précédemment occupés par des européens.
Certes le nouveau gouvernement de l’Algérie indépendante se mit rapidement et à industrialiser et à former des cadres moyens et supérieurs pour ses entreprises nouvelles et existantes, mais le processus prit plusieurs années, bien entendu, avant que les nouveaux ouvriers spécialisés, contremaîtres et ingénieurs soient opérationnels.
En attendant il fallait faire marcher ce qui existait, ne serait ce que les fermes abandonnées par le départ des européens. Ce qui se passa alors ne relève pas d’une décision politique au sommet, ni du choix de l’ « autogestion » comme mode de développement socialiste ; les gens se retroussèrent tout simplement les manches et se mirent au travail pour ne pas mourir de faim. Et aussi parce qu’ils étaient enfin ‘chez eux’ et les ‘patrons’ de l’Algérie indépendante. Responsables.
Dans les entreprises agricoles, tous les travailleurs qui possédaient quelque savoir durent immédiatement faire face aux récoltes et à la commercialisation de l’été 62, mais aussi aux commandes de semences et aux plantations de l’automne. C’était tout simplement une question de survie pour la population. C’était donc une pratique de l’autogestion comme stratégie de survie, et non pas l’application d’une directive politique, qui fut mise en œuvre. Les quelques travailleurs agricoles qui n’étaient pas illettrés vinrent automatiquement aux postes de direction, fût-elle collégiale, de ce qui s’appela ensuite des entreprises autogérées. Il en fut de même pour nos rares industries.
Pour parler de la capitale où je vivais, tout ce qu’Alger comptait d’écoliers, collégiens ou étudiants se rendit rapidement compte de l’impérieux besoin et devoir d’aller aider les travailleurs illettrés pour passer les commandes de semences ou de fournitures, tenir les comptes, bref tout ce qui exigeait d’être alphabétisé et avec quelques connaissances. L’émigration sporadique des ‘lettrés’ en fin de semaine ou lors des dates buttoir saisonnières en agriculture se mit en place spontanément dès l’été 62 – bien avant que cette aide ne soit organisée à partir du haut sous Ben Bella, avec des bus transportant gratuitement les week-ends les collégiens et lycéens vers les fermes autogérées du Sahel et de la Mitidja, et que le gouvernement organise leur hébergement sur place.
En ce qui concerne l’industrie, je veux rappeler la pénurie de biens de toutes sortes dans les mois qui suivirent l’indépendance. Un autre exemple graphique : on pouvait voir dans les ‘monoprix’ quasi désaffectés, de longues étendues de plusieurs mètres de rayonnages entièrement vides avec un seul paquet de lessive campant seul au milieu, par exemple. J’avais déjà vu ce genre de spectacle, avant l’indépendance, en Union Soviétique dans des périodes particulièrement dures de leur histoire.
Avant donc de créer des entreprises agricoles ou industrielles, l’indépendance nous mit devant un énorme challenge : faire fonctionner ce qui existait encore, et ce malgré l’absence de cadres formés. C’est ça l’autogestion, avant, bien avant les décrets présidentiels, dits décrets de mars, qui vinrent fournir un cadre légal à la pratique autogérée.
Toutefois, ces décrets ne donnèrent pas seulement un statut légal à l’autogestion : ils vinrent aussi l’encadrer et la contrôler. Là où les travailleurs avaient été seuls maîtres à bord dans les premiers mois après l’indépendance, un ‘directeur’, nommé par l’administration et non pas élu par les travailleurs comme l’étaient les conseils d’entreprise, eut la haute main sur toutes les décisions des entreprises qui n’eurent plus guère d’autogérées que le nom et ne firent rapidement plus que réaliser les programmes de production décidés en haut lieu.
Il existe des affiches que le gouvernement distribua aux conseils des travailleurs dans les entreprises autogérées pour mieux leur expliquer le fonctionnement mis en place par les décrets : on y voit clairement une pyramide avec à la base les travailleurs agricoles, qui sont plus haut représentés par leur conseil élu par eux, au sommet duquel se tient le président de ce conseil des travailleurs. Le pouvoir décisionnaire remonte bien de la base vers le sommet. Tous sont d’ailleurs conformes à l’image d’Epinal des travailleurs agricoles : sarouel court sur les mollets, turbans, assis par terre en tailleur.
Oui mais voilà qu’entre par le côté de l’affiche et vers son sommet, en tout cas au même niveau que le président du conseil des travailleurs, un homme déguisé tout à fait autrement : il est en costume trois pièces et tient un attaché case à la main ; il a une démarche dynamique par rapport à la station assise des travailleurs : il vient transmettre au président du conseil des travailleurs autogérés les consignes de l’Etat. Et il a le dernier mot sur les décisions, comme le dit l’affiche. J’ignore qui fut le graphiste qui commit ces affiches, et comment ses commanditaires ne se rendirent-ils pas compte de ce qu’elles dévoilaient, mais en tout état de cause, elles reflétaient très exactement la nature du rapport de force entre travailleurs autogérés et administration.
Mais entre 62 et 64-65, la réalité ne se dévoilait qu’à peu de gens et les autres continuaient à se bercer d’illusions et de mythes. L’un de ceux qui virent clairement ce qui se mettait en place fut Damien Hélie. Il le vécut dans une très grande solitude morale et politique, intellectuelle aussi, puisque la plupart d’entre nous persistions dans le déni de réalité.
En effet, ce sur quoi je veux insister ici, c’est sur l’énorme enthousiasme populaire soulevé par les débuts de l’autogestion. Il est surement impossible d’imaginer aujourd’hui comment nous travaillions quatorze ou seize heures par jour, pendant plusieurs mois sans être payés (car l’administration algérienne se mettait tout juste en place), partageant avec d’autres amis nos salaires quand l’un ou l’autre d’entre nous en touchait un. Je mis un an complet avant de toucher mon premier (maigre) salaire, puis encore quelques mois avant qu’il me soit payé normalement et régulièrement.
Il n’y avait pas de limites au dévouement de chacun, à sa dévotion à la patrie ; et ça commençait par donner de son travail sans compter. Chacun se sentait le véritable propriétaire des entreprises, responsable de leurs réussites ou de leurs échecs.
Je me souviens d’être allée en février 64 assister à la signature avec l’Union Soviétique des accords qui allaient aboutir à la création du Centre des Hydrocarbures et du Textile à Boumerdés ; c’était seulement trois semaines après un très mauvais accouchement par césarienne pour la naissance de ma fille Anissa , mais il ne me serait même pas venu à l’idée de ne pas assister à cette signature qui allait enfin nous donner l’autonomie de former nos propres cadres pétroliers, condition indispensable de l’algérianisation des entreprises pétrolières. C’était un moment historique. En effet, nous avions, dès l’indépendance, vainement plaidé notre cause auprès de l’Institut Français du Pétrole pour qu’il accepte une première promotion d’algériens, mais l’IFP faisait trainer sa réponse depuis plusieurs mois sous divers prétextes – et en fait ne s’intéressa et ne répondit enfin favorablement à notre requète de formation de cadres moyens et supérieurs du pétrole que quand la France fut mise devant le fait accompli : nous pouvions nous débrouiller sans elle, grace à l’union soviétique.
Le volontariat était une chose naturelle, qui allait de soi : s’il y avait besoin de faire quelque chose quelque part, et qu’on en était capable, on y allait, c’est tout ! Et c’était évident pour chacun. Faire bien son travail était, en soi, une tâche révolutionnaire. Faire plus que son travail aussi.
Dire que ce fut une période exaltante est un trop faible mot pour ce que nous avons vécu. Nos rêves étaient entre nos mains et le ciel était la limite… Ma génération a la chance d’avoir vécu ce bref moment de notre histoire. Et de s’en souvenir, pour dire que c’est encore possible, chaque fois que les travailleurs ne se voient pas dépossédés des fruits de leur travail, qu’ils ne sont pas écartés des décisions qui les concernent.
Période de courte durée – à peine quelques années donc -, et dont le désenchantement commença avec l’application des décrets de mars sur l’autogestion et se poursuivit sans faille jusqu’au désengagement des travailleurs par rapport à leurs entreprises – puisque précisément elles avaient cessé d’être leurs.
C’est cette période encore incroyablement féconde, exaltante, mais déjà attristante et amère que capture la recherche de Damien Hélie.
Il disait souvent en plaisantant qu’il mettrait en exergue de son travail la phrase qu’un ouvrier lui avait dite pour décrire la situation des travailleurs par rapport aux administrations et aux bureaucrates qui les encadraient : ‘Celui qui se les roule, il les touche !’ Entendez par là : celui qui se roule les pouces, c’est à dire ne fait rien, ne travaille pas – il les touche : c’est lui qui touche les billets, l’argent, le fric…
Un raccourci saisissant pour exprimer avec force le désenchantement de ceux qui avaient fait l’autogestion et s’en voyaient évincés.
Certes l’université n’est pas le lieu le plus propice à ce genre de déclaration incendiaire, mais rien ne saurait à mes yeux mieux résumer ce qu’il advint de la superbe initiative populaire – l’autogestion de fait – qui permit à l’Algérie de survivre et aux Algériens de manger, de se vêtir, d’aller à l’école – avant que l’Etat ne lui coupe les ailes.
Je me souviens d’un voyage dans l’Ouarsenis profonde pendant l’hiver 62-63 où nous trouvâmes près d’une mechta des hommes engagés dans la construction d’une route empierrée, destinée à desservir une petite construction nouvelle au sommet d’une colline : leur future école. Ils l’avaient fait de leurs mains, sans demander aucune aide de l’Etat (qui n’aurait d’ailleurs pu en fournir à cette époque), ne comptant que sur leurs propres ressources et sur la force de leurs bras. Elle comportait deux pièces, l’une pour la classe, l’autre pour le logement du maitre ; pas d’eau et pas d’électricité, cela va sans dire, mais, nous dirent les paysans, cela viendrait avec l’électrification de leur commune. Quand tout fut achevé, ils firent écrire au ministre de l’éducation à Alger : ‘Cher frère ministre (comme on disait à l’époque …), nous avons fini l’école et le logement du maître, et la route pour y aller ; envoie-nous l’instituteur s’il te plait’. (J’ai vu copie de la lettre).
Etonnamment, ils reçurent une réponse au bout de quelques mois, et la visite de deux inspecteurs du ministère ; ceux-ci firent un rapport et la décision ministérielle parvint un an après aux ‘Chers frères de la commune de …’ : les dimensions des locaux « n’étaient pas conformes aux normes » prévues pour les salles de classe et le logement du maître. (J’ai également vu la réponse de mes yeux en retournant sur les lieux).
Petite histoire sur l’art de tuer l’esprit autogestionnaire chez les citoyens.
Et voici une précision qui m’est chère : pour ces paysans illettrés, musulmans pratiquants comme on l’est de père en fils dans la campagne, l’école c’était pour les filles aussi ! Il n’était pas question de n’y envoyer que les garçons : c’était la nation tout entière qui devait être éduquée, dans leur esprit. A cette époque de l’indépendance, les paysans illettrés donnaient spontanément des leçons d’égalité entre citoyens et citoyennes. L’Islam de leurs pères ne leur était pas un obstacle.
Autre petite histoire significative de la dépossession des travailleurs : dans une ferme ‘autogérée’ à une dizaine de kilomètres de chez moi près d’Alger, qui produisait régulièrement des légumes, le directeur annonça un jour la décision prise en haut lieu qu’on allait désormais faire des fruitiers. Pourquoi pas ? Après tout la région y est propice. Le problème c’est que les bureaucrates s’inquiétèrent au bout de deux ou trois ans que les ‘mauvais ouvriers’ n’avaient pas encore récolté de fruits – ignorant qu’il en faut parfois 6 ou 7 à un arbre pour être productif.
Après nombre de remontrances tendant à prouver que l’improductivité de leurs arbres était de leur fait – une façon comme un autre d’attaquer le principe même de l’autogestion : il ne faut pas laisser d’ignorants illettrés décider de l’avenir d’une ferme sur laquelle ils travaillent depuis 20 à 30 ans – , les ouvriers virent un jour débarquer sans préavis, je dis bien sans aucun préavis, des camions avec des vaches : puisqu’ils étaient si mauvais cultivateurs, ils allaient devenir éleveurs : là au moins il n’y avait rien d’autre à faire qu’à laisser paître… Hélas il n’y avait pas de grasses prairies pour nourrir les vaches. Elles maigrirent. Lassés, les coopérateurs en mangèrent une… pourtant propriété de l’Etat… c’était du vol.
Damien Hélie a vécu d’innombrables histoires de ce genre dans les entreprises de l’industrie autogérée. Ecrire les résultats de sa recherche fut un calvaire pour lui. Ses espoirs pour l’Algérie indépendante s’écroulaient sous ses yeux. Il avait pourtant payé le prix pour voir cette indépendance.
Il était arrivé en Algérie à dix ans, alors que son père, juriste proche de syndicats ouvriers à Paris, avait été appelé à créer l’organisme de sécurité sociale en Algérie (la Casicra si mes souvenirs sont bons). Sa mère, nommée institutrice à Draria dans la banlieue d’Alger (alors un village isolé), puis dans la basse Casbah, portait un regard horrifié sur les inégalités dont étaient victimes les Algériens sous la colonisation. C’est à travers sa sœur, de six ans plus âgée que lui, qu’il rencontra les quelques étudiants algériens de l’époque. Dont Rachid Amara avec qui il passa la dernière nuit à la cité universitaire de Ben Aknoun avant sa montée au maquis.
C’est assez naturellement que la famille Hélie se mit au service de la lutte de libération, cachant et hébergeant des militants, ce pour quoi ils furent une nuit de 1957 tous conduits à la villa Césini par les paras de Massu. Georges Hélie, le père de Damien, sortit sourd de ses tortures. Il fut ensuite mis en camp, puis finalement à la prison Barberousse (Serkaji aujourd’hui) en haut de la Casbah.
Je ne raconterai pas ici l’expérience de Damien, âgé de 16 ans, à la villa Césini. Je veux juste rappeler que quelques mois plus tard, il m’informa le plus naturellement du monde que si, suite à ses activités, son sursis universitaire était résilié, s’il recevait donc son appel à ‘servir sous les drapeaux’ de la France, il monterait immédiatement au maquis rejoindre le FLN. Son engagement à la cause nationale était total. Nous avions juste 17 ans.
A cet âge, il était remarquablement politisé et avait déjà beaucoup lu. Atteint d’un rhumatisme articulaire aigu à 15 ans, il dut suivre des cours par correspondance et rester toute une année à la maison. Y était alors caché sous le nom de Fréderic, un jeune homme qui lui aussi avait beaucoup lu et beaucoup réfléchi, Sadek Hadjeres. Ils passèrent presque un an et demi de conversations quotidiennes et de lectures partagées (Certains de ces livres marqués au nom de ‘Fréderic’ sont toujours sur nos étagères). Une formation politique accélérée pour Damien…
Ce n’est donc pas un ‘étranger’ qui suivit l’invention de l’autogestion industrielle et qui en rendit compte dans sa thèse, ainsi que de son déclin et de sa chute. C’est quelqu’un qui tenait viscéralement, comme nous tous, au succès de cette entreprise ; et quelqu’un qui fut conscient et souffrit beaucoup, avant la plupart d’entre nous, d’identifier quels obstacles internes l’Algérie indépendante aurait à affronter.
Je vois (mais je ne parle pas ici pour lui), dans cette étude de l’autogestion industrielle par Damien Hélie, l’émergence et la formation de ce que Djilas appela en Yougoslavie la ‘nouvelle classe’ de ceux qui, bien que ne possédant pas initialement les moyens de production, les font fonctionner – un temps – à leur profit pour se reproduire en tant que classe, avant de passer au capitalisme.
Pourquoi avoir tant attendu pour publier, tant d’années après sa rédaction, ce document – seule étude de première main, faite sur place pendant cette période historique ? La mort conjointe de Damien, agé de 27 ans, et de notre fils ainé, agé de 7 ans m’avait pétrifiée. Georges Hélie m’avait poutant proposé de se charger de la faire imprimer, ce que je déclinais alors.
La sidération a duré longtemps. Je n’ai pourtant cessé de regretter ma décision, car je suis absolument sûre que Damien, en bon militant, aurait voulu cette publication, comme outil de formation et de mobilisation.
Les jeunes algériens manquent cruellement de connaitre leur histoire. Et celle, récente, de notre pays montre que des forces jeunes, des forces tournées vers la justice sociale et la liberté, demandent à être enracinées dans les luttes qui les ont précédées, que faute de connaitre cette histoire-là, parfois, elles se fourvoient.
Pour en savoir plus :
https://pecosrobin.wordpress.com/livres-books/
https://editionsasymetrie.org/ouvrage/les-debuts-de-lautogestion-industrielle-en-algerie/
Article original : http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article46887