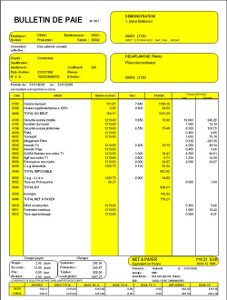Le 9 octobre dernier, nous avons publié sous l’intitulé « Autogestion? oui mais » ou « L’autogestion justement! » un texte de Samy Johsua auquel répondait un texte de quatre membres de l’association pour l’autogestion, Gilbert Dalgalian, Claude Kowal, Catherine Samary, Patrick Silberstein. Cette réponse a suscité un rebond. Ci-après nouvel et dernier épisode, qui ne clôt certes pas le débat, mais cette première saison.
Le 9 octobre dernier, nous avons publié sous l’intitulé « Autogestion? oui mais » ou « L’autogestion justement! » un texte de Samy Johsua auquel répondait un texte de quatre membres de l’association pour l’autogestion, Gilbert Dalgalian, Claude Kowal, Catherine Samary, Patrick Silberstein. Cette réponse a suscité un rebond. Ci-après nouvel et dernier épisode, qui ne clôt certes pas le débat, mais cette première saison.
Dans leur réponse à ma contribution, Gilbert Dalgalian, Claude Kowal, Catherine Samary, Patrick Silberstein (DKSS par la suite) soulèvent un réel problème de périmètre de la question de l’autogestion. L’extension qu’ils en donnent, suite d’ailleurs à un travail d’élaboration important et salutaire qu’ils mènent avec d’autres depuis de nombreuses années, conduit à ce que souvent dominent les points d’accord avec ce que je soulevais moi-même. Tant mieux, on ne va pas inventer des désaccords quand il n’y en a pas, une fois les clarifications faites.
Prenons alors la question un peu autrement. Défini comme ils le font le concept d’autogestion enfle jusqu’à devenir équivalent à celui de démocratie, du moins me semble t-il. Pourquoi alors ne pas prendre ce dernier ? On peut, à juste titre, objecter à cela le fait patent qu’il s’agit certes là d’une question vitale, mais d’un concept mou : on ne trouve guère de gens qui seraient contre la démocratie ! Alors que (c’est ce qui fait aussi sa force) on en trouve pas mal qui soient contre l’autogestion, laquelle conserve ainsi sa puissance à la fois contestatrice et alternative. J’admets ceci sans difficulté. Et pourtant je voudrais discuter plus avant.
Pour cela mettons en regard une situation où, comme dans la Russie de 1917, le prolétariat est fortement minoritaire, où la question de sa « dictature » s’enracine par sa place dans le processus de production, et où le reste s’envisage (au mieux) par le canal d’une alliance de classe. Et la situation d’aujourd’hui en France où le prolétariat au sens large étant très fortement majoritaire, la question de sa « dictature » se confond pour ainsi dire avec celui de son pouvoir démocratique, et où la question stratégique principale devient « interne », celle de son unification par delà ses divisions de tout type. Dans le deuxième cas, sans disparaître évidemment, la question de l’ancrage dans la production au sens restreint diminue en intensité. Et de même, me semble t-il – mais je comprends que ça se discute – celle, originelle, de l’autogestion (comme à Lip par exemple). Les questions issues du « on produit, on vend, on se paye » ou des coopératives peuvent-elles à ce point servir de modèle gmobal pour « la question démocratique » en général ? C’est, plus qu’implicitement, ce que tentent DKSS, et avec profit souvent je le reconnais volontiers (surtout, qu’à juste titre là encore, ils indiquent bien que personne ne dispose de la totalité des solutions a priori). Mais est-ce qu’il ne faudrait pas pourtant enregistrer la modification qualitative que je souligne, au lieu d’étendre sans fin le concept autogestionnaire ?
Une question moins importante maintenant, en tout cas plus limitée, celle de l’école. DKSS disent : « comment ne pas se pencher sur les motivations des élèves, la diversité extrême des profils d’apprenants, l’expression de leurs motivations par les élèves eux-mêmes, bref sur la véritable question démocratique : celle d’un « nouveau statut de l’élève », seule éducation civique au quotidien ? » La question pédagogique est bien entendu une question politique. Selon que la pédagogie est plus collaborative ou plus concurrentielle, ce n’est pas la même éducation au final.
Mais ce n’est pas la seule question, encore moins « la véritable question démocratique ». Une société effectue trois choix pour son école. A qui on enseigne est le premier (par exemple existe-t-il une école commune et jusqu’à quel âge, existe-t-il des programmes communs aux filles et aux garçons) ?
Qu’enseigne t-on est la deuxième question. Si l’on veut bien se défaire de l’habitude qui conduit à considérer que ce choix va à peu près de soi on constate déjà qu’il est très variable selon les pays et les époques. Surtout, même en éliminant par hypothèse le poids du capitalisme et de l’adaptation à ses besoins (ce que nous faisons ici les uns et les autres en discutant d’une société autogérée), il s’agit de la conséquence d’une élimination drastique dans la masse des savoirs. Beaucoup (dont mes amis DKSS) pensent y répondre par « la polyvalence des contenus ». En dehors de l’entrée dans les pratiques écrites où celle-ci est attestée (se distinguant d’autres formes de transmission dans les sociétés de tradition orale), cette « polyvalence » est postulée, mais introuvable, sauf par extension purement locale. Plus ou moins de valences, oui. Polyvalence non. A une exception majeure donc. Ce n’est pas pour rien que toutes les écoles du monde s’appliquent justement à transmettre les « pratiques écrites » (les seules vraiment largement « polyvalentes », mais pas universelles, loin de là), mais diffèrent beaucoup sur tout le reste. Ceci renvoie à une donnée capitale. Si tous les savoirs ont des liens entre eux, il n’existe aucun « savoir des savoirs » à partir de quoi construire une « polyvalence » systématique. On peut être à la fois footballeur et physicien ; mais c’est parce qu’on aura appris et le football et la physique, et pas un hypothétique savoir bivalent physico-footballistique. Une infime partie des savoirs humains (dont les 28 volumes de l’Encyclopédie de Diderot et ses 72000 entrées donnaient déjà une idée, pourtant encore très partielle) est scolarisée en réalité. On mesure alors que ce choix conditionne largement la nature d’une école. Par exemple, une pédagogie émancipatrice ne serait-elle pas limitée par essence si l’école ne comporte qu’un seul savoir à étudier, celui du Livre Sacré ?
Et enfin donc, troisième question, comment on enseigne, la question pédagogique. Pour un contenu donné, la manière de le traiter ne conduit pas forcément à la même éducation, au même traitement des inégalités, au même développement de la citoyenneté. Mais ces trois choix politiques se combinent, se conditionnent, et le dernier n’est en aucun cas indépendant. Supposons une classe Freinet non mixte (c’était le cas pour celles historiques du grand pédagogue en dépit de sa volonté) : dans quelle mesure peut-on isoler l’effet de ses méthodes « coopératives » et celui de ce seul fait de la non mixité ? Supposons maintenant que l’on décide justifié d’enseigner les mathématiques. Que devient alors la « production libre » des enfants ? En effet le régime de l’élaboration mathématique n’est ni celui de l’imagination libre, ni, surtout, celui de la démocratie. On ne décide pas de la véracité d’un théorème par un vote à la majorité, ni au consensus. Avec certaines limites, c’est vrai aussi de la véracité d’un fait historique (l’existence des chambres à gaz par exemple). Prenons cette question de la nature des savoirs scolaires avec encore plus de détails. Le défilement des objets à étudier dans un programme scolaire n’épouse que rarement leur construction historique. Il s’agit le plus souvent d’une reconstruction. Pilotée qui plus est par l’épistémologie dominante du moment dans le savoir savant de référence. L’histoire est-elle celle des « grands hommes » et des batailles ? Ou bien celle du « temps long » de l’école des Annales ? Comment la pédagogie ne serait-elle pas affectée par ce choix effectué bien en deçà de la classe ?
Sur toutes ces questions on devrait se reporter plus souvent à la seule expérience de masse durable d’une « autre école », à l’échelle de la Russie révolutionnaire toute entière. « L’école unique du travail ». Obligatoire et gratuite jusqu’à 17 ans, mixte, sans classements ni examens, inspirée du pragmatiste nord américain Dewey, durera de 1918 à 1924. Expérience mal connue, elle éclaire pourtant beaucoup de questions ici discutées. En particulier par la mise en relation des trois choix politiques sur l’école : à qui on enseigne, ce qu’on enseigne, comment on le fait.
Cet exemple de l’école pourrait aisément être repris dans bien des domaines. Autogérer ceci ? Sans doute. Peut-être. Mais on voit bien déjà que les choix directs laissés aux acteurs (élèves, enseignants, parents) sont en fait infiniment plus réduits qu’on ne le pense, ce qui ne veut pas dire qu’ils n’ont pas d’importance. De même le « temps libre » apparaît tel à qui a fini son temps de travail salarié. « Libre » il l’est certainement comparé au despotisme d’usine. Mais il dépend quand même étroitement des revenus disponibles, de l’impact des désirs forgés par des strates culturelles combinées, du genre sexué, de celui de la publicité, de l’organisation des transports et de tant d’autres choses encore.
La maîtrise « démocratique » de tout ceci est, pour le moins, à inventer. Mais là on est d’accord je suppose !
Samy Johsua
Cher Samy,
Nous te remercions pour ton commentaire de nos commentaires. C’est évidemment un échange « sans fin », mais que nous proposons de « suspendre » là, vers d’autres contributions, et débats, sur deux remarques en forme de conclusion ouverte, de notre part :
- Contrairement à la tendance que tu nous prêtes, nous estimons qu’il ne faut pas diluer l’autogestion dans « la démocratie » ; il faut mettre l’accent sur l’enjeu central que tu édulcores voire omets, et qui fait « basculer » l’ensemble du dispositif constitutionnel de droits et de pouvoirs d’une société : celui du « droit de propriété/gestion » – ou d’appropriation sociale.
Ce statut d’autogestionnaire doit, répétons-le encore une fois, être transcendant à diverses formes de propriété et relever d’un statut/droit des êtres humains co-responsables, sur toute leur durée de vie, de la production et la distribution des biens et services les affectant comme citoyens, producteur, usagers dans leurs diversité de genre, de culture, d’âge, etc.
La réduction de l’autogestion à des usines de type Lip – et son exclusion d’enjeux d’industrialisation dans une société comme l’était l’URSS postrévolutionnaire nous semble erroné et ne pas tirer les leçons des expériences et débats – même si, bien évidemment, une société développée permet de résoudre différemment les problèmes.
Mais c’est un enjeu de consolidation même de la révolution contre sa bureaucratisation et pour une « efficacité » (popularité) de ses choix contre ses ennemis internes/externes : la nature même de la planification et de l’organisation du travail, comme des priorités doivent être transformés par des droits autogestionnaires dès le début sous des formes évolutives. L’intérêt de l’expérience yougoslave est d’avoir mis cet enjeu à l’ordre du jour dans une société semi-périphérique, confrontée aux tâches d’industrialisation d’un pays largement agricole.
Ses différentes réformes sur trois décennies, ont remis en cause le faux dilemme entre planification étatiste ou marché (et, ce faisant, la conception limitée des droits autogestionnaires, confinés entreprise par entreprise et soumis à un horizon de gestion de court terme laissant les choix stratégiques à l’État/parti ou au marché/banques).
Nous devons et pouvons reprendre et poursuivre les propositions de la gauche yougoslave, dépassant ces faux dilemmes, là où elles n’ont pu être appliquées réellement : la planification autogestionnaire, mais aussi les « communautés d’intérêt autogestionnaires » dans la gestion de divers services, ainsi que les chambres de l’autogestion à divers niveaux territoriaux.
- Il y a en dehors de ces enjeux affectant l’ensemble de la société, des débats particuliers et spécifiques à creuser – comme ceux de l’éducation. On a intérêt à les pousser sous tous les angles où ils se posent – et tes contributions sur ce sujet sont précieuses.
Gilbert Dalgalian, Claude Kowal, Catherine Samary, Patrick Silberstein