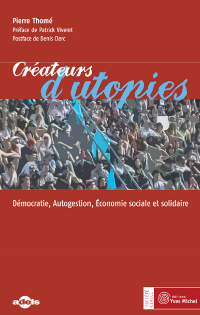 La parution de cet ouvrage a été annoncée par son auteur sur ce site aux fins de souscription. Il est désormais disponible et permet une note de lecture. Passionnant.
La parution de cet ouvrage a été annoncée par son auteur sur ce site aux fins de souscription. Il est désormais disponible et permet une note de lecture. Passionnant.
Un projet de livre qui a évolué
Le sujet initial de l’ouvrage était l’autogestion en France. Ce qu’elle avait été dans sa période faste des années 1960-1970 et ce qu’il pouvait en rester éventuellement aujourd’hui. Devant le constat actuel de l’absence presque complète du mot mais de l’existence de pratiques, la démarche a évolué : « La méthodologie qui a semblé la plus appropriée est celle de l’enquête auprès de personnes dont la vie militante et (ou) professionnelle ferait référence à des pratiques collectives non hiérarchisées et à l’autonomie, c’est-à-dire aux bases mêmes de l’autogestion. » De là l’évolution du titre de l’ouvrage qui était initialement Rêve d’autogestion, le mot autogestion étant relégué dans le sous-titre, « mélangé » aux notions de démocratie et d’économie sociale et solidaire. Mais le contenu est là, et il est passionnant.
Des témoignages de pratiques
Le livre est presque entièrement construit sur des témoignages de personnes ayant eu ou ayant toujours des pratiques autogestionnaires. Beaucoup dans les années 1970, mais aussi dans les années 1980, 1990 et aujourd’hui. Ces témoignages de plusieurs générations montrent la constance des thématiques à travers des pratiques qui évoluent, plus ou moins. Les différents chapitres traitent des principales thématiques : écologie, ville, féminisme, école, entreprise.
L’ouvrage n’a pas vocation à être un recensement exhaustif, impossible, de tout ce qui s’est fait et se fait encore. Des exemples sont choisis dans chacun des thèmes : bien sûr, Lip pour l’entreprise , mais aussi les Tanneries d’Annonay ; bien sûr le Larzac pour l’écologie, mais aussi les paysans-travailleurs ou le nucléaire ; et la Villeneuve de Grenoble, le MLAC, le lycée de Saint-Nazaire… Cela laisse assez de place pour que les témoignages soient divers, complets, nuancés et très souvent émouvants.
Chaque témoignage contient à la fois le récit d’une pratique et une réflexion sur cette pratique. On est ainsi dans une théorisation très concrète des pratiques et des problèmes qui sont apparus. Seul le premier chapitre se livre à une présentation théorique des origines de l’autogestion au XIXe et au début du XXe siècles ; présentation des courants politiques libertaires, marxistes et chrétiens. On est alors d’autant plus loin des pratiques que tout ce qui concerne les mouvements de sociétés de secours mutuels (ancêtres des mutuelles), de coopératives de production et de coopératives de consommation du XIXe siècle est renvoyé en introduction du dernier chapitre consacré à l’économie sociale et solidaire. Cette absence dans le premier chapitre fait alors manquer la continuité des pratiques, ensuite si bien montrée pour les cinquante dernières années, qu’il s’agisse de revendications autogestionnaires, de luttes autogérées ou de lieux autogérés.
Un livre sur le PSU, la CFDT… et les chrétiens
La plupart des témoins des années 1960-1970 ont été au PSU, et il en va souvent de même pour les décennies suivantes, pour peu que les protagonistes aient été majeurs dans les années 1970. La méthodologie de la recherche n’étant pas indiquée, il est difficile de savoir si il s’agit de la résultante de l’appartenance politique des auteurs induisant leur réseau de connaissances ou d’une donnée objective consécutif à un sondage ou un tirage aléatoire. Ne soyons pas trop pointilleux ; il est vrai que l’autogestion a été essentiellement portée dans les années 1960-1970 par la CFDT et le PSU comme c’est très bien montré au terme du premier chapitre par les témoignages, notamment de Michel Rocard (qui surprendront les plus jeunes qui ne connaissent que le Rocard d’aujourd’hui) ; il n’est donc pas étonnant d’en retrouver les militants dans les pratiques.
Ce qui est très bien rappelé dans l’ouvrage est l’apport très important, via les mêmes PSU et CFDT, du christianisme social à l’autogestion. JAC, JEC, JOC, ACO, La Vie nouvelle, aucune des composantes n’est oubliée. Il n’est donc là aussi pas surprenant de retrouver dans les itinéraires des témoins le passage dans ces différentes organisations, voire souvent dans le scoutisme.
Et les autres alors ?
Si ce rappel de l’apport du christianisme social, via le PSU et la CFDT, à l’autogestion est d’autant plus important qu’il est probablement largement ignoré des générations actuelles, l’ouvrage pèche par l’absence de trois apports non négligeables : les libertaires, les mouvements d’éducation populaire laïques et le mouvement communautaire.
Témoignage pour témoignage, l’auteur de ces lignes peut fournir un très grand nombre d’exemples de communautés et de lieux de vie autogérés, d’associations d’éducation populaire (CLAJ, Peuples et cultures…), de lieux culturels ou conviviaux autogérés et d’entreprises autogérées d’hier et d’aujourd’hui sans aucune origine religieuse de leurs membres.
On peut noter d’ailleurs que le PSU est présenté du point de vue rocardien, de manière partielle (même si ce qui est dit est juste), voire partiale : les « gauchistes » entrés en force au PSU après mai 68 sont présentés comme perturbateurs et assez « dangereux », trop « marxistes-léninistes », donc « autoritaires », donc peu autogestionnaires. Vision tout à fait fausse. Les rocardiens ont en effet évolué comme on sait après leur départ au PS et l’échec retentissant de leur tentative d’y faire adopter l’autogestion (adoption purement opportuniste qui aura duré cinq ou six ans), c’est-à-dire au mieux vers l’économie sociale et solidaire mais de manière assez peu autogestionnaire, tandis que les seuls aujourd’hui à défendre officiellement l’autogestion sont les Alternatifs, fruits de différentes recompositions de tendances dites « gauchistes », du PSU et de la Ligue communiste d’antan (ce qui n’empêche pas de pouvoir trouver très discutables leurs positions). Sans oublier bien sûr les libertaires.
Économie sociale et économie solidaire
Le dernier chapitre est consacré à l’économie sociale et solidaire. Son principal mérite, et il n’est pas mince, est de présenter, toujours sous forme de témoignages, une dizaine d’entreprises actuelles de l’ESS, plus ou moins autogérées.
Le chapitre débute par une présentation historique de l’ESS. Elle est assez bien faite jusqu’aux années 1970. Mais elle pèche un peu sur son renouveau dans les années 1970 et surtout sur l’apparition de l’économie solidaire venue s’adjoindre à l’économie sociale.
Curieusement, étant donné le ton très rocardien de l’ouvrage et le long entretien avec Michel Rocard même, rien n’est dit sur le rôle essentiel joué par celui-ci et les siens dans la renaissance de l’idée d’économie sociale et sa structuration en mouvement dans les années 1970, dans la loi de 1983 sur l’économie sociale, dans la création de la délégation interministérielle à l’économie sociale et dans celle du secrétariat d’État à l’économie sociale dans le premier gouvernement Mauroy.
Plus grave, l’apparition de l’économie solidaire est réduite à presque rien. Il s’agirait d’un simple rappel à l’économie sociale d’être solidaire, ce qui serait sa vocation d’origine. L’auteur peut alors écrire : « L’ESS se définit en premier par ses activités et son utilité sociale et non par sa nature juridique et économique ». Rarement la mise en cause des valeurs fondamentales d’origine de l’économie sociale depuis les années 1980 (mise en cause renouvelée avec la notion actuelle d’« entrepreneurs sociaux ») n’aura été traitée avec une si rapide pirouette. Les valeurs fondamentales de l’économie sociale, c’est un collectif de personnes qui prend en charge une activité (production, consommation, gestion d’un risque…), sans objectif de profit financier individuel, avec pour principe « une personne = une voix ». Il ne s’agit donc ni d’activités prédéfinies (n’importe quelle activité peut entrer dans le champ de l’économie sociale) ni d’« utilité sociale » (notion en fait attribuée par les pouvoirs publics, alors qu’il s’agit en économie sociale d’utilité collective librement définie par les membres du collectif). La nature juridique est alors essentielle pour l’économie sociale puisqu’il s’agit de fixer de manière intangible qu’il s’agit d’un collectif et qui fonctionne sur le principe « une personne = une voix ». Donc, un travailleur indépendant, ce n’est pas de l’économie sociale, et une société de capitaux (Sarl, SA) ce n’est pas de l’économie sociale.
Il n’est pas question ici de jugement de valeur (encore que…), mais de délimitation de notions. L’économie sociale c’est une histoire collective, sans profit, fonctionnant démocratiquement (il s’agit bien sûr d’un idéal). L’économie solidaire c’est faire le bien (insertion, environnement, etc.), individuellement ou collectivement, démocratiquement ou non, de manière intéressée ou non. Cette économie solidaire est apparue à la fin des années 1970 et est intimement liée à l’apparition des notions d’exclusion et d’insertion, elles-mêmes principaux instruments de la destruction des notions de classes et de luttes de classes. En poussant le bouchon un peu loin, on peut se dire que les chrétiens qui n’avaient que fugitivement admis la lutte de classes, si fondamentalement contraire à toute leur tradition, se sont engouffrés dans la brèche. On retrouvait des pauvres à sauver sans trop se poser la question du pourquoi.
Bref, si une notion peut être porteuse d’autogestion, c’est bien l’économie sociale et son formalisme juridique. Autre chose est la critique qu’on peut faire de son fonctionnement réel.
À noter qu’il est à plusieurs reprises évoqué par des témoignages que le statut de scop n’a pas été adopté à cause des difficultés qu’il entraînait vis-à-vis de l’environnement économique, les scop bénéficiant d’avantages concurrentiels très mal vécus par les entreprises du secteur marchand (clientes ou fournisseuses). On peut se demander de quels avantages il s’agit puisque la seule exonération dont bénéficient les scop est celle de la contribution économique territoriale (ex taxe professionnelle), ce qui ne constitue pas un avantage si considérable. Les mythes entretenus par le Medef à l’égard des mondes associatif et coopératif ont la vie dure.
L’égalité et la rotation des tâches
Si l’égalité dans la prise de décision est revendiquée dans tous les témoignages d’hier comme d’aujourd’hui, il n’en va pas de même de l’égalité financière. D’ailleurs, même dans l’égalité dans la prise de décision, elle est visiblement largement battue en brèche dans les entreprises actuelles présentées dans le livre. Effet de l’économie solidaire ? Les compétences sont inégales, et il n’est pas pensable de se passer, a minima, du filtre de la démocratie représentative, voire de restreindre la décision aux dirigeants, libre à la base de ne plus les élire à l’assemblée générale suivante. La démocratie directe qui s’admet bien dans les luttes semble bien difficile à concevoir dans le fonctionnement d’une entreprise ; deux entreprises seulement y échappent (du moins dans le livre, car dans les entreprises du réseau Repas, c’est pratiquement la règle).
Ce sont les deux mêmes entreprises (La Péniche et Ardelaine) qui pratiquent l’égalité salariale, encore plus définitivement rejetée par les autres. Quant aux années 1970, cette revendication n’apparaît jamais, sauf un cours instant pour le partage des recettes de vente de montres de Lip : Piaget dit en AG que ce serait mieux dans l’idéal, mais que les crédits, etc. ne sont pas les mêmes pour tous et que dans le souci de rester tous unis, il vaut mieux respecter la hiérarchie des salaires.
Retrouver l’ampleur de la revendication égalitaire à cette époque serait un gros travail. Toujours témoignage pour témoignage, l’auteur de ses lignes a souvenir qu’elle était assez importante puisqu’une des revendications de la CFDT de l’époque était les augmentations égales pour tous (100 F pour tous par exemple), ce qui tendait à réduire inexorablement les écarts de salaires sans brutalité. Il en reste toutefois un petit quelque chose puisque toutes les entreprises présentées insistent sur la faiblesse de l’échelle des salaires, notion en effet traditionnelle dans l’économie sociale en général. Mais, étant donné leur taille modeste en termes de chiffre d’affaires et de salariés (une seule atteint 8 millions d’euros et une seule 40 salariés, toutes les autres étant inférieures à 20 salariés, voire à 10) et le type d’activités exercées, des écarts de salaires de 1 à 2 à 1 à 4 ne sont pas particulièrement égalitaristes, même si ils seraient un peu supérieurs dans le secteur marchand.
Enfin, toujours les deux seules mêmes structures parlent de la rotation des tâches pour assurer une meilleure connaissance par tous de tous les aspects de l’entreprise. Démocratie directe, rotation des tâches et égalité financière apparaissent ainsi comme les pierres de touche d’un fonctionnement irrécupérable par le capitalisme.
Source originale : http://www.autogestion.coop/spip.php?article129

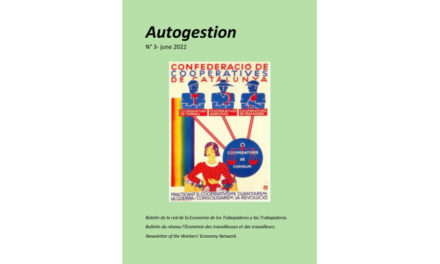
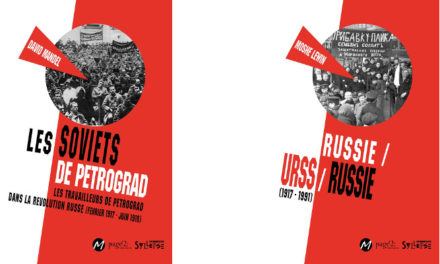
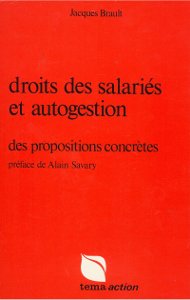










S’il est en France un mouvement qui défend l’autogestion, et cela depuis plus de 75 ans, c’est bien celui des distributistes, qui s’expriment dans leur mensuel La Grande Relève et sur leur site economiedistributive.fr.
Renseignez-vous, vous verrez qu’ils proposent la véritable démocratie en économie,grâce, en particulier à la remise aux peuples de la création monétaire, la production réalisée dans des coopératives en autogestion et un revenu garanti à tous. Tout cela étant rendu possible par une monnaie distributive, c’est-à-dire qui ne circule pas pour rendre impossible le placement contre intérêt.