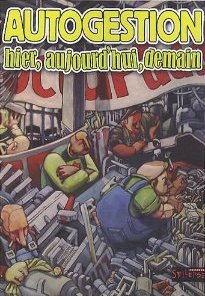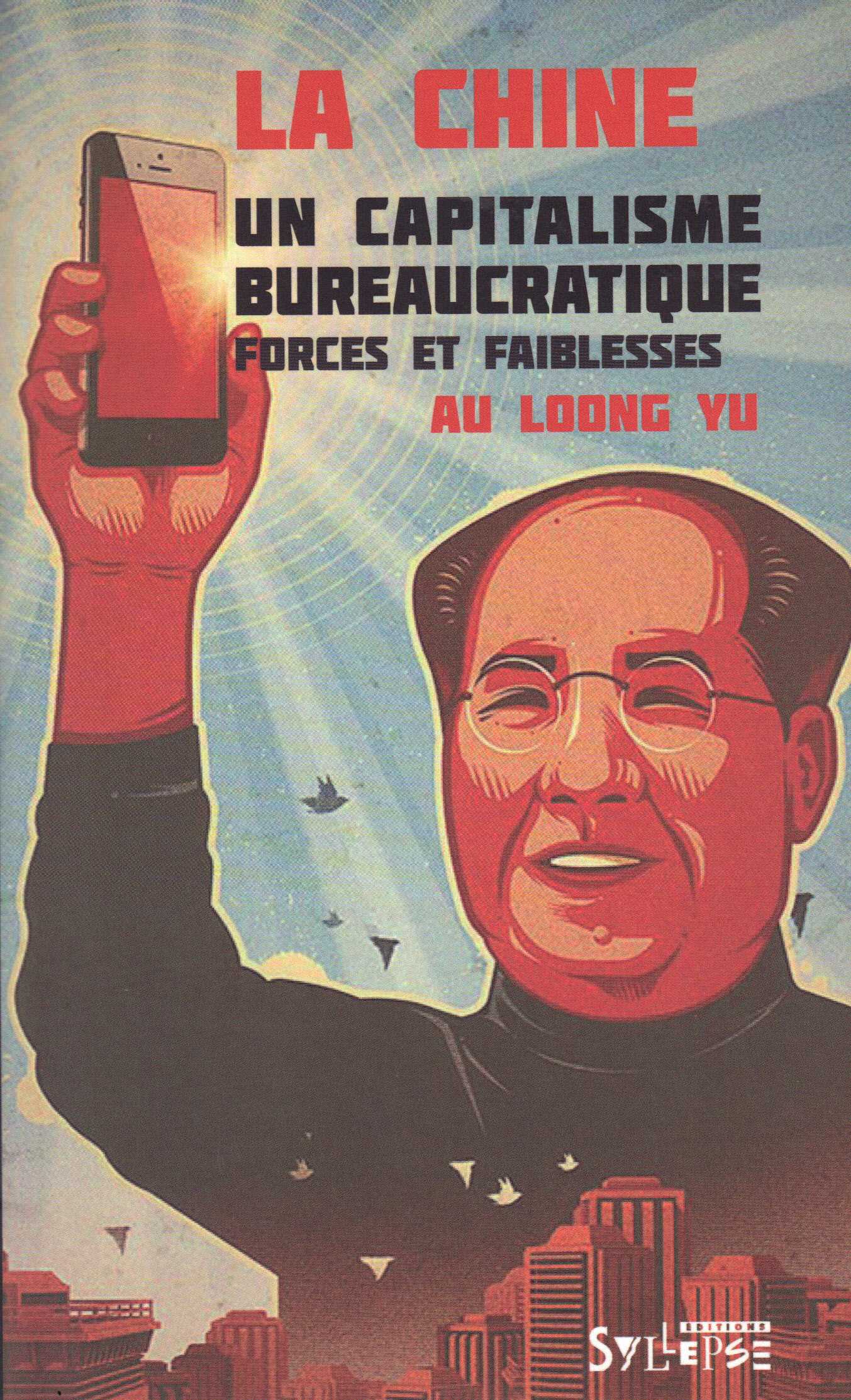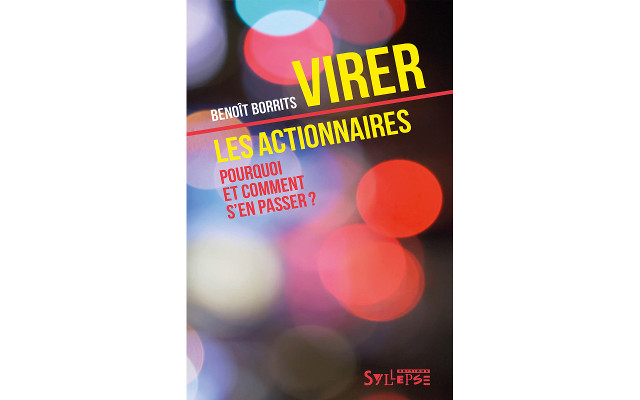
Les gouvernements du monde entier déversent des aides massives pour les sociétés de capitaux (exonération de cotisations sociales, chômage partiel, prêts bonifiés…) au nom de la prétendue sauvegarde de l’économie et de l’emploi. Nos budgets publics sont donc massivement sollicités pour sauver le patrimoine des actionnaires sans aucune contrepartie : la reprise boursière en est le témoin le plus criant. Cette crise sanitaire et économique ne fait que renforcer la tendance lourde à un ralentissement généralisé de la croissance mondiale qui, comme le livre Virer les actionnaires, pourquoi et comment s’en passer ? le démontre, empêche un quelconque compromis entre les classes sociales. Pour le dire autrement, on peut vouloir une reprise du progrès social, il est urgent d’engager la transition écologique de nos sociétés mais ceci ne pourra se faire sans poser la question du départ des actionnaires et de la transformation des sociétés de capitaux en unités de production autogérées par leurs travailleur.ses et usager.ères. Nous publions ici, avec l’aimable autorisation des Éditions Syllepse, l’introduction de ce livre écrit quelques mois avant la crise du covid-19.
Le paysage politique semblait stable après la chute du mur de Berlin. Cet événement nous a été présenté comme le glas de toute alternative possible au capitalisme. S’il y avait toujours une gauche et une droite dans les pays de démocratie parlementaire, les différences entre les deux s’estompaient au point où certains théorisaient la fin de l’Histoire dans une combinaison heureuse de démocratie, de liberté et de croissance 1. Dans les pays anciennement industrialisés, la réalité de ces trente dernières années s’est révélée bien différente. Le chômage de masse et la précarité n’ont cessé de croître. De nombreuses avancées sociales ont été remises en cause par des « réformes » successives présentées comme « inévitables ». Dans le même temps, ce système s’avère incapable de répondre aux enjeux écologiques et le réchauffement climatique nous menace à très court terme : nous assistons impuissants à la destruction méthodique de l’ensemble de nos écosystèmes.
La crise des subprimes de 2008 est révélatrice de l’instabilité fondamentale de ce système. Comme les salaires étaient insuffisants pour générer une demande satisfaisante pour les profits des entreprises, on a endetté des ménages à faibles revenus en leur proposant d’emprunter à taux élevés à des conditions intenables pour qu’ils deviennent propriétaires de leurs logements. C’était côté pile. Côté face, les banques ont revendu ces prêts sous forme de produits financiers à haut rendement – Collateralized Debt Obligation (CDO) – réputés sûrs du fait de l’adjonction d’un dérivé d’assurance – Credit Default Swap (CDS). Il est arrivé ce qui devait arriver : les ménages n’ont pu rembourser. Mais trop, c’est trop : les contreparties des dérivés d’assurance se sont avérées défaillantes alors que ces produits insolvables étaient dans tous les bilans des banques et des institutions financières. La banque Lehmann Brothers a fait faillite entraînant des pertes gigantesques dans tous les établissements financiers et bloquant les prêts à l’économie. Cette crise a entraîné la plus grande récession depuis 1929 et d’une certaine façon, et comme nous le verrons, le capitalisme ne sera plus jamais comme avant. Il a certes été sauvé mais les populations en ont payé le prix fort.
Ceci ne pouvait pas avoir d’effets sur le plan politique : les anciennes forces dominantes – conservatrices et sociales-démocrates – vont toutes, sous des formes différentes et selon les pays, connaître des chutes de popularité sans précédent. En France, le Parti socialiste et les Républicains ne sont plus que des forces d’appoint. En Allemagne, il a été nécessaire d’établir une coalition entre les partis chrétien-démocrate et social-démocrate. L’hégémonie de ces partis est contestée par des forces dites populistes qui se présentent comme anti-système dont l’origine vient soit de l’extrême droite historique comme en France ou en Italie, soit de partis conservateurs comme en Hongrie ou aux États-Unis. En France, l’émergence d’Emmanuel Macron et de son nouveau parti En marche se présente comme le rempart contre ces courants tout en poursuivant le programme néolibéral sous couvert d’incarner la « révolution ». Ceci nous rappelle étrangement un certain Matteo Renzi en Italie, venu de la démocratie chrétienne et qui intègre le Parti démocrate issu de l’ancien Parti communiste… Même jeunesse, même volonté de « réformes », même volonté de relancer l’économie du pays et de renouveler les institutions… pour décevoir et laisser la place à une improbable coalition de la Liga, issue d’un mouvement séparatiste nord-italien d’extrême droite, et du nouveau Mouvement cinq étoiles, qui a siphonné les voix de la gauche avec un discours mêlant démocratie radicale, écologie et rejet des immigrés et des syndicats.
Partout ce populisme progresse avec au moins un point commun : le refus de l’étranger. Aux États-Unis, c’est l’arrivée de Donald Trump à la présidence sous les couleurs du Parti républicain. Au programme, la contestation des conditions actuelles du libre-échange avec le retour de barrières protectionnistes censées recréer des emplois locaux et une chasse totalement inhumaine et sans précédent contre les immigrés, le tout sous un refus éhonté de l’évidence du réchauffement climatique. Au Royaume-Uni, il a pris la forme de la sortie de l’Union européenne à la suite d’un référendum dont les instigateurs, trop sûrs d’eux-mêmes, pensaient qu’il confirmerait le statu quo. Le pire est de penser que ce sont les couches populaires qui ont voté cette sortie, comme si elle allait résoudre leurs problèmes dans ce pays malmené par des années de thatchérisme et de blairisme. En attendant, la crise politique est à son comble et risque de réveiller des tensions historiques en Irlande. En Italie, c’est surtout l’extrême droite qui profite de cette coalition hétéroclite avec l’institutionnalisation d’un discours anti-immigrés et l’instauration d’une flat tax qui fera les choux gras des plus riches.
Libéralisme ou populisme ? Tel semble désormais être l’alternative peu réjouissante qui nous est proposée. Certes, on constate ici et là l’émergence d’une troisième voie de gauche qui s’incarnerait par un renouveau social-démocrate assez net du côté des pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, ou par un renforcement de l’écologie politique qui s’explique, entre autres, par l’urgence de conjurer le réchauffement climatique. D’une façon générale, ces forces politiques ne remettent pas en cause le capitalisme : il s’agit d’introduire de la justice sociale et une reconversion écologique de l’économie par des redistributions, des législations et des incitations. Nous avons ici affaire à un paradoxe énorme. Sur ces trente dernières années, la social-démocratie a échoué dans son projet politique qui consiste à aménager le capitalisme dans un sens favorable à la classe salariée. Plus nous avançons dans le temps, plus on s’aperçoit que le capital est incapable d’accepter le moindre progrès social et plus les électeur/trices salarié·es ont assimilé la social-démocratie au consensus néolibéral au point qu’une fraction non négligeable de cet électorat s’est tournée vers l’extrême droite. Qu’est-ce qui ferait qu’aux États-Unis, un Parti démocrate conquis par son aile gauche sociale-démocrate réussirait là où leurs homologues européens ont échoué ? Comment expliquer que de nouvelles forces de gauche qui n’ont pas de programme de sortie du capitalisme, telles que Podemos en Espagne ou La France insoumise, réussiraient là où la social-démocratie traditionnelle a échoué ? Parce que les sociaux-démocrates ont trahi alors que ceux-ci ne faibliront pas ? La thèse de la trahison n’est guère crédible tant le renoncement a été général : les raisons de la faillite de la social-démocratie sont plus à trouver dans l’irréalisme de leurs programmes d’aménagement du capitalisme.
Concernant l’écologie politique, on peut tout autant s’interroger. La mise en œuvre de la reconversion écologique de l’économie impose des mesures de restrictions de certaines productions et consommations, de taxations et de redistributions à visées incitatives. Le capital n’y est jamais favorable : il rejette toute décision politique qui fixe des limites à sa valorisation. De ce point de vue, le projet actuel de l’écologie politique a ceci de commun avec celui de la social-démocratie qu’il ne remet pas en cause le capitalisme. L’écologie politique veut certes constituer un nouveau paradigme politique autour d’une écologie qui intégrerait la justice sociale. Ceci a beaucoup de sens, mais en l’état actuel de ses programmes, elle rencontrera les mêmes obstacles que la social-démocratie.
Dépasser le capitalisme ? Sortir du capitalisme ? Combien de fois entend-on ces expressions au point où elles semblent parfois relever de la pure rhétorique. Pour nous, la définition du capitalisme est simple : il s’agit d’une économie dominée par des sociétés de capitaux, à savoir des entreprises privées qui appartiennent à des personnes, physiques ou morales, extérieures à l’entreprise et qui ne les détiennent que dans le but de valoriser leur patrimoine. Il ne s’agit donc pas de l’économie marchande en tant que telle même si celle-ci, sans contrepoids politique, mène directement au capitalisme. Le capitalisme n’est pas non plus le néolibéralisme même si nous défendons que ce dernier est l’évolution naturelle et terminale du capitalisme. Sortir du capitalisme correspond donc à quelque chose de précis : évincer les actionnaires.
Comme nous allons le montrer dans ce livre, nous ne voulons pas évincer les actionnaires parce nous serions des gens au mieux radicaux, au pire méchants. Nous voulons les évincer parce que ce système est aujourd’hui incapable de nous apporter de nouveaux progrès – ce qu’il a su faire dans le passé sous la pression de luttes sociales – et de répondre à l’urgence écologique. L’objet premier de ce livre est de démontrer qu’il n’y a plus de possibilités de progrès social, de transition écologique de l’économie si nous maintenons les sociétés de capitaux.
Face à l’augmentation sans précédent des profits des entreprises, la tentation est grande – et facile – de penser qu’il suffirait que les entreprises gagnent un peu moins pour que tout aille mieux. On avancera même que si les salaires étaient plus élevés, la population dépenserait plus auprès des entreprises et que cela pousserait celles-ci à investir pour répondre à cette demande nouvelle. Ceci a l’apparence d’un raisonnement infaillible d’autant que cela a fonctionné dans le passé. Pourtant cela ne marche pas à tous les coups et fonctionnera encore moins demain qu’hier. La raison ? Des changements structurels en termes de croissance et de taux d’intérêt.
Ceci suppose de tordre le cou à une erreur fondamentale : une assimilation de la valeur de l’entreprise avec celle de son patrimoine net. Le patrimoine net ou les fonds propres de l’entreprise – ces deux termes sont synonymes – se définit par la différence entre ce que l’entreprise possède – ses actifs – et ce qu’elle doit – ses dettes. Or une transaction sur une entreprise – qu’elle se fasse lors d’un rachat ou par l’échange quotidien de ses actions en bourse – ne se fait jamais sur la base de ses fonds propres. La valeur d’une action ou d’une entreprise est toujours déterminée, comme pour n’importe quel actif financier, par la valeur actualisée de ses revenus futurs. Pour une action, l’évaluation par le marché de ses dividendes futurs déterminera sa valeur. Autrement dit, la valeur d’une entreprise est purement spéculative : si tout le monde est convaincu que l’entreprise ne versera jamais aucun dividende dans le futur, alors cette entreprise ne vaut strictement rien, et ce, même si elle dispose d’un patrimoine net significatif. Inversement, si le marché estime que les dividendes à venir vont être fabuleux, sa valeur tend parfois vers le déraisonnable. Ceci se comprend aisément : le seul intérêt d’être propriétaire d’une entreprise est d’en recevoir des rémunérations.
On peut trouver technique ce distinguo entre patrimoine net et valeur. Il n’en reste pas moins que confondre les deux a des implications politiques fondamentales. Si on assimile à tort la valeur de l’entreprise à son patrimoine net, on considère alors qu’il est tout à fait acceptable pour des actionnaires que l’entreprise gagne moins : il est donc possible d’établir un compromis entre les classes. À l’inverse, si on fait ce distinguo, on comprend alors que si les profits sont moindres, ceci signifie que les perspectives de dividendes vont baisser et donc les valorisations des entreprises. Dit autrement, si l’entreprise gagne toujours de l’argent, les actionnaires, eux, vont en perdre. En soi, cela ne saurait nous émouvoir sauf que ceux-ci conservent le pouvoir et décident, par l’intermédiaire des directions qu’ils ont mises en place, du niveau de l’emploi et des investissements. Ils n’embaucheront et n’investiront que si leurs projets répondent aux critères financiers des marchés, à savoir un rendement supérieur au taux d’intérêt et à la prime de risque. Or en cas de baisse des profits, ce dernier paramètre ne pourra que bondir et raréfier les projets. Pour le dire plus crûment, les actionnaires vont pratiquer la grève des investissements… C’est ce que nous verrons dans le premier chapitre.
Il est possible que ces notions apparaissent techniques, voire compliquées. Ce premier chapitre et les suivants détailleront celles-ci de la façon la plus didactique qui soit. Afin de faciliter la compréhension de ces notions fondamentales, on signalera entre crochets […] des vidéos disponibles sur le site economie.org. Au nombre de treize, celles-ci sont regroupées en quatre sessions : l’entreprise, la finance, la monnaie et la macroéconomie. Il n’est pas forcément indispensable de les écouter dans la mesure où ce livre se suffit à lui-même mais celles-ci peuvent apporter un éclairage complémentaire sur un sujet donné. Ces vidéos n’ont qu’une vocation pédagogique et on pourra les écouter à son rythme si on souhaite approfondir certaines des notions évoquées dans ce livre.
C’est dans cette confusion entre patrimoine net et valeur de l’entreprise que se trouve l’impasse de toutes les politiques sociales-démocrates et de l’écologie politique. On veut pratiquer des politiques socialement et écologiquement nécessaires et on se heurte immédiatement au « mur d’argent » ou plus exactement au pouvoir du capital. L’actualisation des dividendes attendus qui nous donne la valeur de l’entreprise fait aussi appel à d’autres paramètres tels que le taux d’intérêt ou la croissance. La croissance mondiale se ralentit partout et, pour soutenir celle-ci, les banques centrales n’ont de cesse depuis plus de trente ans de baisser les taux d’intérêt. Depuis la récession de 2009, ceux-ci sont désormais proches de zéro, voire négatifs. Le taux d’intérêt représente la rémunération du capital sans risque. Si le taux d’intérêt est nul ou négatif, ceci signifie que le capital en tant que tel ne rémunère plus : il est alors nécessaire de prendre des risques pour obtenir une rémunération. Voilà une situation qui tranche largement avec celle qui a prévalu durant deux siècles durant lesquels la rente tournait autour de 5 %. N’est-ce pas un symptôme qui nous indique qu’il est désormais nécessaire de tourner la page du capitalisme ? En ne la tournant pas, nous nous trouvons alors face à un capitalisme de plus en plus féroce et intransigeant. Comme la valorisation du capital est purement spéculative et que les anticipations de résultats sont intégrées dans les cours, la hausse du capital ne peut donc se réaliser que par une pression accrue sur les salaires et le refus de toute hausse de la fiscalité. Le fait que le capital et les gouvernements libéraux ou populistes qui le soutiennent deviennent de plus en plus autoritaires ne saurait nous étonner dans ce contexte. Et quand bien même le capital réussirait dans ses desseins, ne serait-ce pas une victoire à la Pyrrhus ? Une pression accrue sur les salaires sape la demande adressée aux entreprises et nuit à la croissance. Et si tel n’est pas le cas, cette croissance nous mène tout droit à la catastrophe écologique. Tel est l’objet du second chapitre.
Mais que proposent la gauche et les écologistes dans cette situation ? La théorisation de la finance a commencé dans les années d’après-guerre pour n’être appliquée dans les entreprises que dans les années 1980 et 1990. Assez paradoxalement, celle-ci n’a pas été intégrée dans le camp progressiste qui continue de préconiser des recettes keynésiennes datant de l’entre-deux-guerres et des années 1950. Avec la chute du mur de Berlin, la gauche a mis en veilleuse sa volonté de transformation sociale en se rabattant sur des politiques qui étaient précédemment pratiquées par des conservateurs au moment où ces derniers abandonnent le keynésianisme pour lui préférer la violence du néolibéralisme. Incroyable paradoxe qui donne à la gauche son image délicieusement passéiste et ne la vaccine nullement contre quelques rares convergences très ponctuelles, néanmoins interpellantes, avec l’extrême droite. Le troisième chapitre questionnera donc le caractère progressiste du keynésianisme et l’insuffisance des politiques de redistribution.
La critique est aisée mais l’art est difficile. Dès lors, que substituer au capitalisme ? Le cœur du conflit entre le capital et le travail est le partage de la valeur ajoutée, à savoir ce qui est produit. Comme la valorisation du capital productif est basée sur les anticipations de dividendes, ceci signifie que si une configuration sociale et politique remet en cause ces dividendes, alors la valorisation du capital sera nulle et la question de la relève sera posée. Qui doit dès lors diriger les unités de production ? C’est ici que la pratique du Commun 2 nous est utile pour penser le dépassement du capitalisme et de la propriété productive 3 : ce sont les utilisateurs des moyens de production à savoir les travailleur·euses et les usager·ères de l’entreprise qui sont appelé·es à diriger celle-ci, à constituer un commun productif qui sera en interaction avec d’autres communs de financement des actifs et de sécurisation des revenus des salarié·es. Nous reviendrons sur ces questions dans le quatrième chapitre.
Enfin le cinquième et dernier chapitre décrira un scénario qui permet d’envisager cette transition entre le capitalisme et une société plus humaine qui permettra de garantir à toutes et tous un avenir digne dans un monde qui aura surmonté – hélas, non sans dégâts irréparables – les défis écologiques qui se posent à nous. Nous avons bien dit « permettra » car le monde que nous décrivons sera profondément démocratique et cela n’exonérera nullement la population de devoir faire les bons choix au bon moment. Mais, à l’inverse du capitalisme où l’horizon des possibles est bloqué par la nécessité d’assurer une valorisation au capital, cette société nous autorisera enfin à prendre les décisions qui s’imposent face au péril écologique. En tout état de cause, il ne s’agit que d’un scénario et comme tout scénario, il ne se déroulera jamais tel quel. Mais son objectif est de montrer qu’une transition pacifique est possible. Le capitalisme a largement fait son chemin ; il est urgent d’en sortir.
Notes: