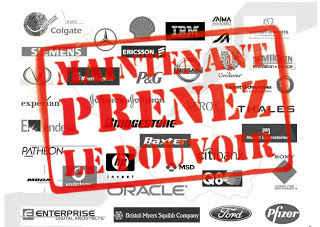PARTIE 1
1948 fut l’année de l’« excommunication » des communistes yougoslaves par Staline. Pourquoi quelque soixante-dix ans plus tard s’intéresser encore (ou à nouveau) à l’expérience socialiste autogestionnaire yougoslave[1] ? Que pourrait-on y trouver pour répondre aux problèmes du capitalisme du 21e siècle alors que l’ancienne fédération et système yougoslaves ont disparu dans la tourmente de dramatiques voire sanglants conflits ?
L’alternative exprimée en 1918 par Rosa Luxemburg, « socialisme ou barbarie » est plus que jamais actuelle. Mais les mots – socialisme, communisme – associés aux projets émancipateurs, ont été affaiblis ou dénaturés par des échecs voire par des politiques criminelles mais aussi par des idéologies mensongères couvrant d’autres politiques criminelles. Il faut se réapproprier les « utopies concrètes » en réaffirmant la légitimité des aspirations progressistes et la possibilité de choix. Cela implique notamment de rendre intelligibles les premières tentatives de rupture avec la logique capitaliste : il ne s’agit ni de peindre en rose ce passé de façon apologétique en gommant ses échecs, ni à l’opposé, de le diaboliser en ignorant ses apports. Ceux de l’autogestion yougoslave ont été sans précédents dans l’histoire et porteurs de leçons précieuses pour les luttes actuelles. Il ne faut pas accepter les interprétations de sa destruction qui visent à en enterrer la portée subversive.
Une crise de l’autogestion – ou du système politique ?
En 1993 après l’éclatement de la Fédération et la désintégration du système yougoslave, l’économiste croate Branko Horvat évoquait les multiples « explications » courantes de cet échec[2] : échec économique ? Echec de l’autogestion ? Ou encore échec de la propriété sociale ? À cette énumération, il ajoutait le point de vue de certains économistes reconnaissant tout de même qu’il y avait eu un réel développement de l’économie, mais l’attribuant exclusivement à l’aide étrangère. « Aucune de ces explications » de l’échec « n’est correcte », écrivait-il, en soulignant l’ampleur des succès économiques jusqu’au début des années 1970[3]. Les causes de l’échec final « sont politiques » estimait-il. Il faut s’appuyer sur ce jugement, légitime et essentiel, quelles que soient les désaccords possibles quant aux solutions proposées par Branko Horvat, qui doivent être débattues comme les autres : l’important est qu’il affirme avec force la pertinence d’un projet socialiste autogestionnaire et qu’il a manqué en Yougoslavie un « système » permettant à l’autogestion et à la propriété sociale de surmonter la crise.
Je partage ce diagnostic mais je le préciserai ou le reformulerai en disant que l’échec est politique, non pas au sens où il aurait fallu évacuer « la politique » des procédures économiques et de la gestion de la crise ; ni même au sens où il aurait fallu écarter la Ligue des communistes de Yougoslavie et notamment ses dirigeants historiques du processus de gestion de la crise. Dans le système capitaliste comme dans ceux qui se réclamaient du socialisme, les crises révèlent des « économies politiques[4] » conflictuelles. Celle du capital, appuyée sur la domination de la propriété privée des moyens de production et sur de redoutables mécanismes et institutions mondialisée, ne dominait plus en Yougoslavie, même si ses pressions s’exerçaient. La révolution yougoslave avait permis que d’autres droits et critères soient dominants contre le capital, appuyés sur une propriété sociale dont la gestion réelle a évolué et oscillé entre étatisme bureaucratique et autogestion au plan des entreprises, entre plan et marché, mais avec quels pouvoirs de décision cohérents des autogestionnaires et des peuples concernés ? Mettre cette question – celle de la démocratie socialiste – au cœur de l’interprétation de la crise, ne veut pas dire qu’il existe des réponses simples, sans conflits. Mais les réponses que l’on cherche et qu’il est possible d’inventer sur la base de l’expérience et de la réflexion, dépendent de qui décide ?
La grande crise du capitalisme financier mondialisé de 2007-2009 a démontré l’échec de ses prétendues recettes « d’efficacité ». Mais elle n’en a pas été la fin. Plus que jamais, toutes les aspirations et droits remettant en cause le règne de l’argent-roi et de la concurrence marchande sont taxées de « rigidités » rétrogrades. Ce capitalisme mondialisé de plus en plus barbare nous ramène au 19e siècle en voulant criminaliser les révolutions et résistances anticapitalistes du 20e siècle et en les réduisant à leurs échecs. Ce système, de plus en plus porteur d’une violence destructrice à la fois de la planète et de droits sociaux fondamentaux, fait naître en son sein des monstres fascisants faisant de l’ « étranger » la cause de tous les maux. Faute d’alternatives progressistes, les populations sont piégées dans de faux choix binaires : mondialisation destructrice ou libéral-nationalisme xénophobe ? L’Union européenne (UE) ne protège ni de l’un ni de l’autre de ces pôles réactionnaires qui se nourrissent l’un l’autre et produisent l’un et l’autre un racisme structurel dont la composante islamophobe est de plus en plus universalisée : elle « légitime » de nouvelles guerres, de nouveaux murs, des politiques liberticides couvrant une guerre sociale planétaire. Contre ces utopies réactionnaires, mieux vaut s’atteler à tout ce qui est porteur d’utopies progressistes – c’est –à-dire non pas la destruction des droits, mais leur extension. C’est pourquoi l’expérience yougoslave, ses avancées et ses échecs, peut aider à penser un autre projet européen, combinant doits sociaux et nationaux égalitaires, à la fois contre une UE au service des marchés financiers et contre les pseudos alternatives nationalistes xénophobes.
Le système yougoslave reconnaissait des droits sociaux et nationaux sans équivalent. Mais sans « système » démocratique permettant de leur donner une « cohérence » et « efficacité » – selon quels critères en juger ? Les points de vue des populations concernées, elles-mêmes. En absence de mode de décision démocratique, ce sont dans les conflits, interprétés par le parti dominant, que des « économies politiques » contradictoires révélaient leur existence. C’est pourquoi, loin de proposer un « modèle économique » (contrairement à Branko Horvat), je me suis intéressée aux conflits et logiques contradictoires à l’œuvre derrière les différentes réformes du système yougoslave comme révélateurs de ces problèmes à résoudre, du point de vue d’une cohérence qui se cherchait : celle de la propriété sociale et des droits, autogestionnaires et nationaux reconnus. Avec des critères possibles de jugement : les moyens (institutionnels, socio-économiques, politiques) mis en œuvre dans les diverses réformes permettaient-ils de satisfaire les besoins et droits reconnus comme légitimes par les valeurs dominantes, socialistes et égalitaires, du système ?
Ma démarche sur ce plan, antérieure aux analyses de Michael Lebowitz[5], converge en grande partie avec elles, mettant en évidence des conflits spécifiques aux pays se réclamant du socialisme et dirigés par un parti unique régnant au nom des travailleurs. Au-delà des formes et périodes les plus répressives (qui ne peuvent durer), il s’agit d’analyser comment le règne du parti/Etat cherchait à se stabiliser au travers de ce que Lebowitz appelle un « contrat social » entre le « conducteur » (le parti dit « d’avant-garde ») et ceux au nom duquel il régnait sous pression d’une logique socio-économique alternative, celle du capital. Celle-ci, outre son existence extérieure internationale, pouvait s’engouffrer dans le système économique[6]. Je ne peux ici discuter[7] (au-delà de quelques remarques sur le cas yougoslave) le contenu historique concret du « parti d’avant-garde » et du « contrat social » ; mais il faut le faire de façon concrète, donc contextualisée, sous l’angle des orientations socio-politiques des divers partis concernés en y incluant la façon dont ils sont arrivés au pouvoir et leurs orientations nationales et internationales évolutives (pas les mêmes derrière le parti unique, du temps de Lénine ou de Staline ; ou encore derrière Ceaucescu, Tito, Mao ou Fidel Castro).
Les spécificités du régime titiste peuvent s’analyser en remontant au premier acte fondateur du nouveau système : la mise en place de l’AVNOJ, cette assemblée populaire des comités de libération nationale de tout le territoire : sa forme-même plurinationale constituait une critique de la première Yougoslavie ; et sa convocation en pleine guerre a répondu, par une puissante démonstration de force sur le terrain, au « partage du monde » qui se négociait dans les coulisses diplomatiques entre grandes puissances incluant Staline. En effet, les accords de Yalta prévoyaient un retour de la monarchie serbe réfugiée à Londres et soutenue par la résistance des tchetniks, dont l’antifascisme était tempéré par l’anticommunisme. L’AVNOJ refusa le retour du roi et proclama une république fédérative. La force politique du PCY (alors qu’il ne comptait guère plus de quelques 5000 membres avant la guerre) fut dans sa capacité de mobilisation populaire et multinationale à la fois contre ses adversaires internes (des tchetniks aux oustachis) et internationaux (des Alliés aux envahisseurs, avec leurs relais intérieurs respectifs) : ce sont les succès de la résistance organisée par les partisans qui forcèrent sa reconnaissance internationale par les Alliés. Et ces succès furent organiquement liés à la levée en masse des paysans dans l’Armée populaire yougoslave et aux comités de libération nationale. Leur base de masse populaire reposait d’une part sur leur structure fédérative préfigurant concrètement les droits nationaux reconnus dans la nouvelle Yougoslavie ; mais aussi, dans les territoires libérés, sur la distribution de la terre aux paysans pauvres et l’annulation des dettes des populations paupérisées.
La guerre favorisa les dimensions centralistes du rôle dirigeant du PCY, devenant monopole de pouvoir après la fin de la guerre. Mais elles se légitimaient par une victoire et des promesses crédibles associées à une puissante mobilisation révolutionnaire organisée sur le terrain, au plus proche des populations concernées. Même si l’introduction d’un modèle centraliste de type soviétique après la victoire a créé une discontinuité entre les Comités de libération nationale et l’autogestion, l’audace de la résistance des dirigeants communistes yougoslaves à Staline et leur choix de l’introduction de l’autogestion sont incompréhensibles si on analyse le PCY comme un « parti stalinien » en ignorant ce que furent son orientation et rôle dirigeant dans l’impulsion des formes organisées et populaires d’une révolution, dont la faucille et le marteau provoquait les messages furieux de Staline.
Dès lors, le « contrat social » entre la population mobilisée et le PCY (pour reprendre les termes de M. Lebowitz) porta sur des enjeux socio-économiques et nationaux, promesses de dignité et de mieux-être sur ces deux plans par rapport au passé et à l’environnement capitaliste, non sans impact populaire de la révolution d’Octobre en Yougoslavie. Les non-dits (sur les projets communistes et les conflits avec Staline) recouvraient l’histoire organiquement conflictuelle de Tito avec le kremlin stalinisé, mais aussi l’espoir légitime des dirigeants yougoslaves d’avoir le soutien du « grand frère » incarnant toujours la « forteresse du socialisme » : toute critique publique envers l’URSS fut réprimée comme « trotskiste » jusqu’à la rupture de 1948. L’auto-proclamation de Tito comme « premier stalinien » du monde et la reproduction du « modèle » soviétique jusqu’en 1948 témoignaient de ces ambivalences.
On les retrouvera dans l’introduction de l’autogestion en 1950, se revendiquant de la Commune de Paris contre Staline tout en réprimant les « kominformiens » prosoviétiques sur un mode stalinien (comme le raconte avec humour le film de Kosturic, Papa est en voyage d’affaire)… De même, furent enterrées les promesses d’auto-détermination faites aux combattants antifascistes albanais soudain prisonniers d’un cadre « yougoslave » après l’arrêt de tout projet balkanique. Pourtant, quand le conflit avec l’URSS s’éloigna, des droits réels autogestionnaires furent étendus au Kosovo où les Albanais connaitront un statut de quasi-république et des droits linguistiques majeurs. Ces ambivalences se manifestèrent dans toutes les réformes introduites du vivant de Tito et Kardelj : elles furent toutes des avancées de droits sociaux (désormais associés de façon spécifique à l’autogestion sur le lieu de travail) et nationaux – ce qui ne dit pas comment ces droits allaient se concrétiser et s’articuler[8]. Et chaque réforme fut introduite et interrompue « par en haut » sans remettre en cause le système de parti unique, malgré son assouplissement, donc en réprimant tout mouvement autonome.
Il est important d’illustrer cela sur la réforme dite du « socialisme de marché » auquel l’autogestion yougoslave est souvent, à tort, réduite[9] mais qui représente un tournant important du système. Elle fut introduite « par en haut » au milieu des années 1960 en supprimant toute planification, après quinze ans de forte croissance. Ses mesures s’inscrivaient dans le « contrat social » à double volets évoqué : augmentation des droits de gestion d’une part (par rapport à ce qu’ils contrôlaient dans la phase antérieure[10]) – mais dans l’horizon borné de l’entreprise : c’est le marché où opérait le nouveau système bancaire qui en devenait le coordinateur. Parallèlement, les droits nationaux étaient également augmentés – par des pouvoirs accrus des républiques et des congrès des Ligues des communistes républicains : les instances fédérales de l’Etat et de la LCY réduisaient leurs pouvoirs dans un système confédératif.
La radicalité de la suppression de la planification et de la réforme marchande est incompréhensible si on la sépare des pressions autogestionnaires contre tout plan perçu comme étatiste[11], et de celles émanant des républiques riches en faveur de plus de confédéralisation du système. Cependant il faut y intégrer un troisième « point de vue » qui va s’incorporer aux deux autres en accentuant leurs ambigüités et tensions. Il se rapporte aux grands débats économiques en cours dans l’ensemble des pays se revendiquant du socialisme dans la phase post-stalinienne, en quête d’une plus grande « productivité », sans mise en évidence de « l’économie politique » (donc des droits sociaux) dans laquelle s’insérait une telle quête.
Dans la première moitié des années 1960 de l’URSS à la Tchécoslovaquie en passant par Cuba, on vit au sein des partis communistes au pouvoir, une montée du poids d’économistes se revendiquant de Marx, comme Charles Bettelheim, ou encore, de façon plus éclectique s’insérant dans la continuité des débats entre Oscar Lange et l’école libérale autrichienne de Hayek. Sans détailler les diverses approches, soulignons ce qui importe ici : ces économistes proposaient des réformes de la planification (sans restauration de la propriété privée capitaliste) élargissant le rôle du marché pour augmenter la productivité et réduire les coûts. Ils estimaient que la recherche d’un « homme nouveau » dévoué à la cause du socialisme ou sensible aux stimulants moraux était une illusion inefficace. Il fallait selon eux introduire des stimulants monétaires marchands en s’appuyant sur les directeurs d’entreprises. Pour tout une partie d’entre eux, se revendiquant de Marx, comme Charles Bettelheim à l’époque du « grand débat cubain » de 1962-63, ces propositions correspondaient à « l’état de développement des forces productives[12] ». Ces intellectuels proches de Louis Althusser, marquant un renouveau de débats contre l’orthodoxie des partis communistes, se rapprochaient d’un maoïsme critique du « khrouchtchevisme[13] » contre les critiques trotskistes du stalinisme[14]. Ils se réclamaient de textes d’Engels ou d’un Marx de la « maturité » qui aurait rompu avec un humanisme naïf de jeunesse. Il en émergerait selon eux l’idée que la conscience des travailleurs, soumise aux contraintes du niveau de développement des forces productives, ne pouvait obéir à des comportements de « socialisation » non marchande de la production[15]. Ces économistes estimant que des rapports marchands dominaient en fait ce qu’on prétendait planifier, ils en concluaient au début des années 1960 que mieux valait de vrais stimulants marchands monétaires.
L’autogestion était absente de ces expériences et débats. Or, elle permettait une avancée majeure de l’expérience et de la réflexion, contre tout « déterminisme » économiciste[16] – l’autogestion avait été introduite dans un pays largement « sous-développé » de la semi-périphérie capitaliste ; et elle avait aidé à un remarquable développement. L’expérience et les différentes phases avaient permis de repenser et enrichir l’opposition du plan et du marché à partir d’un ancrage sur les droits reconnus aux travailleurs par un socialisme autogestionnaire.
Si le rejet de l’étatisme avait marqué le point de départ et l’essentiel des critiques de la première phase du système autogestionnaire, les effets produits par le «socialisme de marché» sous l’angle des droits autogestionnaires mettaient en évidence de nouvelles causes d’affaiblissement de l’autogestion dénoncées dans les luttes : multiplication des grèves contre le non-respect de ces droits par les directions d’entreprise alliées à celles des banques ; protestation contre des logiques inégalitaires non issues du travail fourni ; mouvement étudiant de juin 1968 à Belgrade en défense de principes autogestionnaires égalitaires et non marchands, dans les universités comme dans l’économie, contre les privilèges et les formes de « propriété de groupe », pour une « autogestion de bas en haut »…
[1] Ce texte a été écrit comme introduction à un livre publié en octobre 2017 en Slovénie, regroupant plusieurs de mes articles sur l’expérience autogestionnaire yougoslave, notamment le texte produit en 2010 « pour une appropriation plurielle » de cette expérience, en contribution au congrès de la CNT http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article21299
[2] Branko Horvat (1993), «Requiem For the Yugoslav Economy», https://www.dissentmagazine.org/article/requiem-for-the-yugoslav-economy
[3] « Before World War II, Yugoslavia was extremely underdeveloped. However, because of rapid development, by 1968 Yugoslavia had surpassed the prewar level of production and consumption of the most advanced European countries. From 1953 to 1965, the annual rate of productivity growth was 4,7 %, as compared with that of European capitalist economies (3.3 percent) and statist economies (3 %). Productivity growth was probably the highest in the world during that period. At the same time the relative indices of the basic welfare of the population (life expectancy at birth, education, and health services) were much higher than those of capitalist countries, but also substantially higher than those of welfare states. In fact, around 1971 they were the highest in the world », ibid.
[4] C’est à juste titre ce que met en évidence Michael Lebowitz (2003), Beyond Capital : Marx’s Political Economy of Workers, Londres, Palgrave Macmillan.
[5] Lebowitz A. M. (2012), The Contradictions of «Real Socialism»: The Conductor and the Conducted, New York, Monthly Review Press.
[6] Il faut évidemment discuter dans chaque cas et contexte comment se manifestent les logiques en tensions. Je l’ai fait quant à moi dans mon travail de doctorat portant sur « les logiques contradictoires de l’accumulation yougoslave », publié sous le titre Le marché contre l’autogestion. L’expérience yougoslave (Publisud/La Brèche (1988) ; et j’ai appliqué une approche similaire dans la comparaison des contradictions de la planification de type soviétique, ses réformes (sans autogestion) et les différentes réformes yougoslaves dans Plan, marché et démocratie, l’expérience des pays dits socialistes (1988).
[7] J’ai présenté une discussion de l’approche de Michael Lebowitz dans un exposé en anglais sur ce sujet fait en Slovénie en 2014 à l’Institut d’études sociales, voir https://www.youtube.com/watch?v=s0ADyt8-H7A.
[8] Autrement dit, parler d’avancée de droits n’implique pas qu’ils soient sans contradictions et fragilités.
[9] De 1950 à 1965, l’autogestion était combinée à un plan portant sur les grandes proportions des branches (appuyé sur des fonds d’investissements) ; le « socialisme de marché, sans plan, fut appliqué bien moins longtemps, de 1965 au début des années 1970, des amendements constitutionnels (présentés dès 1971 et finalisés en 1974) remettant en cause cette réforme au profit de la « planification autogestionnaire », dans un contexte de crise.
[10] Le surplus social qui allait aux fonds d’investissement fut distribué entre les fonds des entreprises autogérées et le nouveau système bancaire supposé orienter de façon plus efficace les investissements sur la base de critères marchands ;
[11] On peut trouver sur un site d’archives libertaires, la reproduction (en 2013) d’un article de libertaires yougoslaves datant de 1969 qui incitaient leurs camarades à revoir leur appréciation négative de la LCY et de l’autogestion yougoslave. Voir http://www.la-presse-anarchiste.net/spip.php?article3616. Leur enthousiasme pour ces réformes marchandes reflète largement l’hypothèse attractive mais fausse, que le marché serait favorable à l’autogestion. D’où une approche positive du « socialisme de marché, voire de l’actionnariat marchand des années post-communistes, sans voir que l’un et (surtout) l’autre ont été des pièges destructeurs d’une cohérence autogestionnaire progressiste. Voir ma contribution « pour des bilans pluriels » pour le centenaire de la CNT.
[12] Bettelheim, C. (1971), « On socialist planning and the level of the development of the productive forces », dans Bertram Silverman (éd.), Man and Socialism in Cuba : The Great Debate, New York, Atheneum.
[13] En 1956, Khrouchtchev avait dans son rapport au congrès du PCUS dénoncé bien des crimes de Staline après être venu s’excuser à Belgrade des calomnies de Staline. La Chine de Mao, que Staline avait soutenue, avait adhéré à toutes ses calomnies – donc à la dénonciation de la Yougoslavie titiste comme «pro-impérialiste ». Le rapprochement de Khouchtchev avec un tel pays ne pouvait, selon cette grille de lecture, qu’illustrer le basculement « capitaliste d’État» de l’URSS. Les critères pour « prouver » ce caractère « capitaliste d’Etat » sont éclectiques (politiques ou économiques) et peu cohérents – sauf à réduire tout rapport de domination des travailleurs à du capitalisme ou encore toute utilisation de la monnaie ou de prix et l’absence de « socialisation » réelle et efficace de la production à la « preuve » que domine la « loi de la valeur ». Dans tous ces cas, c’est ne pas affronter ce qui est l’imprévu (marxiste) des rapports (non capitalistes) bureaucratiques, et les possibilités réelles d’utilisation durable (post-capitaliste) de la monnaie et d’un certain marché sans que dominent les rapports marchands.
[14] Elles-mêmes furent éclectiques dans leurs évolutions et analyses de l’URSS stalinisée et des révolutions surgies après Octobre 1917. Pour certains il ne pouvait y avoir de révolution dirigée par des PC après la stalinisation de l’Internationale communiste. Donc il n’y eut pas de « révolution sociale » en Yougoslavie et l’autogestion ne pouvait être qu’un instrument « pro-capitaliste » d’oppression des travailleurs. Pour d’autres, comme l’Internationale dirigée par Ernest Mandel, l’analyse concrète permettait de découvrir les différenciations des PC selon qu’ils refusaient (ou non) de se plier à la « construction du socialisme dans un seul pays » imposée par Staline : tel était le cas yougoslave, et avec un scénario différent de conflit à l’URSS, de la Chine et du Vietnam. L’introduction de l’autogestion fut soutenue (participation aux brigades pour aider le pays à se reconstruire) et étudiée avec beaucoup d’intérêt par les courants proches du « pablisme » et d’Ernest Mandel auxquels je me rattache. Ernest Mandel participa aux réunions internationales organisées par le courant Praxis et partageait sa critique de la double aliénation de l’autogestion par l’étatisme et par le marché, donc en faveur d’une planification autogestionnaire.
[15] Michael Löwy, comme Ernest Mandel, critiqua ces interprétations. Voir notamment Löwy M. (1970), « L’humanisme historiciste de Marx, ou relire le Capital », L’Homme et la société, vol. 17, n°1, 1970, p.111-125, http://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1970_num_17_1_1321. J’évoque ce débat tel qu’il eut lieu à Cuba entre E. Mandel, C. Bettelheim et Che Guevara dans mon article : « Le communisme en mouvement » (2017). Lire aussi Ernest Germain (Mandel): «The Law of value in relation to self-management and investment in the economy of the workers’ states » (1963), https://www.marxists.org/archive/mandel/1963/xx/value-self-man.html#f6 ; et E. Mandel, «Le grand débat économique à Cuba, 1963-1964» (1987), http://www.ernestmandel.org/new/ecrits/article/le-grand-debat-economique-cuba
[16] Signalons que C. Bettelheim a évolué radicalement dans divers sens au cours de cette décennie : il va rompre avec ses positions dans le débat cubain en soutenant la « révolution culturelle chinoise » : celle-ci adoptait avec une grande violence intolérante un « volontarisme » aux antipodes de l’ « économiscisme » en tendant à réduire les conflits et divergences à des conflits de classe capital/travail ; puis C. Bettelheim formulera ses Questions sur la Chine : après la révolution culturelle (Paris, François Maspero 1978), http://chinepop.chez-alice.fr/chinepop/bettelheim1.pdf