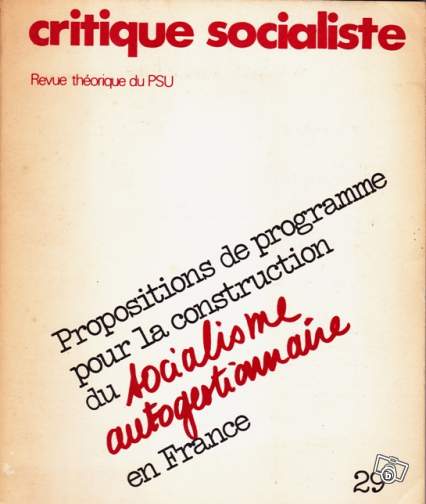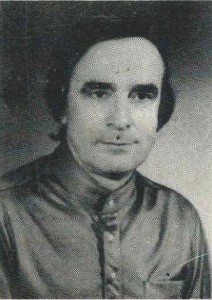L’automation peut-elle permettre la liberté? C’est à cette question que répondait l’article d’Yvon Bourdet que nous publions aujourd’hui. La révolution technologique, écrivait-il à l’instar de Pierre Naville (Vers l’automatisme social ?, 1963, rééd. Syllepse, 2016), «ouvre les possibilités d’un accroissement des moyens de production et d’autodétermination et [permet] d’adjoindre à la critique du Capital, celle des […] labyrinthes […] qui entretiennent la coupure de classe de la société ». Il faut, bien entendu pour que cette révolution débouche sur une révolution émancipatrice que les mouvements sociaux intègrent ces nouvelles données dans leurs programmes et dans leurs pratiques et qu’ils s’emparent des leviers de commande.
L’automation peut-elle permettre la liberté? C’est à cette question que répondait l’article d’Yvon Bourdet que nous publions aujourd’hui. La révolution technologique, écrivait-il à l’instar de Pierre Naville (Vers l’automatisme social ?, 1963, rééd. Syllepse, 2016), «ouvre les possibilités d’un accroissement des moyens de production et d’autodétermination et [permet] d’adjoindre à la critique du Capital, celle des […] labyrinthes […] qui entretiennent la coupure de classe de la société ». Il faut, bien entendu pour que cette révolution débouche sur une révolution émancipatrice que les mouvements sociaux intègrent ces nouvelles données dans leurs programmes et dans leurs pratiques et qu’ils s’emparent des leviers de commande.
Si l’automation, insiste Yvon Bourdet, peut contribuer, « en théorie » à la liberté, « les structures dominantes peuvent [en] fausser les mécanismes à leur profit » et empêcher «un bon usage démocratique » de cet « outil-mystère » à même de « saper la structure hiérarchique ».
L’auteur évoque des régulations nouvelles où systèmes techniques et systèmes sociaux fonctionneraient à la fois en autonomie et en coopération. « C’est le socialisme de l’avenir », écrivait Pierre Naville à la veille de Mai 68. A condition de se saisir des changements, une liberté nouvelle est possible. C’était vrai en 1963, ça l’était encore en 1982, ça l’est encore plus en 2016.
Seconde partie d’un article d’Yvon Bourdet paru dans Critique socialiste (revue du Parti socialiste unifié), n° 42, 1er trimestre 1982.
Lors d’un colloque, organisé à Paris, les 6, 7 et 8 juin 1980, par l’Institut de recherches marxistes, animé par le Parti communiste français, on rappela l’existence, dès 1936, de « comités consultatifs » et, après la Seconde Guerre mondiale et la Résistance, de « comités mixtes à la production » de 1946, qui témoignaient d’un besoin d’« autogestion » (le mot n’était pas usité alors, dans la langue française) et qui, du moins, réalisaient certaines formes de participation.
Assurément, cette participation, qui accroît la productivité, est particulièrement bien appréciée par le patronat, et quelques participants du colloque précité ne manquèrent pas de s’interroger sur les possibilités de « récupération » des mouvements de base autogestionnaires par la classe dirigeante, préconisant un consensus interclassiste que l’on a pu observer en Allemagne fédérale, en Autriche et surtout au Japon. Le patronat français lui-même reconnaissait qu’on « ne dirige plus les hommes d’aujourd’hui comme hier 1 » et, plus explicitement encore, qu’il fallait « intégrer ce qu’il y a de fondamentalement juste dans l’utopie autogestionnaire 2 ».
Il ne s’agit pas, pour le moment, de savoir si une telle « récupération » est possible, si, à mesure qu’elle se développera, elle ne modifiera pas les moyens de production et ne rendra pas les patrons inutiles. Il nous suffit de constater l’échec de la taylorisation, de cette tentative inhumaine d’inclusion du travail des mains dans le mécanisme technologique de la production. L’activité humaine n’a pu être entièrement mécanisée, et les patrons capitalistes ne sont pas les seuls à s’en être rendu compte ; les autorités soviétiques elles-mêmes en sont venues récemment à « produire de l’autogestion » comme le montrèrent plusieurs intervenants du colloque de l’Institut de recherches marxistes. Devant la faible productivité résultant, pour une part, de l’introduction du taylorisme en Russie et de la bureaucratisation sociale, d’autre part, du manque de stimulants individuels (« faire fortune », voyager notamment à l’étranger) les autorités en sont venues à organiser « d’en haut » une sorte de participation, par l’institution de « brigades autogérées ». Ces « brigades » sont des formations contractuelles, instituées, par délégation du parti, pour augmenter le rendement. Il n’y a pas là de véritable autogestion puisqu’il s’agit d’exécuter le plan central, établi par des instances supérieures, ni même, à proprement parler, de cogestion (qui suppose un consensus entre partenaires différents). Les brigades ne sont que des organes d’exécution qu’on a voulu rendre plus efficaces en leur permettant de choisir eux-mêmes les moyens les plus adaptés pour atteindre le but fixé.
On est donc en présence d’une sorte d’autogestion limitée aux modalités de l’exécution. Il n’en reste pas moins que ce recours aux « brigades autogérées » révèle les dysfonctions du système hiérarchique de la bureaucratie. Et cela d’autant mieux qu’à côté de cette autogestion octroyée existe ce que le professeur Frioux, président de l’université de Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, appelle une « autogestion sauvage ». Cette dernière est, pour une large part, clandestine ; elle ne révèle donc point un tournant idéologique du système. Il s’agit principalement, face au système commercial défaillant, d’une économie parallèle non-marchande assurant un minimum de moyens et d’échanges. On ne peut réduire cette « autogestion sauvage » à un trafic individuel ; on se trouve en présence d’expériences partiellement socialisées.
Tous ces comportements, soit dans les usines, soit en dehors (lorsque la distribution des biens et services est elle-même réglementée) témoignent de la résistance humaine à la mécanisation, même si cette dernière se présente comme une organisation efficace parce que déduite de la science. Toutefois l’histoire de notre temps montre que si un certain nombre de petits groupes, pour échapper à l’hétérogestion imposée par la civilisation industrielle, se réfugient, « en amont », dans la vie « naturelle », voire dans la « vie pauvre », ce choix ne peut concerner qu’un petit nombre d’individus. Avec l’accroissement de la population mondiale, le développement de la production des biens s’avère indispensable et donc, en même temps, celui de la science et des techniques. Faut-il en déduire que les dysfonctions que nous venons d’analyser vont s’accroître, ou bien, au contraire, ces difficultés résultent-elles d’une technologie encore imparfaite de telle manière que le salut viendrait, non d’un retour en arrière, vers moins de technologie, mais d’un saut qualitatif, de l’apparition de nouvelles machines cybernétiques, capables de produire, sans intégrer le travail humain dans leur mécanisme ?
Automation et Autogestion
« Si les navettes du tisserand marchaient toutes seules », nous n’aurions pas besoin d’esclaves… mais c’était là, pour Aristote, une hypothèse absurde qui prouvait la nécessité du travail servile. Aujourd’hui, dans certains cas, des machines automatiques et autorégulées produisent des objets sans que la main de l’homme intervienne comme moyen intermédiaire. Cependant ce succès technologique dans l’automatisation n’a pas supprimé la nécessité du travail humain ; il a, au contraire, introduit des perturbations auxquelles la société moderne n’a pas encore su s’adapter.
En théorie et à la limite, une usine automatisée n’aurait pas besoin d’ouvriers, mais ce n’est là qu’une « vue de l’esprit ». Tout d’abord, ces ensembles cybernétiques ne peuvent pas s’autoreproduire. De la sorte, le travail humain a subi un simple « déplacement » en amont et en aval de l’unité de production et, d’autre part, de nouveaux emplois ont été créés, notamment pour la surveillance des machines, et plus précisément pour les arrêter et les remettre en marche après réparation. Ces nouvelles fonctions introduisent un changement fondamental : au lieu d’être un élément d’un engin matériel, l’homme se situe désormais d’une certaine façon en dehors du processus de fabrication et, surtout, dans une position pour ainsi dire dominante, d’examen, de contrôle et d’intervention. Au lieu d’être asservi à la répétition des mêmes gestes, l’ouvrier doit être à l’affût de l’incident, plus ou moins prévisible et y apporter une solution adaptée. Certes, souvent, les accidents se répètent, mais on ignore le moment où ils vont se produire et on se trouve dans une marge d’incertitude qui n’est pas, bien sûr, l’équivalent de la liberté, mais qui a tendance à s’en rapprocher par une certaine indétermination. De plus le travail est « enrichi » car la surveillance est polyvalente, d’autant plus qu’un homme a, presque toujours, plusieurs machines à contrôler. En réalité, dans les premiers temps du taylorisme, les hommes étaient introduits dans le mécanisme de la chaîne parce que les machines n’étaient pas assez perfectionnées pour produire un objet sans intervention humaine dans le processus d’ensemble. Il en résultait une différenciation entre les hommes, selon leur poste dans l’entreprise. Comme les OS (ouvriers spécialisés) étaient des éléments insérés dans la chaîne et, pour ainsi dire, faisaient partie de l’outillage, d’autres hommes (les petits chefs) assuraient la surveillance de leurs « semblables infériorisés ». Non seulement, parfois, l’OS avait ses mains attachées à un élément mobile de la machine (pour éviter les faux mouvements et les accidents) mais il était, de surcroît, surveillé, voire puni par les petits chefs. Le perfectionnement des forces productives par l’automation et l’informatique tend à faire disparaître la domination de quelques hommes sur les autres ; ainsi le « gouvernement des hommes » tend à faire place à l’« administration des choses » par un collectif d’ouvriers informés, ce qui ouvre, tout naturellement, la vie à l’autogestion.
Toutefois, il ne faut pas oublier qu’une telle informatisation ne se trouve que dans les secteurs dits « de pointe » et que les anciennes conditions de travail subsistent dans de nombreux secteurs. De plus, dans un premier temps, l’introduction de machines plus sophistiquées supprime des emplois et crée le chômage de quelques-uns au lieu d’aboutir à une diminution de temps de travail pour tous.
L’OS dont le poste est éliminé ne devient pas, du jour au lendemain, utile à une autre place et la diminution du temps de travail, sans amputation du salaire, est limitée par la concurrence, entre pays inégalement développés, sur le même marché mondial. D’autre part, si, comme on l’a vu, l’automation élimine, pour une bonne part, les petits chefs, elle n’engendre pas, non plus, d’emblée un groupe homogène, composé d’ouvriers d’un haut degré de technicité. L’illusion vient de ce qu’on considère le fonctionnement de l’ensemble automatisé, et non la mise en automation. Pour cette dernière opération, il faut distinguer plusieurs rôles : le projecteur qui conçoit une hypothèse à vérifier ou un objet à produire ; l’analyste qui étudie les moyens de calculs compte tenu des appareils dont il dispose ; le programmeur qui décompose le projet en éléments et le reconstruit suivant un code ; la perforatrice qui prépare les fiches à introduire dans l’ordinateur ; enfin l’opérateur qui met en marche l’ordinateur.
Il est facile de remarquer que ces divers rôles sont subordonnés. Le cas de la perforatrice est particulièrement significatif. Une dactylo qui frappe une lettre ou un article peut comprendre souvent le texte qui lui est confié ; elle veille à l’orthographe, détermine elle-même la présentation, etc. ; une perforatrice frappe un signe après l’autre, sans être en mesure de savoir ce qu’elle fait. Ainsi, dans l’état actuel de la technologie, la mise en service des ordinateurs a créé de nouveaux emplois (il faut donc rectifier l’anticipation rapide qui voyait déjà des « usines sans hommes » ou « presse-bouton ») mais elle n’a pas créé une « nouvelle classe ouvrière » homogène et de haute qualification.
Allant plus loin, quelques-uns prétendent que l’ordinateur, par la rapidité avec laquelle il effectue des calculs très complexes, apparaît, non point tout à fait comme un surhomme, mais comme un « outil-mystère » que l’on utilise sans en comprendre le mécanisme. On ne retrouve donc pas, chez tous les utilisateurs, la transparence qui existe, au niveau de l’artisan, entre le maniement de l’outil et la création de l’objet. Il arrive qu’un chercheur, par exemple, en sciences humaines, commande et commente savamment des calculs statistiques qu’il est incapable de vérifier. Ainsi cette introduction de l’outil-mystère dans le travail restreint, pour beaucoup, les possibilités d’une activité autogérée qui présuppose qu’on puisse se déterminer en toute connaissance de cause.
Telle était bien, d’une façon plus générale, l’objection qui était faite à « l’usine du plan », exposée par Pierre Chaulieu (Cornélius Castoriadis) dans le numéro 22 de la revue Socialisme ou Barbarie.
Au niveau macropolitique ou d’une économie nationale, les décisions sont prises par une minorité dirigeante, voire par un monarque, héréditaire ou élu, et non par l’ensemble du peuple, pour la raison invoquée que ce dernier n’est pas en mesure de juger en connaissance de cause. Chaulieu montrait que la complexité des calculs, maintenant bien maîtrisée par les ordinateurs, n’empêchait aucunement de présenter les diverses options d’une façon claire et accessible à tous. Il suffisait qu’un organisme spécialisé, appelé « usine du plan », étudie les coûts des diverses hypothèses, compte tenu des données de fait : matière première, outillage, main-d’œuvre etc. Cette usine établirait également, non seulement les projets séparés, mais leur comptabilité. Sans entrer, ici, dans les détails de ces calculs, on peut comprendre que les grandes options politico-économiques puissent ainsi être soumises au choix de l’ensemble du corps social, au lieu d’être réservées à quelques ministres ou présidents qui s’approprient la science des experts. Le secret, on le sait, est un des moyens – peut-être le plus ancien, au moment de la découverte de l’écriture – de la domination de classe de prétendues élites sur la masse des hommes. L’usine du plan serait ainsi un « outil-mystère » fonctionnel et à l’usage de tous. La non-compréhension du mécanisme interne d’une automobile n’empêche personne de la conduire, de contrôler sa vitesse, de la mettre en marche ou de l’arrêter. De même, lorsque nous parlons, nous ignorons, presque tous, ce qui se passe dans notre cerveau et dans nos nerfs. Le mystère est partout depuis l’herbe qui pousse jusqu’à l’infinité de l’univers. Ce qu’on peut toutefois éviter, ce sont les secrets artificiels, détenus par une minorité que l’« usine de plan » avait pour fonction de rendre publics.
Plus généralement, l’automation et l’informatique peuvent contribuer, en théorie du moins (car, encore aujourd’hui, les structures dominantes peuvent fausser les mécanismes à leur profit), à ce qu’on pourrait appeler un bon usage démocratique de l’« outil-mystère ». En effet, les dirigeants ne comprennent pas toujours le détail des calculs opérés par les « experts », ils sont ainsi dans la même situation que la plupart des hommes et, parfois, réduits à faire confiance à leurs subordonnés. La structure hiérarchique traditionnelle est ainsi sapée. Autrefois, lorsque le chef donnait un ordre absurde ou simplement erroné, il pouvait, au moment de l’échec, se disculper sur ses agents qui avaient mal compris ses instructions ou qui avaient commis des fautes d’inattention. Lorsque l’ordinateur, aujourd’hui, déduit quasi instantanément les conséquences logiques d’un choix, la bévue du dirigeant est aussitôt exhibée. De plus, en automation, la rapidité de l’exécution des ordres provoque un accroissement de la consommation des décisions. Le champ du décideur devient si vaste que l’on est contraint de décentraliser les décisions et de multiplier les décideurs. On arrive ainsi à un système, comme le réseau téléphonique, avec une intercommunicabilité quasi « horizontale » qui met en connexion toutes les parties de l’ensemble.
Il ne s’agit, certes, par ces brèves remarques, que d’envisager des perspectives. De nombreux problèmes, de multiples difficultés n’ont pu même être évoqués. Mais il semble qu’on puisse comprendre que le développement de la science et de la technique ouvre les possibilités d’un accroissement des moyens de production et d’autodétermination et permette d’adjoindre à la critique du Capital, celle des capitales, ces labyrinthes des secrets d’État qui entretiennent la coupure de classe de la société. En ce sens, l’automation et l’informatique qui, à première vue, apparaissent associer le mécanique et la complication, peuvent devenir, par un contrôle collectif, des moyens pour autogérer de grands ensembles sociaux.
Critique socialiste (revue du Parti socialiste unifié), n° 42, 1er trimestre 1982