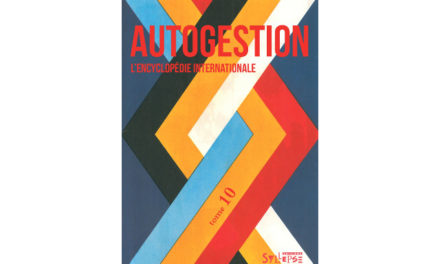Lors des rencontres euro-méditerranéennes de l’Économie des travailleur-ses de 2016, les travailleurs de VioMe ont mis ce point à l’ordre du jour et demandé à ce qu’il soit traité par les travailleur-ses eux-mêmes. En effet, la forme juridique la plus utilisée dans les reprises d’entreprises est la coopérative de travail, une société dans laquelle les travailleur-ses doivent être majoritaires en capital et qui délibère sur la base d’une personne une voix. Pour autant, cette forme juridique reste une forme privée qui n’assure pas toujours une réelle démocratie ouvrière. De même, est-ce qu’une entreprise nationalisée peut appartenir à ce mouvement ? Quelques propositions pour engager un débat qui reste indispensable…
Nous publions ici l’intervention de l’Association Autogestion lors de la première table-ronde des 6e rencontres l’Economie des travailleur-ses qui s’est déroulée du 30 août au 2 septembre à Pigüé (Argentine).
La traduction en espagnol de cette intervention réalisée par Renata Farías de la coopérative Abrapalabra, coopérative qui a assuré la traduction simultanée de l’ensemble de l’événement en espagnol, anglais, portugais et français. Un grand merci à elles-eux.
Une définition trop simple de l’économie des travailleur-ses
Nous partirons d’une définition simple du concept d’économie des travailleur-ses qui voudrait que dans celle-ci, ce soit les seuls travailleur-ses qui contrôlent, déterminent et décident de leur travail. Cette définition constitue en soi une contestation directe du concept de propriété qui veut que ce soit les propriétaires qui décident. Pour autant cette définition laisse ouverte des questions qui méritent des réponses ou, dans l’immédiat, des débuts de réponse qui nous permettront au minimum de dire ce qui n’est pas une économie des travailleur-ses.
La première question qui se pose est celle du rôle des usagers dans une telle économie. Si nous restons dans le domaine de l’économie marchande idéalisée par économistes libéraux, une économie des travailleur-ses peut très bien se passer des usagers dans la mesure où le marché permettrait une validation sociale de la production : les travailleur-ses décident de réaliser une production ; si celle-ci ne trouve pas preneur ou ne permet pas de se rémunérer décemment, c’est qu’elle est inadéquate socialement. Par exemple, si un restaurant autogéré est incapable de trouver une clientèle, c’est que la nourriture proposée est mauvaise ou qu’elle est proposée à un prix qui ne correspond pas à ce que les acheteur-ses attendent.
On pourrait accepter cette hypothèse mais elle se heurte à une objection de taille : le marché idéal cher aux libéraux n’est qu’une vue de l’esprit, certes acceptable dans certains secteurs de la vie économique, mais pas dans la majeure partie. Dans la réalité, de nombreux secteurs de l’économie fonctionnent en monopole ou en oligopole. Si ces secteurs étaient confiés aux seul-es travailleur-ses, on comprend que ceux-ci pourraient abuser de leur position dominante comme le font actuellement les capitalistes. L’intervention des usagers est alors le seul moyen de contrer ce phénomène. Dans la mesure où de nombreux monopoles ou oligopoles capitalistes dominent la vie économique, nous avons pu constater le rôle progressiste que peuvent jouer les usagers dans la contestation du pouvoir du capital et cette revendication est, on ne peut plus, brûlante d’actualité. Une économie des travailleur-ses ne peut donc pas se concevoir sans droit d’intervention des usagers dans la définition de la production sur la base de pouvoirs différenciés à l’égard de ceux des travailleur-ses.
La seconde question porte sur la question du financement qui est à l’origine même du capitalisme. Il ne suffit pas que les travailleur-ses soient en position de décision à l’égard des questions essentielles de définition de la production si ceux-ci ne disposent pas de moyens de financement de leurs investissements. C’est justement cette absence de capitaux qui explique la condition salariale, le fait de devoir vendre sa force de travail pour obtenir une subsistance. On ne peut répondre à cette question en disant simplement que dans l’économie des travailleur-ses, nous serons tous propriétaires de ces moyens de production. Si s’agit que les travailleur-ses de chaque unité de production soient propriétaires de leurs moyens de production, ceci signifie qu’ils devront faire l’effort d’auto-financement et cela ne fera que restaurer les relations capitalistes telles que nous le percevons déjà dans certaines expériences coopératives. Si cette propriété est interprétée au sens collectif, la question alors posée est celle de la méthodologie de mise à disposition des moyens de production auprès des travailleur-ses, ce qui laisse entendre qu’à un moment donné, il y a bien une dualité de pouvoir entre les travailleur-ses, d’une part, et le ou les représentant-es de la propriété collective, d’autre part.
On comprend qu’on ne peut se limiter à cette seule définition qui voudrait que ce soit les seuls travailleur-ses qui contrôlent, déterminent et décident de leur travail. Notre objectif n’est pas de définir ce que sera demain une économie des travailleur-ses mais de rechercher dans les formes de lutte actuellement utilisées, ce qui peut participer d’un mouvement « l’Économie des travailleur-ses » et ce qui doit être rejeté.
La coopérative de travail, une forme hybride
La coopérative de travail est une coopérative dans laquelle les travailleur-ses sont membres, à la différence des nombreuses coopératives d’usagers : coopérative d’habitat, coopérative de consommation, coopérative bancaire… C’est d’abord une coopérative, c’est-à-dire une forme juridique qui rompt partiellement avec la logique du capital. À l’inverse des entreprises traditionnelles (société de capitaux) dans lesquelles les actionnaires sont réunis pour faire toujours plus d’argent avec de l’argent, dans les coopératives, le capital est au service de l’objet social. Ceci a deux conséquences pratiques : la rémunération du capital est limitée – parfois nulle – ouvrant la voie à la formation de réserves impartageables, et la délibération se fait sur la base d’une voix par personne et non par action détenue. Le fait que, dans cette forme de coopérative, ce sont les travailleur-ses qui sont membres ouvre la voie au concept d’Économie des travailleur-ses.
Il y a cependant plusieurs obstacles qui s’ouvrent sur une telle réalité. Le premier a trait à la structure du capital qui, même second, reste privé. L’expérience nous a montré que le capital a tendance à réapparaître au premier plan notamment en cas de succès de la coopérative. L’expression la plus achevée de ce phénomène est la constitution de filiales de coopératives dans lesquelles les travailleur-ses sont désormais en position de salariés des coopérateurs de la maison-mère. La notion même de filiale réintroduit les rapports de propriété.
Un autre problème lié au caractère privé du capital coopératif est que seuls, les travailleur-ses qui sont membres de la coopérative participent à la gestion de l’entreprise. Est-ce que les membres représentent bien la majorité des travailleur-ses présents ? Est-ce que tout travailleur-se peut accéder librement et à un prix raisonnable au sociétariat ? La législation varie suivant les pays et autorise parfois que des non-travailleur-ses puissent accéder au sociétariat. Qui sont alors ces membres extérieurs ? Des amis de la coopérative ? Des usagers ? Des financiers qui apportent des fonds ? Si oui, s’agit-il d’une finance traditionnelle qui cherche à extraire des profits de sa présence au sociétariat ou s’agit-il de financiers solidaires dont la motivation est le développement d’une économie alternative au capitalisme ?
Dans le même esprit, sont récemment apparus les coopératives multi-collèges – par exemple coopératives de solidarité au Québec ou coopératives sociales italiennes – répartissant les membres en catégories parmi lesquelles on retrouve souvent les travailleur-ses et les usagers. Si, comme nous l’avons vu, nous sommes favorables à l’intervention des usagers dans la gestion, quels sont les garde-fous dans une structure de type multi-collège pour que l’expression des travailleur-ses ne soit pas marginalisée ?
L’actionnariat salarié
Dans de nombreux pays, les propriétaires d’entreprises privées cherchent à développer des plans divers permettant aux salarié-es de devenir actionnaires. L’objectif de ceux-ci est de tenter de faire coïncider les intérêts des salarié-es avec ceux des actionnaires. Dans la majeure partie des cas, ces plans ne permettent que de réserver un pourcentage extrêmement réduit du capital aux salarié-es. Très souvent, il permet d’associer l’encadrement aux objectifs des propriétaires contre la majeure partie des salarié-es.
Tout ceci indique que l’actionnariat salarié ne peut pas faire partie de l’économie des travailleurs. Il arrive cependant que des salarié-es parviennent à être majoritaire dans une société de capitaux. Cela n’en fait pas une coopérative et les règles du capital continuent de s’exercer. Sous quelles conditions pourrions-nous considérer que cette entreprise fait partie de l’Économie des travailleurs ?
Les entreprises publiques avec participation des travailleurs ou contrôle ouvrier
Nous entendons ici par entreprise publique toute entreprise détenue par l’État. Ceci suppose donc que nous considérons que l’État est raisonnablement démocratique pour qu’on puisse considérer qu’il s’agit d’une entreprise qui appartient au « public ». Ceci signifie aussi que la propriété de l’État soit totale sur cette entreprise, qu’il n’y ait pas d’intérêts privés dans le capital qui conditionnerait l’État à gérer cette entreprise dans une optique de valorisation du capital. Mais une fois ceci acté, la propriété publique ne signifie nullement que cette entreprise fasse partie de l’Économie des travailleurs.
Depuis de nombreuses années, divers groupes politiques revendiquent des nationalisations sous contrôle ouvrier, à savoir un transfert de propriété à l’État dans lequel les travailleur-ses assureraient la gestion ou disposeraient au minimum d’un droit de veto sur les décisions prises par le représentant de l’État. Est-ce une formule fiable dans le temps ? Au travers de ce concept, la notion même de propriété reste inchangée : l’État propriétaire s’est substitué à l’actionnaire privé. Il peut déléguer la gestion aux travailleur-ses ou leur concéder un droit de veto mais au final, en tant que propriétaire, il aura toujours le dernier mot. Peut-on dès lors considérer que ces entreprises font partie de l’Économie des travailleur-ses et si oui, sous quelles conditions ?
Par ailleurs, des gouvernements plus ou moins progressistes nationalisent parfois des entreprises au nom de la protection de l’emploi ou des intérêts stratégiques du pays. Quelles sont alors nos exigences pour que ces entreprises s’inscrivent dans le processus de l’économie des travailleurs ?
Au final, la question de la propriété
Pendant longtemps, la propriété collective des moyens de production a été l’objectif des forces de la transformation sociale. La collectivité n’a jamais pu être clairement définie. S’agit-il d’un collectif de travailleurs ? S’agit-il d’un État ? Quelle que soit l’échelle choisie, la notion de propriété est en soi excluante à l’égard de ceux qui ne font pas partie de la collectivité. Par ailleurs, la taille même de la collectivité impose de nommer des représentant-es de celle-ci qui ont tendance à confisquer le pouvoir contre la collectivité elle-même.
L’innovation essentielle de l’économie des travailleur-ses est de nier la propriété en considérant que ce sont les acteurs qui doivent être en position de co-décider. Ceci suppose d’articuler le pouvoir entre travailleur-ses et usagers. Cette négation de facto de la propriété pose aussi la question du financement des actifs mis à la disposition des travailleur-ses. C’est en ayant en vue ces questions que nous serons en mesure de définir, étape après étape, ce qui peut rentrer dans le cadre de l’Économie des travailleur-ses envisagée en tant que processus.