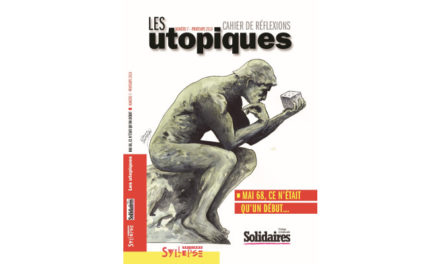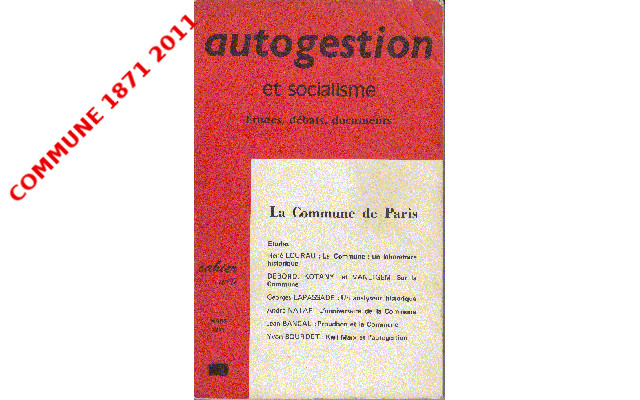
Le mot autogestion n’est guère d’usage courant que depuis une dizaine d’années et il paraît bien anachronique de le juxtaposer au nom de Marx (1). Toutefois – pour que ceux qui l’ignoreraient n’aillent pas imaginer que nous allons nous livrer à je ne sais quel exercice scolastique de rapprochement artificiel du genre : « que penserait aujourd’hui Platon de la télévision ? » – précisons d’emblée que si Marx n’emploie pas le mot autogestion il s’intéresse (nous le prouverons par de nombreux textes) à ce que ce mot désigne et qu’on appelait alors « les coopératives de production».
Certes, le fait que ce terme (autogestion) n’ait apparu que récemment ne manque pas de signification. Il témoigne, bien sûr, pour une part, de l’ignorance du passé et on peut comprendre que certains anarchistes, fouriéristes ou proudhoniens, par exemple, s’irritent de ce que beaucoup de « conseillistes » ou « d’autogestionnistes » croient avoir trouvé quelque chose de nouveau avec un nouveau mot. Il n’en reste pas moins, en revanche que le besoin d’une nouvelle terminologie marque au moins le souhait d’une démarcation d’avec les doctrines existantes. Même si, maintenant, la plupart des anarchistes se montrent soucieux d’action de masse et des moyens économiques de transition, pour beaucoup, à tort ou à raison, le terme d’anarchisme évoque davantage la volonté de détruire les pouvoirs en place que l’essai de construire, au niveau national ou international, une organisation d’un type nouveau. Au plan politique, leur action apparaît surtout négative et leurs tentatives de réalisations positives semblent se borner au rassemblement libre de petits groupes qui cherchent à réaliser, d’une façon marginale, « une hausse immédiate du jouir». Il ne s’agit pas là, pour autant, toujours, de la quête d’un salut égoïste ; ils croient être des ferments ou les « détonateurs » de la révolution universelle ; mais leur démarche, fût-elle « exemplaire», demeure l’activité de quelques pionniers.
Le terme d’autogestion, au contraire, semble désigner une organisation plus large, plus technique et qui, en tout cas, est liée plus à la production qu’à la jouissance. Ainsi, la revendication de l’autogestion paraît plus proche du projet des marxistes, bien que se creuse entre eux, aux yeux de presque tous, un abîme quasi infini, car on entend ordinairement par « autogestion » la concertation des autonomies, et par « marxisme » le trop fameux centralisme démocratique de Lénine que ses dysfonctions, depuis plus de cinquante ans, ne mettent aucunement en question puisque tous les vices du système sont inlassablement expliqués par les prétendus défauts de la personnalité des dirigeants. Même ceux qui acceptent de dissocier le marxisme du stalinisme, du léninisme ou du trotskisme n’en persistent pas moins à estimer que les appels que fait Marx à la « violence accoucheuse de l’histoire » et à « la dictature du prolétariat » sont incompatibles avec les méthodes et les buts des partisans de l’autogestion.
Pour y voir clair, il est donc nécessaire de décaper les textes de Marx de l’épaisse crasse accumulée non point tant par les gloses des théoriciens que par l’effet des « retombées » – un demi-siècle durant – de la praxis des partis communistes prétendant incarner la théorie de Marx. Ce que nous proposons est donc bien, comme d’autres, une relecture, mais non pas pour projeter,entre les lignes, ce que Marx n’a pas écrit. C’est au contraire, pour donner ou redonner à voir les textes oubliés, négligés, rejetés ou simplement jamais lus.
Les moyens de la révolution selon Marx
L’œuvre de Marx est une critique de la société capitaliste et sa vie une lutte pour hâter l’heure de l’expropriation des expropriateurs. Toutefois, pour beaucoup le passage de la critique théorique à l’action politique fait problème : dans le chapitre XXXII du livre premier du Capital, on peut lire : « la production capitaliste engendre elle-même sa propre négation avec la fatalité qui préside aux métamorphoses de la nature » (2). Par là, d’ailleurs, il ne faisait que reprendre la conclusion de la première partie du Manifeste communiste qui donnait pour « inévitable l’élimination de la bourgeoisie et le triomphe du prolétariat » (3 ). Dès lors le « Que faire ? » semble dénué de sens comme on l’a souvent noté : « les marxistes qui annoncent l’avènement inéluctable du régime post capitaliste font penser à un parti qui lutterait pour provoquer une éclipse de lune» (4). De même Lénine mettait dans la bouche des populistes des années 1894- 189 5 cette réflexion : « Si les marxistes considèrent le capitalisme en Russie comme un phénomène inévitable( … ), il leur faut ouvrir un débit de boisson … » (5). Cette «objection» n’avait pas échappé à Marx qui l’avait lui-même introduite à titre de canular (6) dans un brouillon d’article sur Le Capital qu’Engels devait se charger de faire publier, sous un nom d’emprunt, dans un journal dirigé par Karl Mayer : « Quand il (Marx) démontre que la société actuelle ( … ) porte en elle les germes d’une forme sociale nouvelle supérieure, il ne fait que montrer sur la plan social le même procès de transformation que Darwin a établi dans les sciences de la nature ( … ). L’auteur a, du même coup, ( … ) peut-être malgré lui (souligné par Marx) sonné le glas de tout le socialisme professionnel… » (7). La « réfutation » de cette « objection » se trouvait déjà dans la préface du Capital lorsque Marx expliquait qu’une société qui était arrivée « à découvrir la piste de la loi naturelle qui préside à son mouvement (souligné par Marx)( … ) ne peut ni dépasser d’un saut ni abolir par des décrets les phases de son développement naturel, mais peut abréger la période de la gestation et adoucir les maux de leur enfantement » (8). On trouve là le thème célèbre de la violence conçue comme la force « accoucheuse de toute vieille société en travail (9), ou comme dit la vulgate de la violence accoucheuse de l’histoire. De ce fait, précise Marx « la force est un agent économique ». C’est donc aplatir « le marxisme » que de le réduire soit à une action politique qui ignorerait les phases du développement naturel, soit à !’économisme béat du laisser-faire. Certes la force ne peut « faire tourner à l’envers la roue de l’histoire » ( l 0), mais les communistes n’en déclarent pas moins « ouvertement qu’ils ne peuvent atteindre leurs objectifs qu’en détruisant par la violence l’ancien ordre social » (l l ). On retrouve ainsi la question fameuse et controversée de la « dictature du prolétariat ». On sait que Kautsky, pour critiquer les bolcheviks, affirma que Marx n’avait, pour ainsi dire, jamais préconisé une telle dictature, qu’il s’agissait là d’un « petit mot », écrit, « en passant », dans une lettre (12). En fait, Marx a parlé plusieurs fois du rôle et de la nécessité d’une telle dictature (13 ), mais la simple recension et comptabilité des textes ne sert pas à grand chose si on ne s’entend pas sur le sens, chez Marx, du mot « dictature ». Dans une note du 20 octobre l 920, Lénine caractérise la dictature comme un pouvoir qui ne reconnaît « aucun autre pouvoir, aucune loi, aucune norme, d’où qu’ils viennent ( … ) le pouvoir illimité, extra-légal, s’appuyant sur la force, au sens le plus strict du mot, c’est cela la dictature» ( 14). Et c’est une telle dictature que doit exercer le prolétariat, qu’il soit minoritaire ou majoritaire dans la nation. Max Adler, au contraire, distingue soigneusement entre « dictature majoritaire » et « dictature minoritaire » ( 15) : lorsqu’une minorité opprime une majorité, on est en présence du despotisme que Marx a toujours combattu, sous toutes ses formes ; si Marxpréconise la dictature du prolétariat c’est parce qu’elle ne peut pas être autre chose que la force de la majorité : « Tous les mouvements du passé ont été le fait de minorités ou ont profité à des minorités. Le mouvement prolétarien est le mouvement autonome de l’immense majorité dans l’intérêt de l’immense majorité » ( 16). Pour Marx, la révolution prolétarienne sera la dernière possible ; en effet, lorsque le prolétariat, classe universelle, aura pris le pouvoir, il n’y aura bientôt plus de classes et par conséquent plus de luttes entre elles : « L’ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses conflits de classes, fait place à une association où le libre épanouissement de chacun est la condition du libre épanouissement de tous » ( 17). Notons, en passant, que Marx donne ainsi la définition exacte d’une société autogérée. Quant aux voies et moyens du passage à cette domination immensément majoritaire du prolétariat, ils seront variables selon les circonstances ; la violence, nous l’avons vu, sera souvent nécessaire mais’ pas toujours ; dans son discours du 8 septembre 1872 aux ouvriers d’Amsterdam, Marx déclara que « l’Amérique et l’Angleterre (pouvaient) arriver au socialisme par des moyens pacifiques » (18). Dans la préface à l’édition anglaise du Capital, en 1866, Engels assure que ce ne fut pas là une déclaration de circonstance et que Marx avait exprimé sa véritable pensée. D’ailleurs, Engels écrivit lui-même, un peu plus tard (1891), que l’on « peut concevoir que la vieille société pourra évoluer pacifiquement vers la nouvelle dans les pays où la représentation populaire concentre en elle tous les pouvoirs » et même, plus explicitement, que « la république démocratique( … ) est la forme spécifique de la dictature du prolétariat » (19). Précisant sa pensée, dans l’introduction, écrite en 1895, aux Luttes de classes en France, Engels affirmait que l’usage illégal de la force armée n’était plus un bon moyen pour le prolétariat de s’emparer du pouvoir et que même « la bourgeoisie et le gouvernement » en étaient un peu arrivés « à avoir plus peur de l’action légale que de l’action illégale du parti ouvrier » (20). Ce disant, Engels avait sans doute donné trop d’importance à la déclaration célèbre d’Olidon Barrot : « La légalité nous tue ! » et à l’expérience de la Commune de Paris qui s’était terminée par une catastrophique saignée du prolétariat. Son point de vue fut ensuite assez généralement contesté par les marxistes (21).
Quoi qu’il en soit, il reste de la lecture de tous ces textes que Marx et Engels n’ont pas toujours maintenu la même théorie en ce qui concerne les moyens de passage au socialisme et mieux qu’ils ont soutenu explicitement qu’il fallait s’adapter aux circonstances. Cela ne veut point dire qu’il suffise pour eux d’attendre, comme nous l’avons déjà rappelé et comme la polémique de Marxcontre Bakounine l’a bien montré. Il ne s’agit pas ici de traiter à fond de la comparaison entre marxisme et anarchisme (22), mais seulement dans la perspective de la présente mise au point. Ce qui nous occupe, en effet, est de préciser comment Marx conçoit la société, une fois brisée l’oppression capitaliste, et par quels moyens on peut hâter cette libération. Or, les notes écrites en 1874 par Marx, en marge du livre de Bakounine : Étatisme et anarchie sont, à ce propos, très éclairantes (23). A partir de ces notes, on peut restituer le dialogue suivant (sans changer un mot, naturellement, au texte de l’un et de l’autre) :
Bakounine. – «Les Allemands sont environ 40 millions. Tous les 40 millions, par exemple, seront-ils membres du gouvernement ? »
Marx. – « Certainly ! Car la chose commence par le self-governmentde la commune ».
Bakounine. – ,« Alors, il n’y aura pas de gouvernement, pas d’État, mais, s’il y a un État, il y aura des gouvernants et des esclaves (…) Ce dilemme dans la théorie marxiste se résout facilement. Par gouvernement du peuple, ils (les marxistes – non ! interrompt Marx, c’est Bakounine qui le prétend) entendent le gouvernement du peuple à l’aide d’un petit nombre de dirigeants élus par le peuple ».
Marx. – « Ane ! c’est du verbiage démocratique, du radotage politique ! L’élection est une forme politique (…) qui dépend ( … ) des rapports économiques entreles électeurs ; aussitôt que les fonctions ont cessé d’être politiques :
- il n’existe plus de fonction gouvernementale ;
- la répartition des fonctions générales est devenue une chose de métier et ne confère aucun pouvoir ;
- l’élection n’a rien du caractère politique actuel ».
Bakounine. – « Le suffrage universel par tout peuple… »
Marx. – « Tout le peuple au sens actuel du mot est une pure chimère ».
Bakounine. – « La notion de « représentants du peuple » constitue « un mensonge sous lequel se cache le despotisme de la minorité gouvernante (souligné par Bakounine) d’autant plus dangereuse qu’elle apparaît comme l’expression de la soi-disant volonté du peuple ».
Marx. – « Sous la propriété collective, la soi-disant volonté du peuple fait place à la volonté réelle du coopératif».
On voit bien, par ce dialogue, que, s’agissant des buts ultimes, Bakounine fait une mauvaise querelle à Marx ; ce dernier admet fort bien que l’organisation sociale par des techniques d’autogestion (coopératives) relève d’un métier mais ne confère aucun pouvoir. Il faut cependant reconnaître à Bakounine une vision prophétique, car malgré les dénégations de Marx, les marxistes-léninistes ont – par le centralisme démocratique – réalisé exactement les funestes prédictions de Bakounine : « despotisme d’une minorité d’autant plus dangereuse qu’elle apparaît comme l’expression de la soi-disant volonté du peuple ». D’autre part, Marx reste indirectement la cause de la déformation bolchevique par sa théorie de l’étape de transition. Si, en effet, ce qu’il faut viser c’est l’auto-gouvernement de la société dans son ensemble et si de ce fait, comme écrit Marx dans la même note sur Bakounine : « l’État populaire de Liebknecht ( … ) est une ineptie», il n’en reste pas moins que le prolétariat selon Marx, « durant la période de la lutte pour le renversement de l’ancienne société, agit encore sur la base de cette ancienne société et, par conséquent( … ) durant cette période de lutte, il emploie pour son affranchissement des moyens qui disparaîtront après cet affranchissement ». Ce sont ces moyens – imposés par la société de classe et prétendument provisoires – que Bakounine refuse prudemment, car, sous prétexte de libérer le prolétariat de la domination bourgeoise, on institue une nouvelle domination politique, en un sens, pire que la précédente. Alors que faire ? Selon Marx, voici la réponse de Bakounine : « De là, M. Bakounine conclut qu’il doit plutôt ne rien faire du tout… qu’il doit attendre le jour de la liquidation générale (souligné par Marx), le jugement dernier». Il va sans dire que Bakounine, à son tour, crierait au scandale devant cette « déduction » de Marx (24 ). Ce sont là les lois de la polémique. Ce qui nous intéresse seulement ici, c’est la contradiction soulignée par Bakounine entre le but ultime de Marx (société homogène sans classe) et les moyens impurs qu’il croit indispensables d’utiliser pour briser la machine oppressive de la bourgeoisie. Les colombes ne peuvent ni convaincre ni vaincre les vautours, si, dans un premier temps, elles n’attaquent les vautours avec la violence des vautours. Celui qui garde ses mains blanches n’a pas de mains. Marxse place ainsi à l’opposé de l’axiome évangélique : les doux posséderont la terre qui a été repris par les partisans actuels de la non-violence, ceux qui n’ont d’armes que de fleurs (amour et paix) ou qui, réunis autour du Pentagone, espéraient le faire sortir de terre par leurs pensées associées dans la foi qui soulève les montagnes. Ce sont là, dira-t-on, de gentils rêveurs, mais il reste que Marx n’était pas, non plus, satisfait par l’obligation politique de lutter contre les bourgeois avec des armes semblables aux leurs. C’est pourquoi, d’ailleurs, il ne préconisait pas exactement une telle imitation.
li ne voulait pas que son « parti » fût un parti comme les autres, ni son action un ensemble de petites ruses mijotées dans le secret des appareils « directeurs ». Les travailleurs devaient, selon Marx, autogérer leurs luttes. C’est un thème constant qui affleure, à intervalles, dans ses écrits et dans ses actes. Qu’on en juge par ces brefs rappels : en 1848, « le mouvement prolétarien est le mouvement autonome de l’immense majorité » (25) ; en 1864, « l’émancipation de la classe ouvrière doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes» (26) ; en 1866 « l’œuvre de l’Association internationale est de généraliser et d’unifier les mouvements spontanés de la classe ouvrière, mais non de leur prescrire ou de leur imposer un système doctrinaire quel qu’il soit » (27) ; en 1868 « l’Association internationale des travailleurs (…) n’est fille ni d’une secte ni d’une théorie. Elle est le produit spontané du mouvement prolétaire » (28) ; en 1871, après la Commune, « ce serait méconnaître complètement la nature de l’Internationale que de parler d’instructions secrètes venant de Londres (…) de quelque centre pontifical de domination et d’intrigue (…). De fait, l’Internationale n’est nullement le gouvernement de la classe ouvrière, c’est un lien, ce n’est pas un pouvoir » (29). Le 17 septembre 1879 : « Nous avons formulé, lors de la création de l’Internationale, la devise de notre combat : l’émancipation de la classe ouvrière sera l’œuvre de la classe ouvrière elle même. Nous ne pouvons, par conséquent, faire route commune avec des gens qui déclarent ouvertement que les ouvriers sont trop incultés pour se libérer eux mêmes, et qu’ils doivent être libérés par en haut, c’est-à-dire par de grands et petits bourgeois philanthropes » (30).
Marx n’a jamais voulu être à la tête d’un parti partisan qui ne représenterait qu’une partie de la classe ouvrière ; dès 1848, il précisait : « Les communistes ne forment pas un parti distinct en face des autres partis ouvriers. Ils n’ont pas d’intérêts distincts de ceux du prolétariat dans son ensemble » (31 ). Dans une lettre à Freiligrath, Marx ajoute : « sous le vocable parti, j’entends parti dans le grand sens historique », c’est-à-dire la cause de l’ensemble du prolétariat. Il s’agit non de parader sur des estrades ou dans des meetings, mais de comprendre, de faire comprendre et, par là, de hâter le mouvement historique de la société de classe vers son dépassement. Les parlottes et les petites intrigues de la vie politique des partis ont toujours déplu à Marx ; comme il l’écrivait à Engels, le 11 février 1851, il était irrité d’être ainsi amené à avaliser indirectement des prises de position, à se sentir lié par des déclarations « d’ânes » et à en porter le ridicule. Deux jours plus tard, le 13 février 185 l, Engels répond : « nous avons l’occasion de montrer que nous n’avons besoin ni de popularité ni du « support » d’un parti quelconque ( … ). Comment des gens comme nous, qui fuyons comme la peste des situations officielles, pourrions-nous être d’un parti ? Que nous chaut un parti, à nous qui crachons sur la popularité ? ». On ne veut souvent voir, dans ces lettres, que le signe d’une irritation passagère. La preuve, dit-on, que ce ne sont là qu’accès de mauvaise humeur, c’est que Marx a adhéré ensuite, en 1864, à l’Association internationale des travailleurs. Justement, voici ce qu’en pense Marx, dans une lettre à Engels, du 26 décembre 1865: « Quant à l’Association internationale, elle me pèse tel un incube et je serais content de pouvoir m’en débarrasser ». Marx n’assiste pas au congrès de Bruxelles de 1868, pensant être plus utile à la classe ouvrière en continuant son œuvre théorique. Il appliquait ainsi la consigne donnée par Engels, dix-sept ans plus tôt : « l’essentiel est de nous faire imprimer » (32). Il ne viendra à l’esprit de personne que, ce disant, Marx ou Engels visaient une gloire littéraire quelconque. Mais le mouvement autonome de l’émancipation prolétarienne est, en même temps, une prise de conscience et cette dernière devient aussitôt un facteur complémentaire du mouvement d’émancipation. Certes, « l’arme de la critique ne saurait remplacer la critique par les armes, la force matérielle doit être renversée par la force matérielle. Mais la théorie se change, elle aussi, en force matérielle, dès qu’elle saisit les masses » (33).
C’est donc sur les lieux de travail mêmes que les ouvriers doivent comprendre concrètement les modalités de l’exploitation de leur force de travail par la classe dominante. Le rôle du théoricien est de leur rendre visible cet invisible quotidien comme Galilée a expliqué le mouvement apparent du soleil, ébranlant du même coup, à jamais, la mythologie religieuse antérieure. Qui ne comprend, dès lors, que pour Marx, militer n’est pas jouer au stratège dans les états majors du comité fédéral ou du comité central, avec la prétention de commander, de l’extérieur, la manœuvre. Ce sont les travailleurs qui sont seuls capables non seulement d’organiser, d’autogérer leurs luttes, mais aussi d’instaurer, au sein même de l’ancienne société, les structures nouvelles d’une coopération égalitaire et fraternelle qui n’a que faire de chefs ni de dirigeants. Dans son Speech on the Anniversary of the Peopel’s Paper, le 19 avril 1856, Marx faisait remarquer que les révolutions résultent davantage de causes économiques et des découvertes scientifiques et techniques que de l’action de soi-disant « meneurs » ; il disait, en effet : « Vapeur, électricité et machine à tisser avaient un caractère autrement dangereux que les citoyens Barbès, Raspail et Blanqui eux-mêmes » (34). Quinze ans plus tard, à Kugelmann qui contestait, dans une lettre du 15 avril 1871, l’opportunité de l’insurrection de la Commune parce que la défaite priverait « de nouveau les ouvriers de leurs chefs », Marx répondit, le 17 du même mois : « La démobilisation de la classe ouvrière aurait été un malheur bien plus grand que la perte d’un nombre quelconque de « chefs ». (Marx met lui-même entre guillemets le mot chef.) Ainsi on ne peut insister davantage que Marx ne le fait sur les capacités d’auto-émancipation de la classe ouvrière qui peut, non seulement autogérer son combat, mais autogérer la production,ce qui est de surcroît le moyen le plus radical de supprimer l’aliénation et l’exploitation. Ainsi, dans cette dialectique, la réalisation du but final ne se sépare pas de la mise en œuvre de moyens spécifiques de l’atteindre. L’autogestion des luttes est une condition de l’autogestion de la production et réciproquement. Certes cette conquête de l’autonomie active ne peut être que progressive et impure comme Marx l’expliquait à Bakounine, mais la tâche du révolutionnaire est d’éclairer cette entreprise, d’y « coller» et de s’y coller. Aussitôt que l’organisation à prétention libératrice devient une sorte d’institution extérieure, qui fonctionne en tant qu’instrument de lutte pour les ouvriers au lieu d’être une ébauche d’organisation nouvelle de la production elle-même, Marx s’en désintéresse et souffre d’en faire partie. Il n’y a même pas à distinguer entre autogestion des luttes et autogestion de la production car ces deux formes d’émancipation se conditionnent réciproquement.
Mais on dira, peut-être, que ce ne sont là que déductions à partir du « montage habile »de quelques textes. Il faut donc voir, plus précisément ce que Marx dit lui-même du fond du débat puisque aussi bien il l’a abordé dans un assez grand nombre de textes que les interprétations des divers appareils des partis politiques marxistes ont laissés dans l’ombre.
Le mouvement coopératif et Marx
Les lecteurs trop parcellaires de l’œuvre marxienne s’en tenant à la critique du socialisme et du communisme utopiques de la troisième partie du Manifeste communiste, concluent facilement que Marx a condamné toute anticipation intellectuelle d’une autre société, qu’il s’est cantonné dans l’analyse scientifique de la société capitaliste de son temps. Comme d’autre part Fourier et Owen sont cités parmi ces «utopistes» et que le mouvement coopératif, et, aujourd’hui, le mouvement autogestionniste les revendiquent parmi d’autresétait hostile aux coopératives et par conséquent à l’autogestion. Voyons plus précisément et textes à l’appui ce qu’il en est réellement.
Il faut d’abord observer que, dans la critique même du Manifeste communiste, la condamnation des utopistes est loin d’être sans nuances (35). Marx explique d’abord « l’ascétisme universel » rétrograde et « l’égalitarisme vulgaire » des premiers écrits (de Babeuf par exemple) par le fait que le prolétariat « se trouvait encore dans un état embryonnaire et que faisaient défaut les conditions matérielles de son émancipation (36). Ainsi ce que Marx dénonce, ce n’est point la prévision en tant que telle mais son exercice individuel et dans de mauvaises conditions, ce qu’on pourrait appeler la suppléance : qu’on veuille, par des « interventions personnelles » tirer de son imagination « ce que le mouvement social ne produit point ». C’est la première forme de ce « substituisme » que Rosa Luxemburg et Trotsky reprocheront à l’auteur de Que faire ? . Au lieu d’épouser les formes spontanées de la lutte ouvrière concrète, ils échafaudent des plans ou, comme dit Marx, « à l’organisation graduelle et spontanée du prolétariat en classe, ils veulent substituer leur fiction d’une organisation de la société ».
Qui ne voit que cette critique des « utopistes » porte tout aussi bien, sinon mieux, contre certains activistes actuels qui se croient porte-parole révolutionnaires de la classe ouvrière haranguée aux abords des usines ; ils comme pionniers, on a vite fait de déduire que Marx ressemblent fort à ceux que Marx appelait les « alchimistes de la révolution » qui « improvisent une révolution sans les conditions d’une révolution » (37).
En second lieu, la critique de l’utopisme dans le Manifeste communiste, Marx le précise bien, s’adresse moins aux auteurs des systèmes utopistes qui « étaient encore révolutionnaires » qu’à « leurs disciples qui ne forment plus, en revanche, que des sectes réactionnaires ». Au lieu d’étudier et de suivre « l’évolution historique du prolétariat, ils s’accrochent aux vieilles conceptions de leurs maîtres ». Marx dénonce vigoureusement leur marginalisme, et, encore une fois, sa critique ne concerne pas seulement les groupes du dix-neuvième siècle, lorsqu’il note que, pour vivre leurs rêves, « ils sont forcés de faire appel à la charité des cœurs et des bourses de la bourgeoisie » ; même si parfois, aujourd’hui, l’appel aux bourses n’est pas, en même temps, un appel aux cœurs, il reste qu’ils mènent une existence parasitaire et qu’ils se nourrissent souvent de miettes ou de larcins aux dépens de la société de consommation qu’ils vitupèrent. Le plus grave est qu’on peut légitimement se demander comment ils pourraient subsister autrement ; ils survivent dans la mesure où leur critique radicale reste économiquement insignifiante. Marx observe encore qu’ils « s’opposent avec acharnement à tout mouvement politique des travailleurs » qui leur paraît inspiré par « un aveugle manque de foi ». En bref, ce que Marx refuse c’est l’obstination du rêve dogmatique sans lien sérieux avec les données historiques. En revanche cette étude attentive de la réalité sociale, Marx est loin de souhaiter qu’elle reste bornée à une description factuelle à courte-vue. Il faut savoir mettre en perspective les données, discerner l’envers du décor. A ce titre, les écrits des prétendus utopistes « renferment aussi (précise Marx, toujours en cette troisième section de la troisième partie du Manifeste communiste) des éléments critiques. Ils attaquent la société existante dans tous ses fondements. Ils ont pu ainsi fournir des matériaux précieux pour éduquer les travailleurs. « Car – et les mots qui suivent ont une importance décisive pour apprécier le point de vue de Marx sur le degré d’opportunité d’une certaine dose d’utopie – « ils ont des formules positives sur la société future ». (Souligné par nous.)
Au nombre de ces « formules positives » Marx cite la disparition de l’antagonisme entre ville et campagne, l’abolition de la famille, de l’industrie privée, du travail salarié, la transformation de l’État en une simple administration de la production, etc. Cette position de Marxvis-à-vis d’une certaine ouverture à l’utopie n’est pas l’objet d’un choix contestable ; elle est la condition même de toute observation critique de la société existante ; quiconque n’est pas satisfait de ce qui est et le croit modifiable présuppose un état meilleur dans le passé (s’il est réactionnaire) ou dans l’avenir (s’il est révolutionnaire). On ne peut donc, pour peu qu’on s’occupe de politique, « se passer de prophétiser». Car, comme le remarque Karl Kautsky, ceux-là mêmes qui « prédisent que, pendant longtemps encore, les choses iront du même train ne se rendent pas compte qu’ils prophétisent » (38). Leur myopie passe fort abusivement pour du réalisme ; comme l’a fort bien montré Ernst Bloch, on ne sait pas voir la réalité de « la catégorie de la possibilité », (39) on n’y veut voir qu’une relation conceptuelle, alors qu’elle est une détermination porteuse d’avenir dans l’objet réel lui-même, en conformité avec la structure de cet objet. C’est en ce sens qu’on peut, sans logomachie, parler « d’utopie concrète » et comprendre, comme dit encore Bloch, que « ce qui nous appartient se situe en avant ». C’est bien ce que Marx avait compris dès 1844 ; il écrivait, en effet, dans la présentation des Annales franco-allemandes, que s’il ne fallait pas « anticiper le monde dogmatiquement », il n’en fallait pas moins trouver « le monde nouveau (40) par la critique du monde ancien» ( … ). On verra alors, continuait-il, que, depuis longtemps, le monde possède le rêve d’une chose dont il lui manque la conscience pour la posséder réellement. On verra qu’il ne s’agit pas de faire un grand trait entre le passé et l’avenir, mais d’accomplir les idées du passé. On verra enfin que l’humanité ne commence pas une nouvelle œuvre, mais réalise son ancien travail en connaissance de cause » ( 4 l ). Certes, naguère, les Althussériens auraient souri de nous voir citer un Marx trop jeune et qui « n’était pas encore marxiste » … Malheureusement pour eux, Marx écrivant le Capital (dans sa maturité) a démontré aussi sur ce point la continuité de sa pensée, en citant Owen à plusieurs reprises et dans un contexte favorable (42).
Ces indications sommaires suffiront aux lecteurs de bonne foi pour mettre en question le dogmatisme de la « vulgate marxiste » au sujet d’une prétendue condamnation sans appel et sans nuances de l’utopisme par Marx. La toile de fond ainsi restituée, il n’est plus que de faire apparaître les figures de la conception marxienne de la coopération (43).
a) Le mouvement coopératif ( autogestionnaire) en tant qu’ouverture d’une brèche dans la société capitaliste
Dans le Livre I du Capital ( 44 ), puis dans Je livre III (45) Marx cite la Society of Equitable Pioneers , fondée en 1844, par des disciples de Robert Owen, à Rochdale, dans les environs de Manchester. D’abord société coopérative de consommation, elle devint bientôt une coopérative ouvrière de production. Avant de rappeler ce que Marx pense de ces entreprises on peut citer la stupéfaction des observateurs bourgeois devant ces usines qui semblaient pouvoir se passer des capitalistes. « Une feuille anglaise archi-bourgeoise, dit Marx, le Spectator du 26 mai 1866, rapporte qu’à la suite de l’établissement d’une espèce de société entre capitalistes et ouvriers dans la Wirework Company de Manchester, le premier résultat apparent fut une diminution soudaine des dégâts. Les ouvriers ne voyant pas pourquoi ils détruiraient leur propriété, et le dégât est peut-être, avec les mauvaises créances, la plus grande source de perte pour les manufactures. Cette même feuille découvre, dans les essais coopératifs de Rochdale, un défaut fondamental : « Ils démontrent que les associations ouvrières peuvent conduire et administrer avec succès des boutiques, des fabriques dans toutes les branches de l’industrie, et, en même temps, améliorer extraordinairement la condition des travailleurs, mais ! … mais on ne voit pas bien quelle place elles laissent au capitaliste ? Quelle horreur ! » (46) se contente d’ajouter Marx. Plus loin, dans le livre III, abandonnant le genre humoristique, Marx observe que « la production capitaliste en est arrivée à un point où le travail de direction, complètement séparé de la propriété du capital, court les rues, si bien que, désormais, le capitalisme n’a plus besoin de remplir cette fonction» (47). Marx n’envisage pas que « le travail de direction » puisse donner naissance à une nouvelle couche sociale qui, sans posséder formellement les moyens de production, n’en réussirait pas moins à remplir les fonctions bourgeoises d’exploitation et d’aliénation de la force de travail. Il compare cette direction à celle d’un « chef d’orchestre » qui peut exercer sa fonction sans être propriétaire des instruments de musique et qui n’a pas à « s’occuper du salaire de ses musiciens». Pour lui, la mise hors circuit du capitaliste équivaut à la suppression du pouvoir aliénant et expropriateur. Dès lors, la domination capitaliste supprimée, Marx semble supposer que la seule alternative est l’association égalitaire de la coopérative. En effet, pour lui, non seulement « les coopératives de production apportent la preuve que le capitaliste est devenu ( … ) superflu comme agent de production» (48), mais, réflexion plus importante encore : « dans la coopérative de production, le caractère contradictoire du travail de direction disparaît puisque le directeur y est rétribué par les travailleurs au lieu de représenter, en face d’eux, le capital » (49). Il s’agit sans doute là de l’erreur historique la plus grave de Marx, je veux dire la surestimation du changement qui devait résulter de la mise hors circuit des capitalistes privés.
Certes, Marx voit bien que la fonction technique de coordination est, pour le capitaliste, un prétexte pour adjoindre à ce rôle utile un pouvoir de domination : « Entre les mains du capitaliste, écrit-il, la direction n’est pas seulement cette fonction spéciale qui naît de la nature même du processus coopératif ou social, mais elle est encore, et éminemment, la fonction d’exploiter le processus … » (50). Mais Marx ne voit pas que le propriétaire bourgeois n’est pas le seul qui puisse réussir cette opération.
Assurément, cette erreur était inévitable d’après les principes mêmes de Marx, puisque le théoricien ne peut anticiper le mouvement réel du développement historique. Marx tombe ainsi dans le travers qu’il a dénoncé chez les «utopistes», c’est-à-dire qu’il déduit logiquement la libération des travailleurs de ce que le directeur ne représentera plus le capital. Or l’observation des prétendues transformations des rapports de production depuis 1917 dans les pays qui ont « exproprié les expropriateurs » montre – ce que Marx ne pouvait observer – qu’il ne suffit pas que le directeur ne représente plus le capital pour que la contradiction de l’hétérogestion disparaisse (51). Il n’en reste pas moins que la justification que le directeur – émanation de l’État bureaucratique – se donne de représenter le peuple dans son entier est déjà, au moins formellement, une mise en question de la direction d’une classe par l’autre. Pour cacher son pouvoir, la nouvelle classe dirigeante juge nécessaire de la dissimuler sous la fiction d’une société homogène, démocratiquement centralisée. C’est en ce sens que les coopératives, tout imparfaites qu’elles fussent, constituaient pourtant une brèche dans le système capitaliste existant ; c’est Marx lui-même qui emploie cette image, plus récemment reprise par Claude Lefort, à propos du mouvement amorcé en mai 1968 (52). On lit, en effet, dans Le Capital : « Pour ce qui est des coopératives ouvrières, elles représentent, à l’intérieur de l’ancien système, la première brèche faite dans celui-ci, bien qu’elles reproduisent nécessairement, et partout, dans leur organisation réelle, tous les défauts du système existant. Toutefois, dans les coopératives, l’antagonisme entre le capital et le travail se trouve surmonté, même si c’est encore sous une forme imparfaite : en tant qu’association, les travailleurs sont leur propre capitaliste, c’est-à-dire qu’ils utilisent les moyens de production à la mise en valeur de leur propre travail » (53). Comme nous allons le voir, un peu plus loin, non seulement Marx souligne l’imperfection de ces nouveaux modes du travail humain, mais il en décrira diverses formes de « récupération ». Qu’il n’ait pas « prévu » toutes ces formes, ne change rien à la clarté du principe énoncé de l’auto-organisation et de l’autoexploitation (au sens de mise en valeur) du travail humain. Pour qu’on n’aille point croire que nous fondons toute cette interprétation sur un texte exhumé des brouillons du livre III du Capital, il n’est pas inutile de citer les textes rédigés par Marx et publiés de son vivant dans le cadre l’Association internationale des travailleurs. Voici d’abord un extrait de /’Adresse inaugurale de 1864 : « Nous voulons parler du mouvement coopératif et surtout des manufactures coopératives montées, avec bien des efforts et sans aide aucune, par quelque « bras » audacieux. La valeur de ces grandes expériences sociales ne saurait être surfaite. Par des actions et non par des raisonnements, elles ont prouvé que la production sur une grande échelle, et en accord avec les exigences de la science moderne, peut marcher sans qu’une classe de maîtres emploie une classe de «bras» ( … ) que le travail salarié, comme l’esclavage, comme le servage, n’est qu’une forme transitoire et inférieure, destinée à disparaître devant les travailleurs associés … » (54). Il est clair, pour tous, d’après ces lignes, que la révolution des rapports de production est encore à faire dans les États qui ont supprimé les capitalistes privés. Si Marx se trompait en déduisant (comme il dit qu’il ne faut pas faire) par « raisonnement » que cette suppression serait décisive et mettrait fin au travail salarié, il n’en reste pas moins que ce qu’il visait – au-delà du moyen qu’il croyait efficace – c’était bien une nouvelle organisation des travailleurs associés qui formeraient une société sans classe. Davantage, deux ans plus tard, dans les résolutions, écrites de sa main, pour le premier congrès de l’A.l.T. de Genève, en 1866, Marx prenait parti nettement dans une des controverses les plus brûlantes encore aujourd’hui, c’est-à-dire sur la question de l’efficacité des tentatives d’autogestion entant que moyen révolutionnaire. La polémique est, en effet, celle-ci : une auto-organisation égalitaire de la société est certes souhaitable comme but ultime, mais les essais d’auto-organisation, dans la société d’oppression actuelle, loin d’être des moyens d’émancipation seraient une cause d’affaiblissement ; l’autogestion ne peut être instaurée qu’après la révolution, elle dessert plutôt le prolétariat dans l’actuelle lutte des classes. Dans ce débat Marx prend position avec la plus grande netteté : « Nous reconnaissons le mouvement coopératif comme une des forces transformatrices de la société présente, fondée sur l’antagonisme des classes. Son grand mérite est de montrer pratiquement que le système actuel de subordination du travail au capital, despotique et paupérisateur, peut être supplanté par le système républicain de l’association des producteurs libres et égaux( … ). Nous recommandons aux ouvriers d’encourager la coopérative de production plutôt que la coopérative de consommation, celle-ci touchant seulement la surface du système économique actuel, l’autre l’attaquant à la base » (55). Assurément, sur ce point aussi, Marx pourrait s’être trompé ; il n’en est pas moins important de savoir quel fut exactement son point de vue et qu’il conserva le même intérêt, jusqu’à la fin de sa vie, pour les sociétés coopératives. En effet, trois ans avant sa mort, Marxrédigea un questionnaire qui fut tiré à 25 000 exemplaires et envoyé aux sociétés ouvrières, aux groupes et cercles socialistes, à tous les journaux français et plus généralement à toutes les personnes qui en faisaient la demande. Il comprenait 101 questions. Celle qui porte le N. 98 est ainsi libellée : « Y a-t-il des sociétés coopératives dans votre métier ? Comment sont-elles dirigées? Est-ce qu’elles emploient des ouvriers du dehors de la même façon que les capitalistes le font ? Envoyez leurs statuts et règlements » (56). On comprend, certes, par la formulation même de la question, que Marx voyait bien qu’il pouvait y avoir coopérative et coopérative, et que leur efficacité révolutionnaire selon lui présupposait, nous le verrons, des conditions très précises.
b) Manipulations et récupération s des coopératives
Cette « vigilance » de Marx envers les « habiletés » des divers pouvoirs est bien mise en évidence par la question suivante du questionnaire cité : « Existe-t-il, dans votre métier, des ateliers où les rétributions des ouvriers sont payées en partie sous le nom de salaires et en partie sous le nom de prétendue coparticipation dans les profits ? Comparez les sommes reçues par ces ouvriers et celles reçues par d’autres où il n’existe pas de prétendue coparticipation … » (57). Interrogation pertinente encore aujourd’hui et qui devrait suffire à montrer le risible de la polémique des fractions gaullistes à ce sujet. Mais Marx n’avait pas attendu 1880 pour s’apercevoir que les coopératives, dans certains cas, non seulement n’avaient aucune valeur révolutionnaire mais faisaient le jeu de la classe dominante. Dans une lettre à Engels du 13 février 1865, il écrivait, en effet, on ne peut plus clairement : « Le gouvernement prussien ne peut tolérer ni les coalitions ni les syndicats ouvriers. C’est évident. En revanche, accorder des subventions gouvernementales (souligné par Marx) à quelques minables sociétés coopératives, cela arrange bien leurs sales affaires. Les fonctionnaires mettront davantage leur nez partout, il y aura contrôle des « nouveaux » fonds, corruption des ouvriers les plus zélés, tout le mouvement sera émasculé ». C’est pourquoi, remarquera un peu plus tard Marx : « ceux des membres des classes dominantes qui sont assez intelligents pour comprendre l’impossibilité de perpétuer le système actuel – et ils sont nombreux – sont devenus des apôtres importants et bruyants de la production coopérative » (58). Dès lors, lorsqu’il lit dans le programme dit de Gotha que « le Parti ouvrier allemand réclame l’établissement de coopératives de production avec l’aide de l’État », Marx bondit ; pour lui les sociétés coopératives « n’ont de valeur qu’autant qu’elles sont des créations autonomes des travailleurs et ne sont protégées ni par le gouvernement, ni par les bourgeois» (59). Car, pour lui,la classe ouvrière est révolutionnaire ou elle n’est rien (60).
Cependant, nous voilà apparemment en pleine contradiction : ces coopératives dont Marx avait proclamé le dynamisme révolutionnaire, comment peuvent-elles être si facilement « récupérées » par ceux-là mêmes qui s’en étaient effrayés au début ? Il faut expliquer pourquoi « de nobles hâbleurs, les déclameurs philanthropes de la classe bourgeoise, des économistes subtils se sont tournés tout d’un coup avec des compliments nauséabonds vers le système du travail coopératif, qu’ils avaient vainement cherché à tuer dans l’œuf en le raillant comme un utopie de rêveurs ou en le stigmatisant chez les socialistes comme un blasphème » ? (61 ). Cette raison, Marx la connaît, bien sûr, et il l’énonce à plusieurs reprises.
c) La condition pour un développement révolutionnaire du mouvement coopératif est qu’il atteigne la dimension nationale
Dans l’Adresse inaugurale, d’abord, en 1864 « pour excellente qu’elle soit dans ses principes », et si utile qu’elle apparaisse dans la pratique, la coopération des travailleurs, si elle reste circonscrite dans un cercle étroit, si quelques ouvriers seulement font des efforts au petit bonheur et en leur particulier, alors cette coopération ne sera jamais capable d’arrêter les monopoles qui croissent en progression géométrique ; elle ne sera pas capable de libérer les masses ni même d’alléger de façon perceptible le fardeau de leur misère.( … ) Pour que les masses laborieuses soient affranchies, la coopération devrait prendre une ampleur nationale, et, par conséquent, il faudrait la favoriser avec des moyens nationaux » (62).
En clair cela veut dire que la mise en autogestion de la production ne peut être, en même temps, que la destruction de l’État. Cela apparaît clairement dans la résolution sur le « travail coopératif » du premier congrès de l’ A.I.T ., à Genève, en 1866 : « Le système coopératif restreint aux formes minuscules issues des efforts individuels des esclaves salariés, est impuissant à transformer par lui-même la société capitaliste. Pour convertir la production sociale en un large et harmonieux système de travail coopératif, des changements généraux sont indispensables.
Ces changements ne seront jamais obtenus sans l’emploi des forces organisées (63) de la société. Donc, le pouvoir d’État, arraché des mains des capitalistes et des propriétaires fonciers, doit être manié par les producteurs eux-mêmes» (64). Cinq ans plus tard, pendant la Commune de Paris, Marx développe, sur un autre ton il est vrai, le même thème : « (La Commune) » voulait faire de la propriété individuelle une réalité, en transformant les moyens de production, la terre et le capital, aujourd’hui essentiellement moyens d’asservissement et d’exploitation du travail, en simples instruments d’un travail libre associé. Mais c’est du communisme, c’est « l’impossible » communisme ! ( … ). Mais si la production coopérative ne doit pas rester un leurre et un piège ; si elle doit évincer le système capitaliste ; si l’ensemble des associations coopératives doit régler la production nationale selon un plan commun, la prenant ainsi sous leur propre direction et mettant fin à l’anarchie constante et aux convulsions périodiques qui sont le destin inéluctable (65) de la production capitaliste, que serait-ce, messieurs, sinon du communisme, du très possible communisme? » (66)
Enfin, en 1875, Marx confirme encore le même point de vue dans les Gloses marginales sur le programme du parti ouvrier allemand dit de Gotha : « L’émancipation du travail exige les transformations des moyens du travail en propriété commune de la société ; et que l’ensemble des activités soit réglementé par le moyen de coopératives » (67). Et un peu plus loin, dans le même texte : « Les ouvriers veulent instaurer les conditions de la production coopérative à l’échelle de la société et tout d’abord, chez eux, à l’échelle nationale. Ce fait ne signifie qu’une chose : les ouvriers travaillent au bouleversement des conditions de production actuelles. Cela n’a rien à voir avec la création de sociétés coopératives avec l’aide de l’État» (68).
Il me semble que tout doit être bien clair maintenant : les coopératives autogérées sont les premières réalisations concrètes de « l’utopie » d’une société sans classe ; mais ces coopératives ne peuvent véritablement se développer, conformément à leur essence, tant que subsiste un État central, dominateur ou même protecteur. C’est une tout autre organisation égalitaire et coopérative de la société dans son ensemble qui constituera la révolution.
On peut, certes, sur cette question ou sur d’autres, ne pas partager les vues de Marx. La présente mise au point historique ne fait aucunement appel à l’argument d’autorité. Ce sont, souvent, en revanche, « les révolutionnaires professionnels » qui s’appuient abusivement sur l’autorité de Marx pour critiquer l’autogestion. D’autres dénient aux « marxistes » la possibilité d’être des partisans conséquents de l’extension nationale du système coopératif. Aux uns et aux autres qui ne seraient pas entièrement satisfaits de leur certitude les textes ici rassemblés pourraient donner la chance d’une nouvelle interrogation.
Yvon BOURDET, « Karl Marx et l’autogestion », Autogestion et Socialisme, N°15, Anthropos, Paris, Mars 1971, P. 83-112.
(1) Pourtant, Pero Darnjanovic a déjà publié dans la revue Praxis (1962, 1, pp. 39-54) un article intitulé: « Les conceptions de Marx sur l’autogestion sociale.» L’auteur soutient que « l’autogestion est immanente à la classe ouvrière et à son mouvement de libération ». Il se réfère à Marx qui lui semble – depuis ses écrits de jeunesse où il dénonce l’individu abstrait laminé par l’État – avoir toujours pensé que seules les associations autonomes des producteurs pourront réaliser la vraie liberté. Malheureusement, dans son article, Pero Damjanovic reste allusif et ne donne pas les références précises des textes sur lesquels il s’appuie. Il nous paraît également avoir laissé de côté des aspects importants.
(2) Ed. sociales, livre 1, tome III, p. 205. Voir aussi t. 1, p. 19.
(3) Bibliothèque de la Pléiade, économie, 1, p. 173
(4) Boukharine, L’Économie mondiale et l’impérialisme, p. 131. Il va sans dire que Boukharine présente cet « argument » comme un « sophisme ».
(5) L’impérialisme, stade suprême du capitalisme œuvres complètes, t. XXII, p. 291.
(6) « Pour ce qui est du « canard » souabe, ce serait un coup amusant que de duper l’ami de Vogt, ce Mayer souabe » (lettre de Marx à Engels du 7 décembre 1867).
(7) Ibid.
(8) Pléiade, t. 1, p. 550.
(9) Ibid., (chap, XXXI) p. 1213.
(10) Manifeste communiste, Pléiade, p.171. Voir même thème dans l’Anti-Duhring éd. sociales, pp. 204-205. De ce fait les forces, dites réactionnaires, ne peuvent jouer qu’un rôle de frein.
(11) Dernier paragraphe du Manifeste communiste. Voir également la lettre d’Engels à Marx du 23 octobre 1946.
(12) Karl Kautsky, Die Diktatur des Proletariats, Vienne, 1918, p. 20. La « lettre » dont parle Kautsky désigne les « Gloses marginales au programme du Parti ouvrier allemand », dit Programme de Gotha, envoyées à W. Bracke le 5 mai 1875.
(13) H. Draper a rassemblé onze textes – et même quatorze si on compte à part les variantes – qui se rapportent à cette question (« Marx and the Dictatorship of the Proletariat », in Cahiers de 1 ‘I.S.E.A., série S (6) sept. 1962, pp. 5-73).
(14) Contribution à l’histoire de la question de la dictature, œuvres complètes, Moscou, 1961, t. 31, p. 363.
(15) Max Alder, Démocratie politique et démocratie sociale, Paris, Ed. Anthropos, 1970, p. 140.
(16) Manifeste communiste, Pléiade, p. 172. Voir aussi les observations anti-blanquistes de Marx dans Les luttes de classes en France, éd. Sociales, pp. 42, 99, 102.
(17) Manifeste communiste, Pléiade, p. 183.
(18) Lénine fait allusion à ce texte dans sa polémique contre Kautsky et il essaye de l’expliquer par l’absence « du militarisme et de la bureaucratie», dans les années 70, en Angleterre et en Amérique (La révolution prolétarienne et le renégat Kandinsky, Œuvres complètes, Moscou, 1961, t. 28, pp. 243, 247.
(19) Critique du programme d’Erfurt, éd. sociales, pp. 86-87. Dans l’État et la Révolution (Œuvres complètes, t. 25, p. 480) Lénine lénifie ce texte en soulignant son caractère abstrait puisque, dit-il, Engels écrit qu’on peut seulement « concevoir » ! cette évolution pacifique.
(20) Ed. sociales, p. 17.
(21) Voir Rosa Luxemburg dans Le programme de la ligue Spartacus ; Kautsky, dans Le chemin du pouvoir éd. Anthropos, 1969, p. 162 ; Otto Bauer divers textes, in : Otto Bauer et la Révolution Paris, C.D.I., 1968.
(22) Pour un aperçu d’ensemble voir notre livre : Communisme et marxisme, chapitre 3.
(23) Konspekt von Bakunin Buch, « Staatlichkeit und Anarchie», in Marx – Engels Werke, Dietz, Berlin, t. 18, p.634 et sq., partiellement traduit par Ru bel dans Pages de Karl Marx… Paris, Payot, 1970, t. 2, pp.178-180.
(24) Zola 111et dans la bouche de Souvarine une des « réponses » possibles des anarchistes, « Votre Karl Marx en est encore à vouloir laisser agir les forces naturelles. Pas de politique, pas de conspiration, n’est-ce pas? Tout au grand jour, et uniquement pour la hausse des salaires … Fichez-moi la paix avec votre évolution ! Allumez le feu aux quatre coins des villes … » Émile Zola, Germinal, Fasquelle, Paris (Livre de Poche). Livre de Poche, p. 138.
(25) Manifeste communiste, Pléiade, p. l 72.
(26) Statuts de l’Association internationale des travailleurs, lbid., p. 469.
(27) Révolutions du premier congrès de l’A.I.T., Genève, 1866 (Pléiade, t. l, p. 1469).
(28) Cité par M. Rubel, in : Cahiers de l’I.S.E.A., N. 8, août 1964, p. 4.
(29) Ibid. p. 4, voir également, en annexe, la reproduction des deux démentis, publiés par Marx dans le Times du 22 mars 1871 et le 4 avril de la même année. Thorez lui-même cite cette formule de Marx, tirée de la critique du programme de Gotha : « L’action internationale des classes ouvrières ne dépend, en aucune façon, de l’existence de l’Association internationale des travailleurs» (Fils du Peuple, Paris, 1960, p. 210).
(30) Lettre circulaire adressée par Marx et Engels aux chefs de la social-démocratie allemande (citée par M. Rubel, in Cahiers de /’l.S.E.A., nov. 1970, p. 2013.)
(31) Le Manifeste communiste, La Pléiade, p. 174. Sur la conception marxienne du parti, voir Maximilien Rubel, « Remarques sur le concept du parti prolétarien chez Marx », in Revue française de sociologie, 1961, II, 3 et notre article : « Démocratie, classe et parti d’après Max Adler», in : Arguments, 1962, pp. 25-26.
(32) Lettre du 13 février 1851, Cortès, Paris, t. 2, p. 48.
(33) Introduction à la critique de la philosophie hégélienne du droit, 1844.
(34) Traduction Rubel in La Nef, N. 43, juin 1948, p. 67.
(35) Il existe une littérature abondante sur l’utopisme et sur les utopies. Contentons-nous ici de renvoyer au texte de Max Adler,: « L’utopisme chez Marx et Engels », précédé d’un avertissement : « La question de l’utopie chez Max Adler », in : Économie et Société, cahiers de l’I.S.E.A., t. IV, N. 11, nov. 1970, pp. 2069-2096. Voir également, dans le même numéro, les remarques de M. Rubel, notamment p. 2097.
(36) On retrouve, presque mot pour mot, le même thème, dans un des brouillons d’Adresse à la Commune de Paris, rédigée plus de vingt ans plus tard, au printemps de 1871.
(37) Neue Rheinische Zeitung; 1850, trad. Rubel, Pléiade, Œuvres, économie, 1, p. 1588.
(38) Le Chemin du pouvoir, p. 41.
(39) « Sur la catégorie de la possibilité », in : Revue de métaphysique et de morale, janvier-mars 1958.
(40) Souligné par nous ; dans la suite de cette étude, les mots soulignés, dans les textes de Marx, sauf indications contraires, l’auront été par nous.
(41) Marx· Engels Werke, Dietz, Berlin, 1858, t. 1, p. 343. (Traduction de M. Rubel, Pages de Karl Marx … Paris, Payot, 1970, t. 1, p. 68.)
(42) Voir Le Capital, livre I, Pléiade, 1, pp. 631, 833, 987, 996, note a, et aussi, même édition, Adresse inaugurale, p. 466 ; Salaire prix et plus-value, p. 488; et enfin, dans le livre III du Capital, Pléiade, Il, p. 913.
(43) Pour ce faire, nous avons été aidé par les textes de Marx rassemblés par Thomas Lowit, in : Études de Marxologie (6), Cahiers de l’l.S.E.A., N. 129, sept. 1962, pp. 79-98.
(44) Pléiade, I p. 870.
(45) Pléiade, II, p. 913.
(46) Le Capital livre Ier, chap, 13 (Pléiade, I, p. 870).
(47) Le Capital livre III (Pléiade, Il, p. 1147).
(48) Ibid. p. 1147. Même remarque, p. 1149.
(49) Le Capital, livre Ier, Pléiade, t. I, p. 870.
(50) Ibid., p. 1148.
(51) Voir à ce sujet, nos analyses, in : la délivrance de Prométhée, chap, III, « La démocratie du centralisme démocratique» ; chap.IV, « Les contradictions de l’hétérogestion ».
(52) Edgar Morin, Claude Lefort, Jean-Marx Coudray – Mai 1968 : La Brèche, Paris, Fayard, 1968, p. 144. Marx emploie également cette image dans une lettre à J. B.Schweitzer, du 13 février 1865.
(53) Livre III du Capital, Pléiade, Il, p. 1178.
(54) Pléiade, Économie, t. 1, p. 466.
(55) Résolution du premier congrès de l’A.I.T., réuni à Genève, en septembre 1866. ln Marx, Œuvres, Économie, t’ 1, p. 1469.
(56) Le questionnaire, publié sans nom d’auteur, dans la Revue socialiste (N. 4, 20 avril 1880) fait l’objet de la mention suivante dans une lettre de Marx à Sorge : « J’ai rédigé ( … ) le « Questionnaire » qui, imprimé d’abord dans La Revue socialiste, a été diffusé à un grand nombre d’exemplaires par toute la France » (5 novembre 1880, Paris, Costes 1950, t. 1, pp. 253-254). Le texte de l’enquête sociologique est reproduit par M. Rubel dans la Pléiade, Économie, T. 1, pp. 1527-1536.
(57) Ibid., p. 1536.
(58) La guerre civile en France, 1871, Ed. Sociales, Paris, 1953, p. 46.
(59) Pléiade, t. I, pp. 1426-1428.
(60) Lettre de Marx à J. B. Schweitzer, du 13 février 1865. Ce passage est recopié par Marx dans sa lettre du 18 février 1865 (Ed. Costes, t. 8 de la Correspondance Karl Marx-Fr. Engels, p. 165).
(61) Adresse inaugurale de l’A.I.T. (1864).
(62) Pléiade, p. 467.
(63) L’expression de « forces organisées » n’inclut pas nécessairement la violence ni ne l’exclut, bien entendu, si on remarque, en même temps, qu’il s’agit « d’arracher » le pouvoir et même de le briser (lettre à Kugelmann, du 12 avril 1871). Sur la question de l’usage de violence, voir la première partie de cet article.
(64) Pléiade, t. 1, p. 1469.
(65) On croit souvent que les textes sur l’effondrement inévitable du capitalisme ne se trouvent que dans les analyses scientifiques du capitalisme. On voit ici que, dans l’étude à chaud d’un soulèvement prolétarien, Marx soutient le même thème qui ne lui paraît donc pas incompatible avec l’action révolutionnaire.
(66) la guerre civile en France, /871, Ed. Sociales, Paris, 1963, p.46.
(67) Pléiade, t. I, p. 1416 et 1719.
(68) Ibid., pp. 1427-1428.