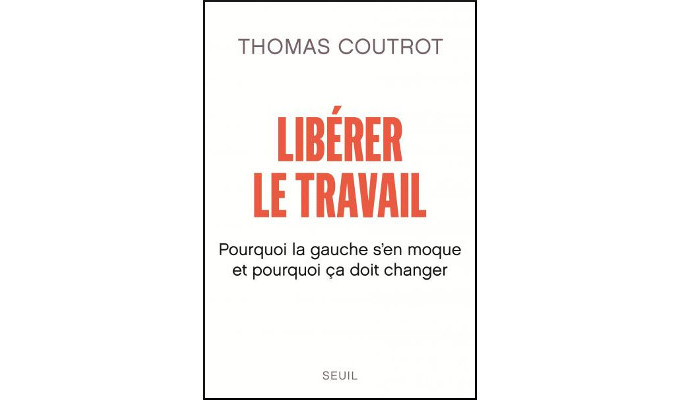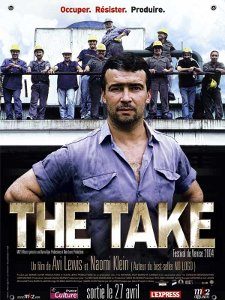Dans un essai stimulant et richement documenté, Thomas Coutrot défend la thèse que la gauche ne s’est jamais réellement intéressée à la nature du travail, ce qui constituerait une erreur stratégique majeure. Paradoxalement, c’est dans l’entreprise « capitaliste » que les innovations en terme d’auto-organisation des salarié-es sont les plus fécondes quoique totalement instrumentalisées dans l’intérêt du capital. Comment expliquer cette situation dans laquelle les revendications des salarié-es semblent s’exprimer dans le respect de la division capitaliste du travail ? Démontrant la nécessité historique de démocratiser le travail, l’auteur brosse des pistes de réflexion sur un salaire/revenu dont une partie serait attachée à la personne et une démocratisation de l’entreprise entre salarié-es et actionnaires de long terme. Ces actionnaires, existent-ils vraiment ? Si ceux-ci étaient remplacés par les usager-es, n’aurions-nous pas alors une véritable émancipation du travail qui permettrait de donner tout son champ à la « fécondation réciproque de la pratique (plutôt masculine) du travail collaboratif et de l’éthique (plutôt féminine) du care » que défend l’auteur ? Un livre essentiel pour penser l’alternative.
Le sous-titre annonce de suite la couleur : Pourquoi la gauche s’en moque et pourquoi ça doit changer. Dans son essai publié au Seuil, Thomas Coutrot, économiste et statisticien du travail, ancien porte-parole d’Attac, entend donner une nouvelle dimension à l’appropriation sociale : celui d’une libération de l’acte de travailler. On saluera d’abord la décision de l’auteur de pratiquer l’écriture inclusive dans un ouvrage à grand tirage. Structuré en quatre parties, l’ouvrage fait dans un premier temps le point sur la situation du travail dans nos sociétés en contestant fortement l’hypothèse de la « fin du travail ».
La seconde partie porte sur le rapport de la gauche avec le travail. Thomas Coutrot utilise une distinction somme toute classique entre une gauche productiviste et une deuxième gauche, sauf que les frontières entre cette dernière ne recoupent pas exactement ce qui est couramment appelé « la deuxième gauche » : « Le premier courant – « la gauche contre le travail » – représente la majeure partie du mouvement ouvrier et des « intellectuels organiques » de la gauche, qui se sont rangés derrière le drapeau de la rationalisation taylorienne. » On y retrouve certains écrits d’un « Marx n° 2 » pour qui « le travail ne pourra jamais être véritablement libre puisque sa finalité lui est imposée par les nécessités naturelles (se nourrir, se loger, se vêtir…) de la survie humaine, l’empire de la nécessité », les préconisations de Lénine et de Gramsci et l’adhésion des courants traditionnels du mouvement ouvrier à l’optimisation taylorienne de la production « jusqu’à rendre possible l’abondance dans une société future débarrassée du travail. » Il est intéressant de voir que l’auteur range, de ce point de vue, des auteurs tels qu’Herbert Marcuse ou André Gorz dans cette « gauche contre le travail » pour laquelle l’émancipation se situerait désormais en dehors de la sphère du travail 1. Il en conclut que « la seule revendication qui reste pour contester la folie productiviste du capitalisme est la réduction du temps de travail. Et c’est un peu court… »
La seconde gauche qu’il a identifiée est « la gauche sans le travail ». Elle correspond à une gauche plus autogestionnaire, quoique fort disparate, qui se distingue dans ses trop maigres tentatives de poser la transformation du travail comme condition de l’émancipation. On y retrouve bien sûr Fourier et Proudhon, une position aujourd’hui bien méconnue du congrès d’Amiens de la CGT en 1906 en faveur de la commandite ouvrière 2 et, bien sûr, la coopération de travail avec un point particulier sur le groupe Mondragón. Alors que les salarié-es des coopératives de travail devraient logiquement être les plus ouvert-es aux innovations en matière d’organisation, « ils le font le plus souvent dans le cadre d’une organisation hiérarchique inchangée », la coopérative de travail se concrétisant essentiellement par l’élection par les salarié-es d’une direction. S’il est nécessaire de temporiser cette remarque – ce que Thomas Coutrot fait en reprenant la typologie en quatre catégories issue des travaux de Hervé Charmettant et alii 3 – c’est plutôt dans des luttes ponctuelles, des « brillantes étoiles solitaires » que l’on peut trouver les initiatives les plus intéressantes visant à casser la division capitaliste du travail.
Paradoxalement, c’est dans les entreprises capitalistes que se seraient déroulées ces dernières années les plus grandes innovations en terme d’organisation du travail qui sont ici détaillées dans la troisième partie. Sous les vocables d’entreprises libérées, de sociocratie ou d’holacracy, l’auteur « y trouve véritablement le pire et le meilleur, des manipulations éhontées et des principes d’organisation vraiment post-hiérarchiques – et parfois, les deux à la fois. » (dans la même veine, voir sur notre site : La révolution Holacracy est-elle de l’autogestion ?). Même si, dans la plupart de ces entreprises, les questions essentielles telles que la part des salaires dans la valeur ajoutée ou le pouvoir qui reste dans les mains d’actionnaires qui, à tout moment, peuvent mettre un terme à l’expérience, l’auteur estime que « « l’entreprise autogouvernée » représente une percée non négligeable pour répondre à la question sur laquelle n’a cessé de buter le mouvement ouvrier et socialiste : celle d’une organisation démocratique du travail à grande échelle. »
Comment expliquer alors que les salarié-es ne revendiquent pas une plus grande liberté dans leur travail ? C’est sur cette question que s’ouvre la partie conclusive du livre. C’est chez Moishe Postone 4 que Thomas Coutrot trouvera la réponse à son interrogation. Selon cette lecture de Marx, la particularité du capitalisme se situe dans le travail salarié comme mode fondamental de médiation sociale et la seule chose qui compte est alors la valeur d’échange, valeur d’échange dans laquelle s’inscrivent la revendication syndicale et les conventions collectives. Cependant, selon l’auteur, Moishe Postone sous-estime le poids de la subordination salariale de plus en plus contestée car de plus en plus insupportable.
Dès lors, Thomas Coutrot interroge le lien entre démocratie au travail et démocratie dans la cité en démontrant combien l’autonomie au travail est un facteur de politisation. « Mais il semble qu’on bute ici sur un cercle vicieux : comment libérer le travail sans changer les institutions qui l’organisent ? Et comment transformer ces institutions si le pouvoir d’agir des citoyens-travailleurs reste atrophié par le travail ? » L’auteur préconise une « stratégie dialectique » dans laquelle les avancées dans l’entreprise renforceront l’intervention citoyenne dans les institutions qui en retour facilitera les pratiques démocratiques du travail…
Comment déterminer alors ces nouvelles pratiques démocratiques ? Suivant la méthode typiquement marxienne qui consiste « à libérer les éléments de la société nouvelle que porte dans ses flancs la vieille société bourgeoise qui s’effondre » 5, il s’intéresse à deux pratiques émergentes : le travail collaboratif et l’éthique du care. Le premier se réalise dans des travaux organisés sur des bases non hiérarchiques comme le développement de logiciels libres, les Fab Lab ou encore l’exemple de la Coopérative Intégrale Catalane, le second étant l’éthique du care, l’attention portée à autrui et même aux choses dans son activité, forme de travail qu’il est, par définition, impossible de quantifier.
Le dernier chapitre « Pour une politique du travail vivant » constitue la conclusion de ce livre. Après avoir rappelé que les salarié-es résistent de façon naturelle à l’émiettement du travail abstrait et que la gauche ferait bien de s’intéresser à cette question, Thomas Coutrot précise la nuance entre un travail abstrait qui n’est pas instituable alors que le travail concret l’est par les institutions qui valorisent les effets qualitatifs. À cet effet, il propose deux pistes de travail.
La première porte sur une démocratisation des entreprises et un élargissement des finalités de l’entreprise. Il prend comme exemple la proposition d’Isabelle Ferreras 6 d’une « chambre du travail » élue par les salariés d’une entreprise qui équilibrerait le Conseil d’administration élu par les actionnaires, les décisions stratégiques ne pouvant « être prises que conjointement par les deux chambres. » Devant la frilosité actuelle du patronat à l’égard d’une augmentation de la présence des salarié-es dans la gestion des entreprises, on peut s’interroger de la viabilité d’une telle solution. Si l’auteur prend soin de préciser que de telles mesures « seraient illusoires pour une entreprise dépendant d’un actionnariat liquide sur les marchés financiers », et qu’il faudrait protéger l’entreprise « en réservant le droit de vote aux actionnaires stables ou en appliquant le principe démocratique « une personne, une voix » », on se demande quand même où on va bien pouvoir trouver d’aussi gentils actionnaires à l’avenir (cf. lire Impossible compromis entre les classes). Si nous partons de l’idée plus plausible qu’il n’y aura plus d’actionnaires – ce qui suppose la présence d’un secteur financier socialisé en alternative – il est alors possible de reprendre l’idée d’Isabelle Ferraras d’une « chambre du travail » élue par les salarié-es et d’un conseil d’administration qui serait alors élu par les usagers et non plus les actionnaires. Nous renouons ici avec les coopératives d’usagers dans lesquelles ceux-ci remplacent les actionnaires.
Cette solution permettrait alors d’organiser institutionnellement la logique du care, une logique dans laquelle on ne cherche nullement à quantifier le travail mais à obtenir un mieux-être individuel et collectif. Nous sortons ici du strict domaine de la marchandise pour réaliser un travail qui a un sens, lequel ne peut être évalué que par le ressenti humain des usager-es et non la pseudo-rationalité comptable et froide de l’homo œconomicus inventé par les libéraux. Nul doute alors que la complémentarité entre la « chambre du travail » et le conseil d’administration nommé par les usager-es sera grande à condition, bien sûr, de savoir sortir de la subordination du travail. Les coopératives d’usagers n’ont jamais le su faire : dans celles-ci, les membres sont les usager-es qui nomment une direction qui dirige des travailleur-ses maintenu-es dans une position absolument similaire à celle qu’ils-elles auraient dans une entreprise capitaliste. D’une certaine façon, la Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) associe travailleur-ses et usager-es dans les organes de direction mais le fait d’une façon rigide (détermination statutaire des droits de vote de chaque « collège ») et, à la différence des Scop, les salarié-es y sont toujours minoritaires. C’est ici que les pratiques qu’a présentées Thomas Coutrot – commandite ouvrière, travail collaboratif, éthique du care – sont essentielles pour sortir de la subordination.
La seconde proposition porte sur une déconnexion des revenus des salarié-es de la valeur ajoutée produite par l’entreprise. L’auteur cite à titre d’exemple la proposition de salaire à vie de Bernard Friot. Il s’agit d’une proposition extrême qui déconnecte totalement les salaires versés de la valeur ajoutée 7. Mais, au-delà d’une discussion indispensable sur le côté réaliste de la mesure, il convient de préciser que tout le monde n’aspire pas forcément à la société du salaire à vie et que nombre de personnes souhaitent conserver un lien entre la rémunération et la qualité de son travail en dehors de tout concept de grade ou de qualification. C’est donc sur des mécanismes de déconnexion partielle des revenus – tels que la péréquation du revenu disponible qui a été développée dans Coopératives contre capitalisme 8 – qu’il faudra s’appuyer pour délibérer sur les proportions entre des parties garanties – par une allocation uniforme ou selon des grades – et des parties déterminées par une validation sociale par le marché ou l’appréciation des usager-es. Nous pourrons ainsi avancer vers cette sécurité sociale professionnelle qu’appelle Thomas Coutrot qui permettra de conjuguer salariat sans subordination avec entrepreneuriat et formation.
La combinaison de ces deux mesures – démocratisation de l’entreprise et sécurisation des revenus – est donc de nature à libérer le travail de façon à ce que celui-ci ne soit plus subordonné, que les travailleur-ses puissent, en conjonction avec les usager-eres et le citoyen-nes, délibérer sur ce qu’il faut produire et comment.
Notes:
- André Gorz, Adieu au prolétariat, Au-delà du socialisme, Paris, Galilée, 1980 ↩
- La commandite ouvrière s’oppose à la subordination du salariat au sens où le donneur d’ordre passe commande d’une prestation sans avoir son mot à dire sur l’organisation du travail. ↩
- Hervé Charmettant, Olivier Boissin, Jean-Yves Juban, Nathalie Magne, Yvan Renou, « Les Scop : quels modèles d’entreprises ? Des entreprises modèles ? », HAL Archives ouvertes, 2015 ↩
- Moishe Postone, Temps, travail et domination sociale (1993), Paris, Mille et une nuits, 2009. ↩
- Karl Marx, La Guerre civile en France, Paris, Éditions Sociales, 1952, p. 53 ↩
- Isabelle Ferreras, Critique politique du travail, Presses de Sciences Po, Paris, 2007 ↩
- On notera à cet égard que la proposition de Bernard Friot est totalement incompatible avec la proposition d’Isabelle Ferreras qui se place dans le contexte d’un maintien des actionnaires. Pour être fonctionnelle, la proposition de Bernard Friot suppose l’expropriation des actionnaires, ce qu’il défend avec le concept de co-propriété d’usage des moyens de production. ↩
- Benoît Borrits, Coopératives contre capitalisme, Paris, Editions Syllepse, 2015, page 133. ↩