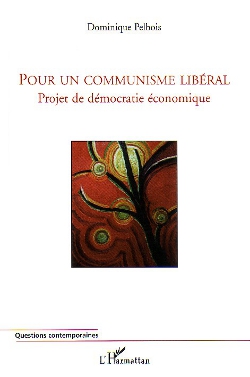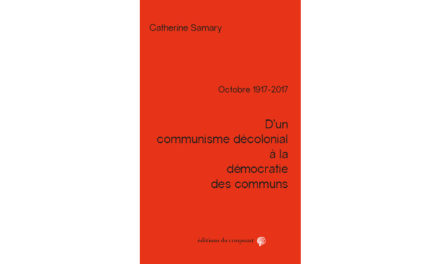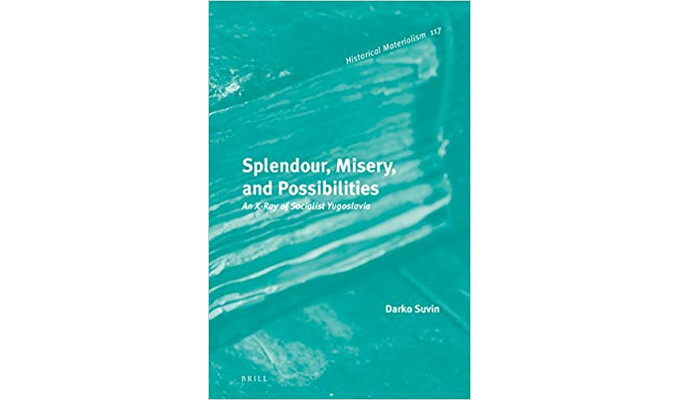
Ce texte est la version française de la recension du livre de Darko Suvin Splendour, Misery and Possibilities: An X-Ray of Socialist Yugoslavia (Spendeur, Misère et Possibilités – une radiographie de la Yougoslavie socialiste) écrite par Catherine Samary pour la New Left Review, parue dans son numéro 114, de novembre-décembre 2018, sous le titre ‘A Utopian in the Balkans’
(https://newleftreview.org/II/114/catherine-samary-a-utopian-in-the-balkans )
Lire la première partie
Seconde partie
Suvin périodise l’histoire de la RSFY en «vingt années glorieuses», de 1945 à 1965, suivies de vingt autres «minables», les réformes du marché de 1965 marquant un tournant. Elles ont produit la troisième singularité, autodestructrice: au lieu de viser un horizon de «justice socialiste, d’émancipation communiste et de bien-être économique», le pays s’en est désormais éloigné. Cette « inversion » a séparé les ‘vingt glorieuses‘ des ‘vingt minables‘. En particulier, la Loi Bancaire de 1965 a concentré le capital d’investissement dans les banques réformées des républiques constituantes; en 1971, écrit Suvin, les autorités fédérales avaient perdu tout contrôle sur la politique de crédit. Les banques des républiques les plus riches du nord (Croatie, Slovénie et Serbie) sont devenues le secteur le plus rentable de l’économie yougoslave, tandis que leurs principaux dirigeants ont émergé en tant que nouveaux hommes de pouvoir, étroitement liés aux dirigeants des partis républicains à Zagreb, Ljubljana et Belgrade.
Dans le même temps, les réformes de 1965 ont réduit les subventions et dévalué la monnaie, ce qui a entraîné une forte hausse des prix. Suite à l’analyse novatrice de Susan Woodward dans Socialist Unemployment (1995), Suvin montre comment les entreprises autogérées, soumises à la compression des investissements, ont essayé d’éviter le licenciement de travailleurs existants, mais ont cessé d’embaucher de nouveaux employés, ce qui a entraîné une augmentation du chômage des jeunes. Au bout de cinq ans, il y avait en Allemagne un million de Gastarbeiter yougoslaves, principalement originaires des régions du nord. Les envois de fonds et l’augmentation de la dette, ainsi que le tourisme sur la côte dalmate, sont devenus des éléments essentiels d’une économie de plus en plus régionalisée. Les espoirs initiaux que, grâce aux réformes de 1965, les entreprises autogérées conserveraient une part plus importante des recettes, ont été rapidement dissipés dans le contexte d’un « système financier en plein essor » et de la dispersion du pouvoir central en « sept ou huit apparati semi-étatiques ». Dans les coulisses, écrit Suvin, le FMI et la Banque mondiale ont toujours pousssé à la décentralisation comme un «cheval de Troie» favorisant la marchéisation. Cependant il explique la «troisième singularité» de façon essentiellement endogène:
Dans les années 1960, les «réformateurs» du parti ont conclu un compromis avec les partisans de la voie médiane contre le retour du stalinisme sur une plate-forme de gouvernement politocratique et sont devenus des «décentralisateurs», ce qui signifie davantage de pouvoirs pour les dirigeants républicains et locaux, plus quelques broutilles verbales et matérielles pour les travailleurs et beaucoup de consumérisme pour les classes moyennes, sur un marché qui n’était que partiellement contrôlé. Le monolithe au pouvoir s’est fragmenté en une polyarchie de centres de pouvoir «républicains».
Des tensions croissantes ont éclaté lors de diverses manifestations à la fin des années 60 et 70, auxquelles Tito et Kardelj ont réagi en combinant concessions et répression (Suvin ne les analyse pas précisément). Après la mort de Tito en 1980, le système entra dans sa dernière décennie, caractérisée par une crise politique interne et des pressions économiques externes. Au milieu des années 1970, écrit Suvin, les épitaphes sur les espoirs antérieurs sur la Yougoslavie pouvaient encore se contenter de pleurer une médiocrité: pour Bogdan Denitch, le contraste entre les «possibilités banales» d’un petit pays relativement sous-développé et les «aspirations héroïques à résoudre les problèmes complexes d’une société multinationale, de la démocratie industrielle, de l’égalitarisme et de la mobilité sociale d’une manière qui n’avait encore été tentée nulle part dans le monde. » Pour Dennison Rusinow, « la Yougoslavie allait devenir un État négligé, modérément oppressif, semi-efficace, semi-autoritaire… comme tant d’autres États.» C’est une bien plus grande tristesse qu’exprima chaque épitaphe rédigée après les années 1990, avec leurs «guerres fratricides, dépossessions matérielles et morales» et «la misère de la rupture contre-révolutionnaire». Dans un magnifique passage, Suvin décrit la figure de la Yougoslavie comme l’Héroïne de la libération du peuple, aux prises avec une Hydre à plusieurs têtes, l’héritage balkanique: l’autoritarisme patriarcal, l’usure des koulaks, l’évasion kitsch des petits-bourgeois; la négligence héritée de la décadence ottomane, la convoitise subalterne croate, le narcissisme slovène. « Aussi longtemps que l’Héroïne, l’ancienne Yougoslavie des Lumières, était vigoureuse et lucide, les têtes tombaient et les monstres vaincus étaient renvoyés dans leurs tanières. » Mais quand elle me mit à dériver et à perdre courage, ils resurgirent – « avec l’aide décisive de l’obstination de l’oligarchie au pouvoir ».
Mais Suvin veut insister sur les possibilités latentes de la Yougoslavie socialiste, ainsi que sur les splendeurs et les misères évoquées par son titre balzacien. Son récit historique de l’ascension et de la chute de la RSFY est complété par un ensemble d’outils conceptuels re-travaillés permettant d’évaluer sa signification pour tout projet plus vaste de libération humaine. Dans un chapitre frappant qui déroule ses thèses à partir d’un procédé consistant à «déconstruire et réassembler» les oppositions exprimées dans l’essai de Marx «Sur la question juive», Suvin propose la notion de «communisme I» pour décrire le projet marxien original d’émancipation sociale et celle de «communisme 2» pour désigner le communisme d’État officiel du XXe siècle, sous ses diverses formes. Dans l’expérience yougoslave, les deux étaient distincts, certes, mais non pas totalement dissociée, car le Parti, pendant la guerre et au cours de ses premières décennies de gouvernement, « était non seulement un facteur d’aliénation, mais aussi à la fois l’initiateur et le levier d’un véritable libération – jusqu’à une certaine limite importante ». Suvin souligne: «la libération est importante et la limite est importante.» Au moins pour cette période, »le gouvernement du parti / de l’État était un Janus à deux têtes ». Cette «dialectique potentielle» a été étouffée par «une tradition «bureaucratique » (au sens de Marx) de monolithisme et de non-transparence, ici d’origine stalinienne. Dans la mesure où le parti offrait une colonne vertébrale émancipatrice, il pouvait être un instrument rétro-agissant aux intérêts de classe plébéeins exprimés par en bas. Mais comme il n’y avait pas de démocratie en son sein, « de telles pressions étaient superficielles, conduisant dans la pratique à une exécution zélée ou réticente des décisions venant des dirigeants. »
Néanmoins, selon Suvin, « les partis qui dégénèrent en réussissant » ne sont pas soumis à une « loi d’airain », même si une telle tendance semble chaque fois se réaliser après les révolutions de la société de classes. Cela dépend «des forces mobilisées contre ces tendances dans des situations concrètes». Par conséquent, le «communisme 1» – en tant que «pleine démocratie rétroactive» liée à la satisfaction des besoins humains – n’était pas un horizon abstrait inaccessible, mais une utopie concrète que cherchaient à atteindre les avancées «impures mais réelles» vers le gouvernement autonome sous le Communisme2. On peut alors concevoir la relation comme celle d’un « communisme plébéien, directement démocratique, libérant et responsabilisant le peuple » versus un « communisme officiel d’État et de partis », Janus à deux-têtes, qui était « en partie vraiment émancipateur mais seulement dans une certaine mesure et assailli par des tentations répressives».
Le concept de Suvin selon lequel la démocratie plébéienne en devenir est une forme de résistance aux relations de domination capitalistes ou bureaucratiques est ici crucial. Pourquoi ‘plébéienne’? Le terme, explique-t-il, vient de « Brecht, avec une pincée de Bakhtine et de Babeuf », et désigne « toutes les classes sociales qui vivent par leur travail physique et / ou mental ». Il dit avoir une petite préférence pour lui plutôt que pour celui de « prolétaires » de Marx, non seulement parce qu’il a été « moins maltraité dans une propagande enthousiaste et moins lié aux travailleurs industriels du XIXe siècle », mais peut-être aussi parce que ses origines romaines mettent l’accent sur « l’élément d’opposition civique au pouvoir d’Etat pernicieux d’une classe dirigeante’ en même temps que ses connotations brechtiennes soulèvent la question «tout aussi importante» d’une position dans le processus de production capitaliste. La même préoccupation pourrait être étendue à d’autres formulations, qui ont toutes leurs forces et leurs faiblesses: les classes dominées ou subalternes, les travailleurs salariés, etc. Suvin soulève ici des questions fondamentales sur la manière de repenser les débats émancipateurs et marxistes, notamment ce qu’il appelle (à la suite de Gramsci) un bloc d’alliances, comprenant à la fois des paysans et des travailleurs précaires et des intellectuels non salariés. Ses remarques sur l’opposition civique peuvent également être reliées à son approche de la politique: contre les vues « classiques », il insiste sur le fait que « le communisme ne peut pas abolir la politique », en tant qu’expression d’intérêts et de choix conflictuels – non réductibles aux intérêts de classe, comme en témoignent les enjeux de genre, de culture, nationaux et environnementaux.
En ce qui concerne les rapports entre les concepts de communisme et de socialisme eux-mêmes, Suvin s’inquiète de la question tout au long du livre. Il explique qu’il a de fortes réserves sur le second terme, à la fois en raison de la confusion entre l’idéal et sa pratique, et – «plus névralgique» – quant à son utilisation pour décrire une époque historique, en particulier lorsque le socialisme est considéré comme «un système clos, une formation sociale unique, mise sur le même plan que le féodalisme et le capitalisme». Mais plutôt que d’utiliser des guillemets embarrassés en caractérisant comme «socialiste» l’expérience yougoslave, il propose sa propre définition, dont le terme crucial est «désaliénation», au sens de ré-humanisation et de gouvernement autonome. Ainsi, le socialisme est «une période de transition (qui peut durer plusieurs générations)» entre un capitalisme exploiteur et un communisme pleinement démocratique: «le terme ‘socialisme’ n’est utile que s’il est compris comme un champ de forces polarisé entre un ensemble d’aliénations de la société de classe et la désaliénation communiste». Le socialisme « ne peut donc jamais être ‘construit’ définitivement comme une maison, et encore moins ‘dans un seul pays’: s’il était finalisé, il ne s’agirait plus du socialisme, mais du communisme démocratique. »
Cependant, entre le socialisme et le communisme – ou entre le « Communisme 2 » et le « Communisme 1 », se pose le problème de la bureaucratie – un autre concept clé auquel Suvin consacre deux études finales. La première explore les discussions sur la bureaucratie et l’État dans le marxisme classique; la seconde traite des débats beaucoup moins connus sur ces sujets dans la Yougoslavie post-révolutionnaire, parmi les dirigeants (Kidrič, Djilas, Kardelj, Tito et Vladimir Bakarić) et au sein de ce que Suvin appelle «l’opposition loyale» socialiste, dans laquelle il intègre l’économiste critique Branko Horvat et des membres clés du groupe Praxis: Mihailo Marković, Dragoljub Mićunović, Gajo Petrović et d’autres. À l’instar de Petrović, Suvin décompose nettement la bureaucratie en général – l’élément «bureau»: les cols blancs maniant des stylos, distinct de l’élément «cratie», ceux qui dirigent. Son point de vue final conserve un caractère paradoxal: le terme de bureaucratie fut tout d’abord utile pour faciliter un débat critique sur l’URSS de Staline, mais son usage a dégénéré en «prévarications stériles sur des ‘strates’ impliquant l’absence d’un antagonisme social plus profond». Néanmoins, aussi problématique que soit le terme, cette « flèche crochue » était cruciale pour tenter d’appréhender mentalement la réalité.
Le livre est hanté par les problèmes conceptuels visant à déterminer si une «nouvelle classe dirigeante» était issue de la direction titiste. Comme Suvin l’explique dans l’introduction, il n’avait pas conclu sur ce sujet jusqu’à la fin de son enquête sur la stratification sociale yougoslave. En effet, des formulations légèrement différentes sont proposées dans différents chapitres du livre qui ont été écrits et partiellement publiés sous forme d’essais distincts – « au sens du Versuche de Brecht, les essais ébauchés dans l’exploration cognitive » – bien que destinées dès le départ à être cumulatifs. Les raisons de ce que Suvin appelle ses «hésitations» sur ce sujet – qui présentent un réel intérêt intellectuel – reposent sur un choix méthodologique fondamental: Splendour, Misery and Possibilities vise explicitement à examiner des questions sociales et politiques imbriquées, non seulement en train de se formuler, mais aussi façonnées par et exprimant des tendances contradictoires, ayant des dimensions nationales et internationales, ouvertes à des choix et à des transformations aux résultats radicalement différents.
Dans ce que l’on pourrait appeler les versions «plus douces» de sa thèse sur la nouvelle classe dirigeante, Suvin décrit une «bourgeoisie potentielle de type comprador», composée de banquiers, de responsables des exportations et de représentants de sociétés étrangères, apparue au cours des années 1970 ou 1980. Il cite, sans discussion, Bakarić, « initié bien informé » en 1971, selon qui « ils n’étaient pas encore des capitalistes, mais ils représentaient le capital ». La version « plus dure » affirme que la « politocratie au pouvoir » de 1950-1961 était une « proto-classe », in statu nascendi, mais qu’aux alentours de 1965-66, une « classe dirigeante consciente d’elle-même » était déjà formée. Cette classe a ensuite été plus ou moins immédiatement fragmentée, car ses fractions ont décidé que leurs intérêts seraient mieux servis en fracturant aussi l’État et en se constituant en classes néo-compradores juridiquement indépendantes (dans le cas de la Slovénie et de la Croatie) ou en misant sur une grande Serbie.» Comme l’explique Suvin, son point de départ était, en termes formels, idéaliste: la recherche d’une « hypothèse générale pour expliquer l’évolution voire l’effondrement de la RSFY» l’a conduit à la conclusion qu’une nouvelle classe dirigeante pourrait «expliquer l’éclatement de la Yougoslavie de la façon la plus économe».
On peut émettre quelques doutes à ce propos. L’insistance de Suvin sur la ‘nouvelle classe’ apparue au milieu des années 60 comme cause de l’éclatement de la Yougoslavie implique de minimiser d’autres facteurs. Comme il le reconnaît, son analyse met de côté outre la question nationale, la période des années 1970 aux années 1990 et les processus ultérieurs de la restauration capitaliste – d’une importance cruciale pour la compréhension du résultat final. Malgré son vif intérêt pour le travail de Kidrič, cela ne lui fournit aucune réponse définitive aux discussions marxistes – de l’Union soviétique des années 1920 au «grand débat» entre Che Guevara, Charles Bettelheim et Ernest Mandel à Cuba dans les années 1960 puis en Tchécoslovaquie, avec Ota Sik – sur la «loi de la valeur», les ratios plan-marché, les stimulants de l’efficacité, dans les sociétés en transition vers le socialisme. En Yougoslavie, cette discussion était également marquée par le caractère de la révolution dirigée par les partisans et donc du « contrat social » sur les droits nationaux et l’autogestion.
Sur ce terrain, l’effet combiné de trois facteurs s’est ajouté aux pressions en faveur du «socialisme de marché». Les républiques plus riches voulaient augmenter leur production librement – pour être «plus efficaces» et donc mieux aider les plus pauvres, comme c’était dit. Deuxièmement, les approches ouvrières et anarcho-syndicalistes ont défendu leurs droits d’autogestion contre le contrôle de l’État et du Parti sur la plus grande partie du surplus, et donc contre la planification centralisée. Troisièmement, certains économistes, marxistes ou pas, ont préféré laisser la loi de la valeur et les pressions du marché «jouer leur rôle», notamment par une plus grande ouverture sur le marché mondial, position soutenue par Suvin et qui a beaucoup influencé à l’époque les discours sur le ‘Nouvel Ordre Economique Mondial’. Quels que soient les aspects justes ou faux de ces approches, elles ne peuvent être simplement identifiées à l’expression ou à la défense de nouveaux intérêts de classe (bourgeois).
Suvin a raison d’insister sur l’importance des facteurs internes pour résister aux pressions en faveur de la restauration capitaliste en Yougoslavie ou pour s’y ouvrir – et notamment les choix politiques en faveur de la mobilisation ou de la répression du peuple. La période de 1968 à 1971, depuis les révoltes étudiantes jusqu’à la première vague du mouvement national croate, fut en effet un moment charnière. Néanmoins, Tito et Kardelj jouaient encore des rôles dirigeants à cette époque. Une analyse concrète du nouveau tournant qu’ils ont présenté lors du Congrès de l’autogestion à Sarajevo en 1971 aurait illustré ce que Suvin appelle le caractère à double face de Janus de ce régime – jouant un double rôle dans l’augmentation des droits des travailleurs et des droits nationaux, tout en réprimant tout mouvement autonome. Cela aurait pu fournir une preuve supplémentaire de son point de vue sur l’exigence organique pour le système d’autogestion d’une forme de démocratie socialiste radicale pour la rendre cohérente. Mais ce n’était pas encore le règne d’une nouvelle bourgeoisie, ni même de «représentants» d’intérêts capitalistes ou ceux du FMI.
La Constitution de 1974-1976 a renforcé les droits des travailleurs et la propriété sociale, démantelant le système bancaire et le pouvoir technocratique dans les grandes usines et élargissant les droits nationaux. Mais cela fut fait sous la pression des républiques les plus riches, qui souhaitaient contrôler leur propre commerce extérieur sans être limitées par les instances fédérales – ou par la mobilisation de travailleurs autogestionnaires. Le résultat de cet équilibre des forces a entraîné une inflation et une dette (interne et externe) croissantes. À son tour, cela a permis la pression du FMI, non pas en conjonction avec une ‘bourgeoisie yougoslave’ à part entière et unifiée, mais avec des bourgeoisies émergentes dans les républiques constituantes. La mort des dirigeants historiques a ouvert la phase finale de 1980-1989. Dans un contexte international en mutation, la dynamique capitaliste au sein du système confédéralisé, coincée entre la pression de la dette extérieure et la résistance sociale aux réformes du marché, a provoqué la résurgence des anciens nationalismes pré-yougoslaves – et d’autres, nouveaux.
Ces remarques discordantes n’atténuent en rien l’apport global de Splendour, Misery and Possibilities, qui va bien au-delà de la thèse de la «nouvelle classe». Suvin a accompli une tâche inestimable en dégageant les fils d’or de la démocratie économique et politique pour la pensée radicale contemporaine. En conclusion, il revient sur le remaniement par Bloch de la relation objet-pensée de Hegel, demandant non seulement si la pensée correspond à l’objet, mais aussi, plus mystérieusement, si l’objet parvient à correspondre à ce qu’il pourrait être – une relation des plus précieuses et des plus névralgiques quand elle fait défaut tout en étant la mesure de la réalisation de « ce qui n’est pas encore ». Suvin demande: «Est-ce que la RSFY avait une tendance potentielle à correspondre à son horizon d’émancipation le plus lointain?». Si tel est le cas, la démocratie plébéienne qu’il postule peut contribuer à une vision utopique utile et concrète. « Mais je ne peux ni le prouver ni en être sûr: elle n’est ‘pas encore’. » Plutôt que de favoriser l’abstraction, il conclut par un paradoxe retranscrit de l’Œdipe de Sophocle à Colonus: « Ce qui est aimé devient amer et l’amertume devient chère. » Très original, conceptuellement fécond, c’est un livre riche et nécessaire.