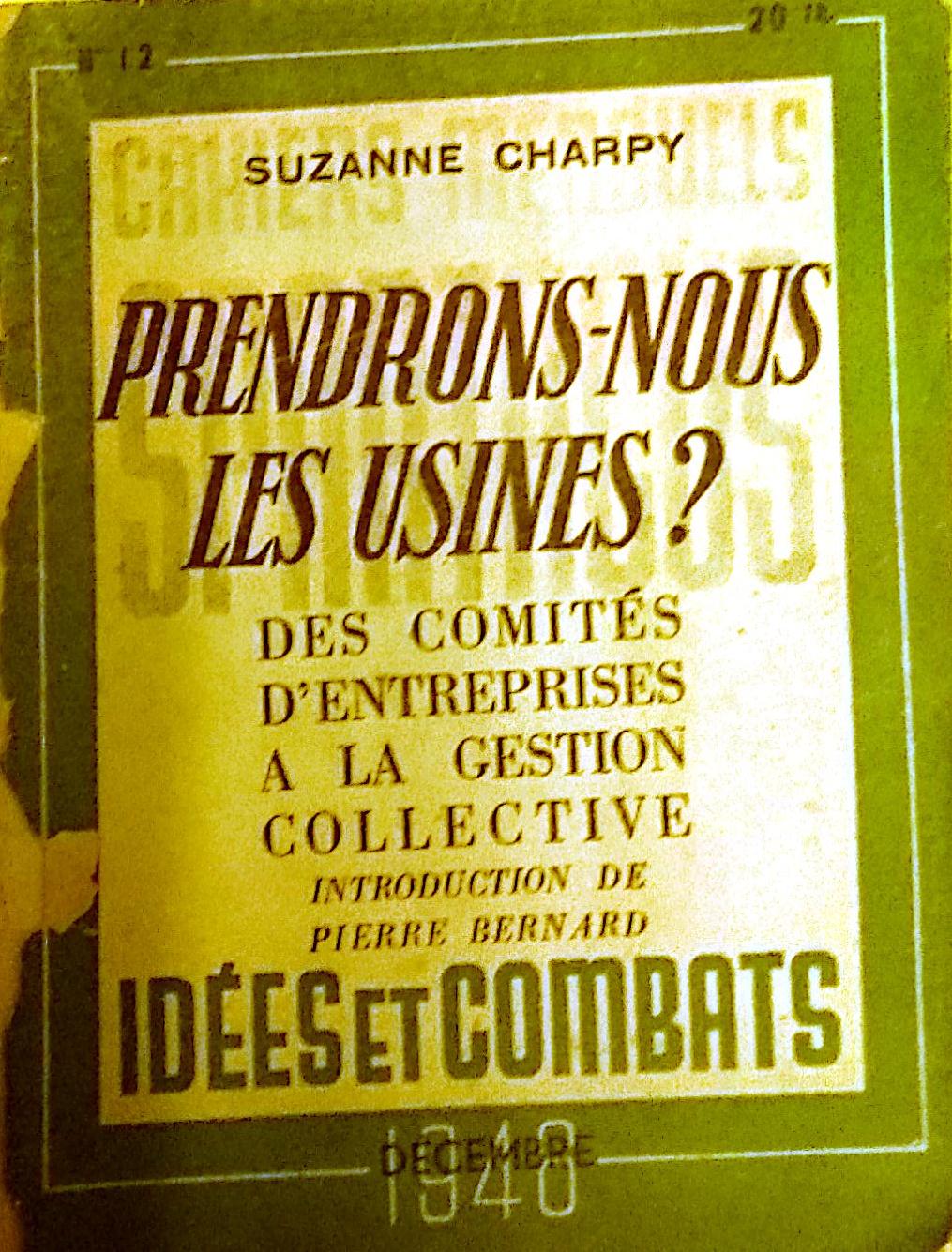La Commune de 1871 mena une politique des services publics qui, compte tenu de sa durée (un peu plus de 60 jours) et des circonstances (la guerre civile), fut assez considérable. Elle n’en réalisa pas intégralement le programme, mais n’en posa pas moins des jalons essentiels. Pour en mesurer la nature et la portée, il faut sans doute rappeler à grands traits quelques épisodes qui précèdent directement et expliquent l’avènement de la Commune, resituer aussi les conditions dans lesquelles elle fonctionna.
Les prémisses. De la guerre franco-prussienne à l’idée de Commune
Au lendemain de la défaite impériale de Sedan face à la Prusse, un gouvernement provisoire proclame la République, le 4 septembre 1870. Dès le lendemain, des Comités républicains de défense nationale sont constitués dans presque tous les arrondissements parisiens, à l’initiative de membres de l’Internationale rejoints par d’autres républicains, socialistes ou radicaux 1 ; loin de s’opposer au gouvernement provisoire, il s’agit d’apporter sa contribution et d’impulser la République. Les Comités d’arrondissements constituent un Comité central parisien dans les jours qui suivent, à raison de 4 délégués par arrondissement, qui revendique les libertés municipales, se propose d’organiser la défense de Paris et de s’occuper de l’administration de la ville. A ce titre, il a désigné en son sein diverses commissions : police, défense, subsistances, travail. En germe, s’esquisse déjà ce que sera le fonctionnement de la Commune.
La « première affiche rouge » du Comité central, placardée le 15 septembre 1870, en dessine le programme. Concernant la sécurité publique, ce programme préconise de supprimer la police impériale et de confier la sécurité publique au soin de municipalités élues, sous l’autorité de magistrats personnellement responsables (les républicains de l’époque sont partisans de l’élection des hauts fonctionnaires et des magistrats), assistés par la Garde nationale (organisée par arrondissements ou par quartiers), composée de la totalité des électeurs.
Pour les subsistances, alors que vient de commencer le siège de Paris par l’armée prussienne, il prévoit :
- le recensement et la réquisition des denrées alimentaires et de première nécessité emmagasinées chez les marchands de gros et détail et leur paiement à prix coûtant après la guerre.
- la répartition de l’approvisionnement entre tous les habitants au moyen de bons délivrés dans chaque arrondissement au prorata : a) du nombre de personnes composant chaque foyer, b) des produits de consommation disponibles, c) de la durée probable du siège.
Il est précisé que les municipalités devront assurer à tout citoyen et à sa famille le logement qui leur est indispensable.
D’autres mesures liées à la guerre et à la défense de Paris sont prévues, notamment l’élection par la Garde mobile de son commandement, l’armement de tous les citoyens, l’envoi d’émissaires en province pour lever une armée, et un contrôle populaire des mesures prises pour la défense.
Le programme n’est pas dirigé contre le gouvernement ; il est franchement républicain et essentiellement défensif. Paris est majoritairement républicain 2. Mais les tenants d’une République formelle – aux premiers rangs desquels les membres de la bourgeoisie libérale – bien que partisans des libertés municipales et favorables aux mesures de sécurité publique, s’effraient devant les termes de réquisition, d’initiative et de contrôle populaire, d’armement du peuple, d’envoi d’émissaires dans les provinces. Ils y voient le spectre de la 1ère République de 1792 et de la Commune sans culotte de 1793. Pour eux, la République doit être garante des libertés fondamentales (libertés politiques, liberté d’expression, liberté de la presse, pouvoirs élus). Pour le Paris populaire, elle ne doit pas se limiter à de grandes déclarations de principe et à des garanties formelles ; elle doit être, fondamentalement et indissociablement, démocratique et sociale. A mesure que les rigueurs du siège pèsent cruellement – différemment selon la situation sociale de chacun et chacune – sur ce Paris qui refuse de capituler, le fossé va s’élargir entre le Paris populaire, de plus en plus exaspéré, et le gouvernement inefficace à organiser sérieusement, tant sa défense que son ravitaillement. Jusqu’à la « seconde affiche rouge » du comité central des 20 arrondissements, le 6 janvier 1871, où on peut lire « on meurt de froid, déjà presque de faim […] on effectue des sorties sans but, des luttes meurtrières sans résultats […] le gouvernement a donné sa mesure, il nous tue…» et l’affiche de conclure « Place au peuple ! Place à la Commune ! » L’heure n’est pas encore venue. Vient la proclamation de l’armistice, publiée le 29 janvier 1871 à Paris, et qui, en réaction, voit les bataillons de la Garde nationale (tant des quartiers bourgeois que des quartiers populaires) nommer chacun leurs délégués pour se constituer en fédération et désigner un Comité central de la Garde nationale pour la défense de Paris , installé fin février 1871. Viennent encore les élections législatives du 8 février 1871 : le parti clérical et les monarchistes, pressés de négocier la capitulation, emportent la majorité à l’assemblée nationale. La guerre n’aurait eu pour effet que de ramener au pouvoir la réaction monarchiste en remplacement de l’Empire ? Vient enfin le 18 mars 1871 et l’échec du coup de force du gouvernement – quittant Bordeaux, il s’est installé à Versailles le 12 mars 1871 – pour s’emparer des canons de la Garde nationale.
Le Comité central de la Garde nationale face à la désorganisation de Paris
Au soir du 18 mars 1871, le chef du gouvernement, Thiers, décide de mener la lutte contre le Paris insoumis, ces centaines de milliers d’ouvriers et ouvrières, et de petits « bourgeois·es » (celles et ceux qui travaillent sans être ouvriers ou ouvrières au sens strict, mais employé.es, comptables, petits artisans, enseignantes et enseignants, journalistes, médecins, hommes de loi, savant·es, artistes). La première mesure est d’ordonner immédiatement à tous les ministères, ainsi qu’à tous les fonctionnaires et agents publics de Paris, de quitter leur poste et de rejoindre Versailles pour finir de désorganiser totalement la ville 3. Du côté gouvernemental, le mépris de classe se transforme en haine. Elle va encore augmenter d’intensité et sera inexorable.

Quant au Comité central de la Garde nationale, le 18 mars il a victorieusement fait face à une agression et il se retrouve, le soir, à l’Hôtel de Ville, acclamé par une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes, à la tête de ce qui devient, par la force des choses, une révolution. Considérant avoir rempli strictement son mandat (la défense de Paris), dès sa première séance du 19 mars, le Comité central décide de proposer de nouvelles élections municipales pour doter Paris d’un organe légitime, et comme mesure d’urgence, il envoie des délégués prendre possession des ministères et des différents administrations. Les Finances, l’Intérieur, la Marine, la Guerre, les Postes et les Télégraphes, la Préfecture de police, sont investis, sans résistance, dès le 19 mars. La désorganisation des différents services est totale. Lissagaray témoigne 4 : « octroi, voirie, éclairage, halles et marchés, assistance publique, télégraphes, tous les appareils digestifs et respiratoires de cette ville de 1,6 millions d’êtres 5, il fallait tout réorganiser. Certains maires avaient enlevé les cachets officiels, les registres et les caisses de leur mairie. L’intendance militaire abandonnait sans un sou 6 000 malades dans les hôpitaux et les ambulances. Il n’est pas jusqu’au service des cimetières que Mr Thiers n’eut essayé de détraquer. Le comité central ne trouvait que des rouages disloqués. » Pour ajouter à la désorganisation, certains bataillons bourgeois de la Garde nationale ne se rallient pas. Le Comité central doit reprendre la mairie du 6ème arrondissement et remplacer les maires et adjoints de quatre autres arrondissements. Ceux des maires et des députés, sincèrement républicains, qui n’ont pas suivi les consignes du gouvernement, tentent une vaine négociation avec le Comité central en vue d’exercer l’administration de la ville au nom de la légalité et de leur légitimité d’élus. Simultanément, ils essaient une médiation auprès du gouvernement 6. Après huit jours et deux reports, les élections municipales du 26 mars 1871 installeront officiellement la Commune.
Sans attendre, le comité central a paré au plus pressé. Les services publics ont recommencé à fonctionner dès le 19 mars. Lissagaray témoigne encore : « On vint de partout. Les comités d’arrondissements fournirent le personnel aux mairies. Les employés restés en poste pour faire passer les fonds à Versailles furent démasqués. 300 000 attendaient les 30 sous quotidiens (il s’agit de la solde du garde national) dont on vivait depuis 7 mois. » Les délégués du Comité central aux Finances obtiennent immédiatement un million de la Banque de France, tiré sur le compte de la ville 7. Malgré la défection des employés du ministère des Finances, on trouve des agents pour répartir les fonds entre les officiers payeurs des arrondissements. La grande majorité des employés de l’octroi étant restés à leur poste, les services sont peu désorganisés et fonctionnent. Le 21 mars, ils versent 500 000 francs de recettes à la Commune. 1,2 millions de francs sont encore disponibles auprès de la Caisse municipale. Le 21 mars, le Comité central suspend la vente des objets engagés au Mont de Piété (elle sera limitée aux objets de moins de 20 francs), proroge d’un mois les échéances pour ne pas s’aliéner industriels et commerçants, interdit aux propriétaires de congédier leurs locataires. Le mouvement né le 18 mars ne se veut pas dictatorial et il garantit la liberté de la presse malgré une campagne diffamatoire du Gaulois et du Figaro.
La Commune et la réorganisation des services publics
La Commune élue le 26 mars poursuit l’action engagée par le Comité central de la Garde nationale. Véritable gouvernement communal, il met immédiatement en place neuf commissions chargées d’administrer les services publics : les finances, la guerre , la police, les relations extérieures, la justice, l’enseignement, le travail et l’échange, les subsistances, les services municipaux. Un des premiers décrets de l’assemblée communale stipule que ses membres sont responsables de l’administration dans leur arrondissement et que le délégué de la Commune aux services publics s’emploie activement à coordonner leur action. On retrouvera constamment le même schéma général d’organisation : tout doit s’effectuer au niveau local, au plus près de la population, et se coordonner au niveau de l’assemblée communale. Les réalisations seront donc variables, selon les situations et les difficultés rencontrées dans chaque arrondissement, mais ce mode de fonctionnement, favorisant l’initiative populaire, est une donnée fondamentale pour comprendre la nature et la portée de l’action de la Commune.
Pour le ravitaillement, l’approvisionnement se fait par la zone comprise entre Paris et les lignes du siège, ces villes et bourgades accolées à Paris qui sont encore largement agricoles et maraichères 8. Dans la plupart des services municipaux, on l’a dit, les comités d’arrondissement fournissent les bonnes volontés. L’entretien de la voirie et le service des cimetières sont assurés. L’éclairage public (au gaz) connait quelques restrictions. Les services d’incendie, ceux des poids et mesures, sont réorganisés. Les bureaux de l’état-civil fonctionnent. Les musées et les bibliothèques publiques sont réouverts au public.
L’administration de la Poste pose un gros problème. Le directeur, Rampont, est resté à son poste, mais pour mieux désorganiser. Il donne l’ordre aux fonctionnaires de rallier Versailles et s’enfuit le 30 mars, ainsi que les receveurs, en emportant les fonds (le numéraire, les planches de timbres, les valeurs). Nombre d’agents, de chefs et sous-chefs de bureaux, ne se présentent plus pour prendre leur service. D’autres, indécis, restent dans l’expectative. La Commune doit stopper l’hémorragie en rappelant « qu’aucun agent ne peut s’absenter sans autorisation ». Il s’agit de remettre au plus vite la machine en route. C’est un ouvrier ciseleur en bronze, membre de la commission du travail et de l’échange, qui est chargé de réorganiser les services postaux. Il fait appel aux premiers commis, aux facteurs chefs, et réforme la composition et le rôle du Conseil de la Poste qui existait précédemment : désormais, il aura un rôle consultatif et sera composé du directeur général, de son secrétaire, du secrétaire général, de tous les chefs de service, de deux inspecteurs et de deux facteurs chefs. Après deux jours, le 2 avril, la Poste intra muros fonctionne à nouveau. Pour pallier le manque de timbres, la griffe « port payé » attestera du paiement en numéraire. Pour les correspondances avec l’extérieur, le blocus du courrier 9 est contourné, des agents auxiliaires rusent chaque jour pour poster du courrier depuis les villes qu’on peut atteindre (Saint-Denis, Vincennes, Charenton, Créteil, etc.). Un projet d’acheminement par ballon sera envisagé, mais les conditions matérielles sont trop difficiles à remplir pour y parvenir. L’écart des salaires sera fortement réduit : avant la Commune, le directeur percevait 71 000 francs annuels, le facteur entre 800 à 1 000. Le 6 avril, un décret communal indique qu’il n’y aura plus de salaire annuel inférieur à 1 200 francs, et que le maximum est limité à 6 000 francs ; le cumul de rémunérations est interdit. En accord avec la Commission du travail et de l’échange, une tournée de facteur est supprimée pour alléger la journée de travail. Enfin, le service de la censure (le cabinet noir) est supprimé. A la Poste comme dans les autres administrations, dans les services municipaux, la Commune a dû pallier dans l’urgence les défections. Elle veut, en outre, s’inscrire dans la durée et réformer en profondeur le mode de recrutement. Pour en finir avec le pouvoir discrétionnaire des préfets, des directeurs, des chefs et sous-chefs, en vigueur sous l’Empire, et avec la corruption qui y était attachée, les recrutements devront à l’avenir être basés sur les compétences, par examen ou par concours. Le Journal officiel témoigne d’initiatives en ce sens, mais l’assemblée communale n’aura pas le temps de finaliser cette mesure ni de la mettre en œuvre. En tout cas, la tentative de désorganisation a échoué, Paris ne s’est pas effondré. La ville a fait face et a trouvé une nouvelle respiration.
De son côté, le gouvernement a eu le temps et les moyens de se préparer à l’agression militaire contre la Commune. Elle commence le 2 avril et ne va plus cesser, jusqu’au 28 mai, date de l’écrasement final. Aux difficultés déjà évoquées, s’ajoute la prise en charge des populations sinistrées par les bombardements, qu’il faut reloger en réquisitionnant les logements vacants. Il faut également soutenir les veuves et les orphelins des gardes nationaux tués aux combats ou faits prisonniers. Paris est désormais acculé. C’est pourtant dans ce laps de temps que la Commune va engager ses réformes les plus emblématiques.
La commission de la justice
Cette commission eut le plus grand mal à fonctionner. Il fallait trouver des magistrats, des greffiers et autres auxiliaires de justice, dont l’écrasante majorité était portée à servir Versailles plutôt que la Commune. Malgré ces difficultés, le délégué de la Commune à la justice, l’avocat Protot, fut pratiquement à lui seul 10 l’artisan d’une réforme visant à faire rendre la justice par des jurys élus, et à rendre son accès gratuit. Sous son impulsion, le 23 avril, la vénalité des offices est supprimée : les officiers publics doivent recevoir un traitement fixe de la Ville. Le temps manqua pour prendre les décrets d’application, mais le 16 mai, la Commune décrète à nouveau la gratuité des actes établis par « les notaires, huissiers et généralement tous les officiers publics ». Concernant l’action de la police, le décret du 14 avril stipule que toute arrestation ne peut être maintenue plus de 24 heures sans en référer aux instances judiciaires. L’assemblée communale interdit également toute perquisition ou réquisition non ordonnée par des mandats réguliers. Le but est d’encadrer judiciairement l’action de la police, pour empêcher l’arbitraire policier. La mesure n’alla pas sans accrocs avec les services de la préfecture de police (déjà !), où régnait la plus grande confusion, dans ce Paris assiégé qui voyait s’activer les agents de Versailles (réels et fantasmés). S’agissant des prisons, le 23 avril la Commune décide d’organiser les visites des prisons. Condition préalable pour préparer une réforme du régime carcéral, qui n’aura pas le temps de voir le jour.
Le 19 avril, la commune réaffirme son programme : il ne s’agit pas de gouverner la France ni de lui imposer des lois, mais d’affirmer son autonomie de gestion et de fonder ses propres règlements. « Paris ne veut rien de plus à condition de retrouver dans l’administration centrale, délégation des communes fédérées, la réalisation et la pratique de ces mêmes principes » peut-on y lire. A la république « des élites », la Commune oppose sa propre conception d’une république fédéraliste qui impulse et favorise l’initiative citoyenne 11.
La commission du travail et de l’échange, ministère de « l’émancipation du travail »
La commission du travail et de l’échange (composée presque exclusivement de membres de l’Internationale) fut elle l’ancêtre du ministère du travail, comme il a souvent été dit ? Il y a des différences fondamentales. Le ministère du travail, créé trois décennies plus tard, sera d’abord une réponse à l’essor du mouvement syndical, pour le canaliser et le soustraire à l’influence du syndicalisme révolutionnaire. L’action de la commission du travail et de l’échange fut, à l’opposé, de favoriser le libre développement des associations ouvrières et des chambres syndicales.
Le premier problème que doit résoudre la commission, est celle du chômage massif de dizaines de milliers d’ouvriers et ouvrières, avec tous ces établissements tombés en déshérence ou abandonnés par leurs propriétaires. On ne retiendra pas la solution des ateliers nationaux (installés par la Révolution de 1848), mais la voix coopérative. La commission va agir en deux directions complémentaires. La première consiste à recenser le travail immédiatement disponible, la seconde à remettre en marche les locaux de travail vacants. Dès le 2 avril, on trouve dans toutes les mairies deux registres : l’un où chacun, chacune est appelé·e à inscrire sa profession, ses demandes et ses conditions ; l’autre, destiné aux entrepreneurs de toutes sortes, fabricants, négociants, etc., pour y noter leurs offres de travail « au moyen d’un cahier des charges détaillant la nature et les conditions du travail ». C’est bien un service public de l’emploi qui est mis en place, car il s’agit aussi de supprimer les bureaux de placement de main d’œuvre, tous surveillés par la police et où les placeurs prélevaient de substantielles commissions. C’est aussi, avec 16 ans d’avance, la raison qui sera invoquée pour créer les premières Bourses du travail.

Le décret du 16 avril invite les associations ouvrières à constituer une commission, pour dresser la liste des ateliers abandonnés et étudier les conditions de leur remise en marche. Cette commission ouvrière doit travailler complémentairement à la commission du travail et de l’échange et un local est mis à la disposition de l’Internationale et des chambres syndicales. Des commentateurs ultérieurs trouvèrent ce décret bien timide. Ne s’agissait-il donc que de faire des statistiques et des études ? Le décret prévoyait même d’étudier la question de l’indemnisation ultérieure de leurs propriétaires à leur retour. Toujours est-il que les chambres syndicales s’en emparent. Désorganisées par l’empire, elles connaissent alors un nouveau développement et de nouveaux groupements affiliés pour remettre en marche ces établissements. La commission ouvrière porta les revendications à la commission du travail et de l’échange qui s’efforça de les satisfaire. Au 18 mai, la commission ouvrière est composée de toutes les corporations organisées (mécaniciens, tailleurs, cordonniers, ébénistes, menuisiers, bijoutiers, lithographes, etc.). Chacune y est représentée par 5 délégués nommés (et révocables) par leurs assemblées générales, qui élisent la commission exécutive.
Concernant le travail des femmes, la commission du travail et de l’échange peut s’appuyer sur l’Union des femmes pour la défense de Paris, particulièrement active et exigeante 12. Agissant en véritable chambre syndicale, l’Union des femmes revendique auprès de la commission du travail, la charge de réorganiser et de distribuer le travail aux parisiennes, en commençant par ce qui touche à l’équipement militaire. Elle rouvre les ateliers abandonnés comprenant des métiers essentiellement pratiqués par les femmes, et demande à la commission du travail et de l’échange de mettre, à la disposition des associations productrices fédérées, les sommes nécessaires pour l’exploitation de ces fabriques. A la veille de la semaine sanglante, le 20 mai, les premières associations productives de travailleuses sont déjà fédérées. Les statuts de cette fédération précisent que ces membres sont affiliées à l’Internationale (article 1), dépendent des comités d’arrondissement de l’Union des femmes (article 2), que chaque association conserve son autonomie pour son administration intérieure (article 4), et que la direction de chaque association est assumée par une commission librement élue par les sociétaires (article 5). Mi-mai, nombre d’ateliers, d’écoles et d’ateliers-écoles fonctionnent déjà avec l’aide active de la commission du travail et de l’échange. Pour autant, on ne toucha pas aux entreprises qui avaient continué à fonctionner. Une seule fut expropriée : la fonderie Brosse dans le 15ème ; encore s’agissait-il d’une vieille coopérative, que le gérant s’était abusivement approprié. Sur le marché, il y avait cohabitation entre établissements capitalistes et établissements coopératifs socialisés.
La commission va donc agir sur la commande, à commencer par la commande publique. La circulaire du 28 avril invite « les mairies, ministères, et administrations publiques à faire leurs achats de toutes sortes absolument de préférence aux Associations de production ». A elles, les travaux disponibles. Ainsi, pour ne prendre que quelques exemples, l’association générale typographique devint en quelque sorte l’Imprimerie « communale ». L’association corporative de fondeurs en suif soumissionne pour l’exclusivité du marché de matières premières et obtient un crédit de la commission (2 500 francs) qu’elle s’engage à rembourser dans un délai de trois mois. Les tailleurs (qui comptent au moins un groupe associé par arrondissement) protestent contre l’intendance de la Garde nationale, qui a « cassé un marché de 2 000 pièces de pantalons et de vareuses » au profit d’entreprises capitalistes, qui peuvent le faire à moindre coût ; ce n’est qu’en diminuant le prix du travail dénoncent-ils ! La commission intervient pour que les tailleurs récupèrent le marché. C’est l’application d’une clause sociale aux marchés publics.

et les soins aux blessés, pour constituer les chambres syndicales,
17 mai 1871
Plusieurs établissements appartenant à la ville ou à l’Etat, étaient administrés en régie directe. Ils sont tout naturellement communalisés et placés sous la supervision de la commission du travail et de l’échange. L’établissement de fabrication des Monnaies et Médailles (malgré des difficultés d’approvisionnement en matières premières) et la manufacture des Gobelins fonctionnent. A l’Imprimerie nationale, ce sont désormais les ouvriers qui élisent les chefs d’atelier. A l’atelier de fabrication et de réparation d’armement du Louvre, un conseil de direction et de surveillance est constitué, composé du délégué à la direction, du chef d’atelier, des chefs de bancs, et d’un ouvrier de chaque banc. Tous sont directement élus par les ouvriers et révocables. Le mandat des délégués est renouvelable tous les quinze jours. Le nouveau règlement comporte également des dispositions relatives aux conditions d’embauche et de renvoi des ouvriers (pour incapacité notoire, inconduite ou en cas de diminution de travail). Il fixe la durée du travail (10 heures par jour) et les salaires : 250 francs par mois pour le délégué à la direction ; il ne pourra toutefois pas excéder 60 centimes de l’heure pour les ouvriers « quant à présent et vu l’état de guerre ». La commission du travail et de l’échange, si elle fut un « ministère du travail », s’attacha en outre à émanciper le travail en le soustrayant à l’exploitation du capital, selon la conception générale qu’on se faisait du socialisme au 19éme siècle.
Laïcité, enseignement, des actes d’une grande modernité
Il serait sans doute abusif de prétendre que les parisiens et parisiennes étaient, toutes et tous, athées ou agnostiques. Massivement, ils et elles étaient farouchement anticléricaux et ne supportaient plus la férule de l’église (catholique) sur tous les actes de la vie publique et privée. La Commune entreprit de laïciser les institutions. « La Commune de Paris, Considérant que la liberté de conscience est la première des libertés. Considérant que le budget des cultes est contraire au principe, puisqu’il impose les citoyens contre leur propre foi. Considérant que le clergé a été le complice des crimes de la monarchie contre la liberté. Décrète : 1) L’Eglise est séparée de l’Etat, 2) Le budget des cultes est supprimé, 3) Les biens dits de mainmorte appartenant aux congrégations religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés propriétés nationales, 4) Une enquête sera faite immédiatement sur ces biens pour en constater la nature et les mettre à la disposition de la Nation. » Ce décret méritait d’être retranscrit. Il ne s’agit pas de la loi de 1905 sur la laïcité. Nous sommes 34 ans plus tôt, le 3 avril 1871. Ce qui est en cause, ce n’est pas la croyance de chaque personne ; c’est l’institution religieuse, en tant qu’instrument politique et religion d’Etat. Concrètement, les congrégations tiennent des bureaux de bienfaisance, les religieuses servent dans les prisons pour femmes et à l’Assistance publique (Paris compte alors quinze hôpitaux et hospices). Le dogme religieux s’exerce partout, jusque dans l’Etat-civil et l’enseignement, dont l’institution catholique exerce la tutelle.
Paris compte alors 250 000 enfants scolarisables, qui se répartissent à peu près à parts égales : 1/3 fréquentent les écoles religieuses, 1/3 les écoles communales. Mais quelle que soit l’école, l’église fournit des enseignants et a la haute main sur les contenus de l’enseignement 13. 1/3 enfin des enfants n’est pas scolarisé. Début avril, la Commune institue l’instruction laïque, gratuite et obligatoire. Toujours sur les mêmes principes, c’est au niveau des arrondissements que s’accomplit la réforme. La commission de l’enseignement, jouant un rôle superviseur, s’efforce de hâter, d’harmoniser, d’aider à la recherche de solutions. Les tâches sont de trois ordres et elles sont immenses. Il s’agit d’abord de récupérer les locaux et de briser l’opposition des congrégations ; il faut aussi trouver et recruter des enseignants et enseignantes ; et enfin, définir de nouveaux principes pédagogiques. Les religieux opposèrent une vive résistance. Ils allèrent jusqu’à molester les laïques qui se présentaient dans les écoles ; parfois ils démissionnèrent « à effet immédiat », laissant l’école entièrement déserte. Cette opposition occupa une bonne partie du mois d’avril. Progressivement, les écoles laïques s’installent. Elles peuvent compter sur celles et ceux des enseignant.es qui, n’ayant pas prêté serment sous l’empire, avaient déjà ouvert des écoles indépendantes. Ils et elles font des émules dans le corps enseignant. L’Union des femmes s’active à créer des écoles de filles, jusque-là si rares. Il n’est pas jusqu’aux artistes qui ne se proposent pour l’enseignement du dessin et du modelage dans les écoles primaires et professionnelles communales. En matière d’enseignement, on prône « la méthode expérimentale ou scientifique, celle qui part de l’observation des faits, quelle qu’en soit la nature : physiques, moraux, intellectuels ».
La nouvelle éducation se veut professionnelle et intégrale. Il faut que l’enfant passe alternativement de l’école à l’atelier, afin qu’il puisse gagner sa vie tout en développant son esprit. On commence alors à créer, tant pour les filles que pour les garçons, des écoles professionnelles. Malgré l’urgence – l’armée gouvernementale est entrée la veille dans Paris, les combats de rue ont commencé – la première école professionnelle ouvre le 22 mai, rue Lhomond, dans le 5ème arrondissement. Elle est destinée aux enfants à partir de 12 ans. Les ouvriers de plus de 40 ans qui veulent se présenter comme maitres d’apprentissage sont invités à se faire connaître en mairie ; dans le même temps, il est fait appel aux professeurs de langues vivantes, de sciences, de dessin et d’histoire. L’enseignement supérieur et les étudiants (pourtant de toutes les insurrections républicaines) ne furent pas au rendez-vous de la Commune. Cette révolution sociale leur était trop éloignée, celles et ceux qui la faisaient trop inconnus d’eux (et peut être trop égalitaires). Il se créa quand même un syndicat étudiant, peut-être le premier, le 12 mai. Un des derniers actes que pût prendre la Commune fut de décréter l’égalité salariale entre les instituteurs et les institutrices. Premier décret de cet ordre, il tomba avec elle. L’enseignement, comme les autres grands changements entrepris par la Commune, n’eut pas le temps de produire ses pleins effets. Le 28 mai, après une semaine de combats rue par rue, maison par maison, la Commune était écrasée. Tout était fini…
Vous êtes sûr·es que c’est vraiment fini ?
Que reste-t-il des promesses de la Commune en matière de services publics ? Un examen superficiel pourrait laisser croire que la République, avec le temps, a fini par en réaliser la plupart. La Fonction publique est dotée, depuis 1946, d’un statut qui définit l’exercice de ses missions et la protection de ses agents contre l’arbitraire. Mais depuis une trentaine d’années, les services publics sont méthodiquement appauvris, privatisés, leurs agents de plus en plus souvent recrutés hors statut, et l’accès aux services publics est rendu de plus en plus difficile. La Justice est toujours inégalitaire, avec la procédure des comparutions immédiates, justice d’abattage qui fournit la majorité des condamnations. Les conditions carcérales sont indignes et continuent de faire de la prison, l’école du crime. La Police nationale (créée en 1942 sous Pétain) jouit de pouvoirs discrétionnaires et d’une impunité dignes de l’ancien régime. L’enseignement aujourd’hui est obligatoire, laïc et théoriquement gratuit. Mais le but qui lui est assigné n’est pas tant l’épanouissement des capacités de chacun et chacune, que la reproduction des inégalités sociales, la valorisation de la concurrence et la promotion de la réussite individuelle. Des lois obligent en outre le financement public des écoles privées et confessionnelles. Le Ministère du travail est de plus en plus ouvertement au seul service du patronat. Il se montre inopérant en matière de fermetures d’entreprises. Les protections du code du travail sont progressivement détruites. Il n’est sans doute pas fortuit que le président Macron ait choisi le 4 septembre pour commémorer l’avènement de la République. Oubliant les deux premières (1792 et 1848), il s’inscrit dans la continuité de celle dont l’acte fondateur fut précisément l’écrasement de la Commune. Mais les institutions et la démocratie sont en crise. Cette démocratie exigeante et vivante fut l’apanage de la Commune, et non celle des « élites » qui ont fait de la politique un métier. La crise sanitaire actuelle montre que, face à l’impéritie et à l’autoritarisme du gouvernement, les capacités d’initiatives solidaires et l’aspiration à plus de démocratie existent toujours.
Notes:
- A ce moment-là, la section parisienne de l’Internationale et les chambres syndicales – qui n’en sont pas toutes membres, loin de là – se relèvent difficilement de la répression impériale exercée durant la deuxième moitié des années 1860. Ceci explique leur faible poids numérique. Elles n’en joueront pas moins un rôle très influent, et se renforceront, durant la Commune. ↩
- En témoignent les élections municipales organisées par le gouvernement du 5 au 8 novembre – à raison de 3 conseillers par arrondissement quel que soit leur nombre de personnes y habitant (150 000 dans le 11ème, 45 000 dans le 16ème) – et les élections nationales organisées à la hâte, le 8 février, sous la pression des autorités allemandes soucieuses de négocier rapidement les termes de la capitulation. ↩
- Les employé·es des différents services publics sont, soit fonctionnaires, soit des agents de droit privé, dans des proportions variables selon les services . On estime aux trois-quarts, le nombre d’agents publics qui rallieront Versailles. ↩
- Histoire de la Commune de Paris, Prosper-Olivier Lissagaray, 1876 (Réed. Editions La Découverte). ↩
- En réalité, à la veille du siège de Paris, la ville comptait près de deux millions d’habitantes et habitants. La différence s’explique par les morts dues à la guerre et aux rigueurs du siège, par les départs vers la province, avant le début du siège, de ceux et celles qui le pouvaient et, aussi, par les ralliements à Versailles. ↩
- Vaine tentative, traitée avec mépris par le gouvernement et l’Assemblée nationale. Devant l’échec de leurs tentatives, ces maires démissionneront, sans pour autant rallier Versailles. ↩
- Le sous gouverneur de la Banque de France, marquis de Ploeuc, va négocier habilement pour que les délégués ne tirent que les sommes appartenant à Paris, et encore pas toutes. Il déclarera par la suite, qu’au 18 mars le solde créditeur de la Ville était de 9,4 millions et qu’il n’en n’a été donné en tout, et non sans réticences, que 7,3 millions. Les délégués, scrupuleusement fidèles à leur mandat et pour ne pas s’aliéner la province, ne toucheront pas aux sommes en compte pour le reste de la nation. Malheureusement, la même attitude prévaudra, non sans débats, tout au long de la Commune et on ne prendra même pas la Banque de France en otage pour faire pression sur le gouvernement et la finance. Le gouvernement n’aura pas ces scrupules et tirera sans difficulté des sommes autrement considérables, pour mener son action et équiper son armée de guerre civile. ↩
- L’armée prussienne encercle l’est parisien, depuis la Marne jusqu’à la Seine à l’ouest de Saint Denis ; l’armée versaillaise ferme la boucle, depuis la Seine jusqu’à Villeneuve-Saint-Georges. ↩
- A Versailles, le gouvernement organise le blocus postal et refuse de payer les mandats émis à Paris. ↩
- C’est pourquoi il est le seul délégué de la Commune cité dans cet article. L’action des autres délégués s’inscrit dans un cadre beaucoup plus collectif et plus large, ce qui ne retire rien à leur engagement et à leurs mérites personnels. En citer certains, sans les citer tous, ne serait pas leur rendre justice. Citer les délégués, sans citer les « anonymes », ne rendrait pas compte de l’initiative populaire qui irrigue l’action des commissions. Le dossier du Maitron, « la Commune de Paris 1871 » compte pas moins de 450 biographies. ↩
- De toute évidence, cette proclamation n’est plus destinée à être entendue du gouvernement de la jeune République, pour lequel le fédéralisme – et moins encore l’initiative citoyenne – n’est pas une option, mais de la province, pour contrer désinformation et propagande versaillaises. ↩
- Son nom complet est « Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés ». Elle se structure avec un comité de onze membres dans chaque arrondissement, d’où émane un comité central. Si elle ne revendiqua pas le droit de vote pour les femmes (sans doute considéra-t-elle que ce n’était pas le combat prioritaire du moment), elle affirma énergiquement leur citoyenneté quotidienne dans tous les domaines de la vie sociale. Elle revendiqua l’armement des femmes et leur droit à combattre, leur place dans les soins aux blessé·es et dans les ambulances et fut particulièrement active en matière de travail et d’enseignement. Versailles porta une haine particulière à cette Union et à ses membres, et leur réserva une campagne de calomnies abjecte. ↩
- L’article 1 du règlement de 1870 des instituteurs de la Seine stipule que « le principal devoir de l’instituteur est de donner aux enfants une éducation morale et religieuse et de graver profondément dans leurs âmes le sentiment de ce qu’ils doivent à Dieu ». ↩