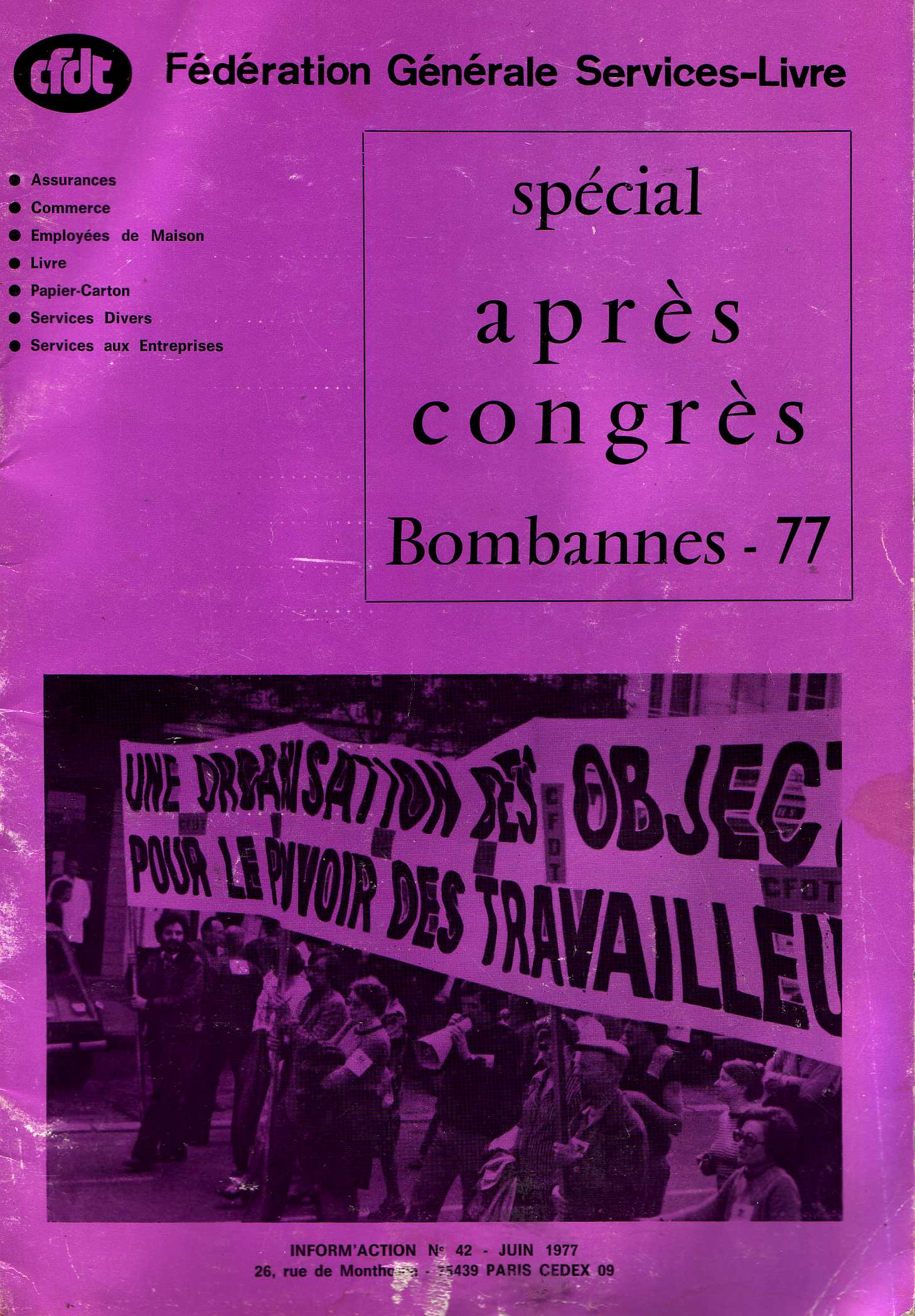La bibliographie sur la Commune est surabondante. Les interprétations sont multiples. Les clauses pullulent. Et le mythe de la Commune, rechargé cent fois d’affectivités personnelles et collectives, épouse trop étroitement l’histoire objective.
Le spontanéisme de la Commune, le charisme d’un peuple parisien révélant, par l’intermédiaire d’un groupe d’hommes hétérogènes, aux idéologies confuses ou mêlées et à l’action prophétique, la véritable voie révolutionnaire du socialisme démocratique : nous trouvons là une des images type primordiale qui se dégage des très nombreux volumes écrits sur cette épopée socialiste, la première des révolutions prolétariennes.
Cent ans après, les cendres sont plus que brûlantes. Et la révolution russe à ses débuts, celle des Soviets de 1917, en reconnaissant dans cette Commune de 1871 le brouillon de sa propre histoire, les a fait flamber très violemment.
Et maintenant, après les crises vécues par le monde socialiste et occidental, la grande lumière de 72 jours communards apparaît à beaucoup, après bien des tentatives et récupérations diverses, comme un modèle à la fois précipité et anticipé de la révolution de demain.
Cette valeur mythique de la Commune, son importance mobilisatrice doivent être soulignées dès l’abord – et Henri Lefebvre l’a fait magistralement 1.
Mais en même temps comment ne pas se rendre compte de deux faits frappants.
En premier lieu on se doit de constater qu’au milieu de si nombreuses « réécritures » et d’histoires plus attrayantes que sérieuses, il n’existe qu’une très petite quantité de livres à la fois originaux et objectifs.
On est également particulièrement étonné de se rendre compte que dans le petit nombre d’ouvrages de ce type il n’y en a aucun, à notre connaissance, qui ne soit l’œuvre d’un spécialiste, voire d’un très bon connaisseur de la pensée proudhonienne. Or, tous (et l’ouvrage marxiste comme les non-marxistes) constatent l’influence primordiale (bénéfique ou néfaste) sur la Commune de la pensée Proudhonienne et les Proudhoniens.
Aussi se contente-t-on généralement d’affirmer globalement ou épisodiquement l’influence de Proudhon sur les hommes, les textes et les réalisations de la Commune sans pousser le plus souvent l’analyse au-delà de simples mentions et de quelques éléments caractéristiques.
Un recensement systématique, une confrontation méthodique, un bilan positif-négatif des rapports Proudhon- Commune n’existe pas encore malgré l’amorce remarquable de livres ou de commentaires de Communards, comme ceux de Lepelletier, Lefrançais et Charles Longuet, et les ouvrages contemporains comme ceux d’Albert Ollivier et surtout Henri Lefebvre 2.
Sans avoir la prétention de pallier ce manque dans cette étude, nous voudrions cependant y contribuer.
Pour ce, on s’efforcera de faire appel non seulement aux rapprochements de toute une série de documents de faits et de livres portant sur la Commune, mais à leur analyse et à leur synthèse confortées par
une connaissance approfondie de la pensée proudhonienne 3.
Le fait proudhonien de la Commune
Avant d’en examiner les causes, les manifestations et les prolongements, il convient d’abord de poser le fait Proudhonien de la Commune.
A l’appui de ce fait essentiel : l’importance de l’idéologie proudhonienne et des Proudhoniens, il est nécessaire de rappeler en prémisses quelques témoignages déterminants ex traits des ouvrages les plus objectifs et les plus marquants.
Ce fait est particulièrement souligné après une fine analyse des idéologies par Henri Lefebvre qui ne craint pas d’écrire très nettement :
« La seule idéologie qui présente un projet politique, c’est alors le fédéralisme et cela malgré tout ce que l’on peut dire sur l’apolitisme et le réformisme des Proudhoniens » et, soulignant le caractère dominant et la diffusion extrême de l’idéologie proudhonienne, il conclut : « qui ne se réclamait pas de Proudhon en 1870-1871 ? la raison de ce constat formulé par deux écrivains marxistes particulièrement objectifs 4 nous pensons que nous l’avons mise en lumière » 5. Pour lui, autogestion économique, fédéralisme politique, ces deux idées force de la Commune sont indiscutablement proudhoniennes. « D’une part la grande idée de la Commune, idée que les marxistes ne peuvent rejeter, à savoir la gestion démocratique de leurs affaires par les citoyens réunis en conseils, commissions et comités, cette idée ne peut se séparer du Proudhonisme qui le premier l’exposa» 6.
D’autre part, par son fédéralisme économico-politique et sa conjonction d’une démocratie industrielle et d’une démocratie agricole, « seule la doctrine proudhonienne devait permettre et permit à Paris de s’adresser aux provinces, aux ouvriers de s’adresser aux paysans en leur proposant un programme » 7.
Les auteurs d’un des meilleures ouvrages marxistes sur la Commune 8, Jean Bruhat, Jean Dautry et Emile Tersen, sont aussi explicites, malgré leurs interprétations données et leurs réserves réaffirmées.
« Dans une large mesure, les Communards sont Proudhoniens … C’est l’influence de Proudhon qui l’emporte 9. « Les Proudhoniens dominent le Comité central »: 10 et rien que « parmi les trente Internationaux élus de la Commune, près des deux tiers peuvent être considérés comme Proudhoniens » 11.
En dehors de ces deux témoignages dont le sérieux, la probité historique en même temps que l’attachement au marxisme (de stricte ou de large obédience) ne peuvent être contestés, le Proudhonisme de la Commune est longuement, quoique non systématiquement, mis en relief par le livre d’Albert Ollivier, fort critiqué par ailleurs, vis-à-vis de l’attitude de Marx par rapport à la Commune. Pour ce dernier, Proudhon, dans sa personne, son action et son idéologie, est un des pères de la Commune, et comme sa signification. « Le militant » Proudhon « c’est l’homme de la Commune de 187 l » 12. Il lui a donné « non seulement des idées neuves mais encore un climat révolutionnaire particulier » 13, une révolution qui n’est pas violence et appropriation du pouvoir mais science et diffusion du pouvoir. Ainsi, au-delà du dogmatisme jacobin de la vieille garde, du verbalisme du groupe des jeunes romantiques révolutionnaires et de l’activisme du petit « noyau » des purs Blanquistes, « la Commune dès qu’elle voulut dépasser le stade lyrique et faire une profession de foi fédéraliste, ne put que vulgariser les idées de Proudhon 14. Ces trois témoignages contemporains de spécialistes de la Commune sont caractéristiques. La diversité idéologique de leurs auteurs, notamment vis-à-vis du Marxisme et du Proudhonisme (pour tenté que l’on soit de les opposer ou de les conjuguer) et l’unité des observations objectives de leurs ouvrages les rendent particulièrement exemplaires.
Pour conforter cette affirmation première du fait Proudhonien de la Commune, il convient d’adjoindre à ces constatations celle d’un Communard particulièrement objectif, le seul qui se soit véritablement livré à une analyse des sources idéologiques de la Commune : Edmond Lepelletier.
Jean Bruhat, Jean Dautry et Émile Tersen d’une part, et Henri Lefebvre d’autre part ont précisément et très justement insisté sur l’importance et le sérieux de cet acteur (délégué de la Commune au Conseil d’État) et historien de la Commune. Pour eux, et notamment pour le dernier, le livre de Lepelletier constitue non seulement « une bonne documentation » mais parmi tous les ouvrages des Communards il mérite une « mention spéciale » comme celui « de l’auteur de la plus ample tentative d’histoire de la Commune » qui a su poser objectivement « la question des antécédents historiques et politiques de la Commune» 15.
Co-gérant du « Tribun du peuple » avec Lissagaray 16, il ne verse pas comme ce dernier dans le style romancé et les procédés d’auteur dont le charme et le vivant incontestable ont séduit et séduisent mais qui ne sauraient conférer, à son livre, une importance autre que celle d’un très intéressant document littéraire. (« Il est impossible de faire entièrement confiance à Lissagaray », écrit très justement Lefebvre.)
Amplement informé sur Proudhon et sur sa doctrine, favorable à un fédéralisme modéré, il n’est pas pourtant à proprement parler Proudhonien, ni même socialiste, pas plus que blanquiste, mais s’apparente aux républicains radicaux. Il n’écrit donc pas comme le feront Lefrançais et Arnould dans leur livre[çef]Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, Bruxelles, 1878.[/ref], ou Jules Vallès dans ses témoignages 17, des plaidoyers forcément quelque peu partisans.
« Deux hommes, note-t-il, deux esprits puissants tout à fait dissemblables dont les disciples et partisans furent souvent antagonistes, exercèrent seulement une influence sur les esprits. On peut les considérer comme les générateurs de la révolution de 1871. C’était P.J. Proudhon et c’était Blanqui … En ces deux absents on peut voir les véritables chefs de la Commune ». Si revient à Blanqui l’institution du Comité de Salut Public, l’apport de Proudhon est, selon lui, beaucoup plus essentiel : « Proudhon fut avant tout l’apôtre du principe fédératif sur lequel repose le mouvement Communaliste… il a eu sur les idées et sur les chefs du prolétariat français avant la Commune une action souveraine et qui s’est prolongée » 18. Aussi, pour Lepelletier, la Commune est-elle avant tout la mise en action du principe Proudhonien : la république fédérale, « la Commune de 1871, par le programme que ses membres acceptaient, désiraient réaliser, apparaît donc comme procédant directement de Proudhon » 19.
Le livre d’Arthur Arnould, celui de Lefrançais qui débute par une déclaration de la paternité proudhonienne de la Commune 20), renforce, par des témoignages et des analyses particulièrement précis et fondés, le fait proudhonien de la Commune affirmé avec tant de clarté par Lepelletier.
Après l’apaisement des passions répressives, le retour des Communards amnistiés et leur réinsertion
politique, la paternité proudhonienne de la Commune apparaît avec une telle évidence que le grand socialiste
et universitaire Hubert Bourgin n’hésitait pas à écrire en 1901, dans la petite édition populaire à 50 centimes de la fameuse librairie Georges Bellais, « le socialisme du parti socialiste français fut à l’origine purement Proudhonien, la Commune de Paris en tant qu’elle a été socialiste, a été Proudhonienne » 21, « le Manifeste du 19 avril est un Manifeste purement et complètement proudhonien, c’est exactement et en propres termes la doctrine du principe fédératif» et, tout en marquant combien le caractère incomplet et précipité des mesures de la Commune ne saurait traduire le Proudhonisme dans son étendue et dans sa cohérence, il ajoute ;« c’est certainement dans la voie des applications exactes du système de Proudhon qu’ils auraient entraîné et guidé le gouvernement de la Commune si la Commune avait vécu » 22.
Pour conclure ces prémisses sur la constatation du fait proudhonien de la Commune, il convient de citer la caution d’un grand contemporain récemment disparu : celle de Georges Gurvitch, grand spécialiste de la pensée proudhonienne, participant de la révolution russe, dont la probité scientifique et l’objectivité vis-à-vis des doctrines de Marx et de Proudhon (dont il reconnaissait la double obédience, et dont il espérait la synthèse) confère une toute particulière importance « au cours des deux années qui précèdent la Commune … Les Proudhoniens, après avoir découvert le caractère révolutionnaire du Proudhonisme, s’affirment alors comme les authentiques dirigeants du mouvement ouvrier… toutes les mesures administratives économiques et politiques prises par la Commune s’inspiraient de Proudhon, excepté, ajoute-t-il, le Comité de Salut Public dû à l’initiative du Blanquisme » 23.
Le fait proudhonien de la Commune est donc net. Il est incontestable, il est incontesté par les historiens sérieux, qu’ils soient marxistes ou non.
Sans doute, comme le regrette Gurvitch, Marx « qui n’a accepté la Commune de Paris qu’après qu’elle fut constituée » tait le fait proudhonien de la Commune. « Il a passé sous silence le fait que la majorité des Communards étaient Proudhoniens » 24 ; et Engels ne pouvant nier l’évidence s’efforce d’accréditer la thèse reprise par certains Marxistes d’aujourd’hui, de Communards Proudhoniens conduits par les nécessités de l’action à faire exactement le contraire de leurs convictions et de leurs expressions.
Ceci apparaît objectivement au vu des acrobaties interprétatives auxquelles sont conduits à se livrer des historiens fort respectables comme une adhésion aveuglante à une position passionnelle et personnelle de Marx – on pourrait dire presque psychanalytique (le refus du père) – à l’égard d’un « maître » qui « demeure
un instigateur » (Maximilien Rubel) 25, et dont la doctrine, les oeuvres et l’empreinte (jusque sur ses propres gendres Longuet et Lafargue) « n’a cessé de le hanter » et de provoquer « une influence constante faite d’attraction et de répulsion ». Ce qui a pu faire dire à un des Marxologues les plus éminents que « quoique Marx ait pu dire et penser … c’est en disciple et en continuateur de Proudhon qu’il a entrepris ce qui deviendra la tâche exclusive de son existence » 26.
Si bien que Marx comme Engels, vis-à-vis du fait proudhonien de la Commune, se sont trouvés – de la part de leurs positions et opposition passionnelles à l’égard d’un maître fascinant – devant une contradiction fondamentale.
Il leur a fallu à la fois nier Proudhon comme père idéologique de la Commune et en même temps adopter comme leur l’idéologie Proudhonienne de la Commune, quitte, par cette récupération stratégique, à renforcer au sein même du Marxisme la tendance proudhonienne anti-autoritaire et autogestionnaire que Proudhon, maître alors non contesté, avait nourrie à l’origine même de la pensée marxienne.
Influence de Proudhon à la veille de la Commune
« Qui ne se réclamait de Proudhon en 1870-1871 ? , écrivent Dautry et Scheler, historiens marxistes, constatant ainsi l’influence de la pensée proudhonienne à la veille de la Commune.
Pour avoir quelque idée de l’importance, de la nature et des divers degrés de cette influence, on ne saurait mieux faire que de transposer, non sans quelques précautions, cette constatation, en cette affirmation contemporaine : « qui ne se réclame de Marx en 1970-1971 ? »
Ce qui laisse entrevoir la diversité des imprégnations et des interprétations proudhoniennes, les degrés dans les adhésions totales ou partielles à la doctrine du grand socialiste ainsi que le problème de son acceptation exclusive ou éclectique (homogénéité ou hétérogénéité doctrinale).
De plus, par rapport au marxisme d’aujourd’hui, le proudhonisme pour être alors une idéologie dominante n’était point constitué en partis structurés, gardiens, combien parfois jaloux, d’une orthodoxie doctrinale. Proudhon, dès son vivant, s’y était violemment opposé. Appartenant idéologiquement au mouvement socialiste, « parti du travail » et « parti de la révolution », il ne voulait à aucun prix que sa pensée pût être invoquée pour entraver – au nom des efficacités à court terme, des consolidations à moyen terme et des déifications à long terme – le pluralisme et le dynamisme vital d’un mouvement socialiste en perpétuel devenir.
Aussi pour écarter une telle tentation, Proudhon, d’une façon sûrement excessive et due en partie aux circonstances de sa vie, évita-t-il toujours de systématiser sa pensée et de lui conférer ce pouvoir dogmatique si fascinant et si rassurant pour les esprits peureux, rigoristes ou simplement inquiets.
La masse de ses lecteurs, de ses amis et de ses disciples comprit, à des degrés divers, la leçon de ce non-systématisme.
Si bien qu’à la veille de la Commune l’imprégnation proudhonienne est particulièrement forte et étendue, mais les hommes qui la subissent ne tiennent pas forcément à s’estampiller « Proudhoniens », même lorsqu’ils se révèlent en fait comme d’authentiques disciples, et à plus forte raison quand ils admettent,conformément aux recommandations du grand Bisontin, à côté de l’aliment proudhonien, d’autres nourritures socialistes.
Ce processus complexe va donc aboutir à des degrés très divers d’imprégnation. L’ensemble des principes proudhoniens fera l’objet d’une connaissance diffuse dans toutes les sphères de l’opinion publique préoccupées de problèmes politiques, économiques et sociaux (éléments ouvriers comme éléments bourgeois). Une imprégnation plus générale mais plus sélective (rejet du collectivisme proudhonien) sera subie par des milieux républicains professant tous en commun des notions de démocratie non-autoritaire (fédéralisme politique) et de justice sociale. En troisième lieu, la doctrine Proudhonienne acquerra une influence beaucoup plus précise et beaucoup plus active sur des milieux socialistes (ouvriers et intellectuels) qui n’hésiteront pas à combiner le Proudhonisme avec d’autres apports doctrinaux (cas type d’un Malon ou d’un Tridon). Enfin, à un dernier stade, une influence directe, unique et militante, s’exercera sur des socialistes qui revendiqueront comme idéologie la pensée proudhonienne, sans pour cela la bâtir en système exclusif et fermé, mais en la prenant comme source de leur action et de leur réflexion.
Dans cette dernière zone d’influence se classent ceux que des historiens soviétiques qualifient de « Proudhoniens de droite » et « Proudhoniens de gauche ». En fait cette distinction est ambiguë. Si des Proudhoniens non Communards comme Tollin, Fribourg et Limousin professèrent un mutuellisme à la Lyonnaise que Proudhon n’a pas hésité à fustiger et à taxer d’utopiste 27 l’écart réel existant entre les mutuellistes révolutionnaires de la Commune (comme Avrial et Theisz qui sont pour un mutuellisme généralisé excluant tout vestige capitaliste comme toute étatisation de l’économie) et les collectivistes libéraux (comme Longuet, Clémence, Varlin ou Vermorel qui repoussent également tout collectivisme autoritaire), il n’existe tout au plus qu’un degré de rapidité dans l’établissement du régime et les processus de collectivisation.
Ces cadres précisés, il convient de les étoffer.
Quand Proudhon meurt, en 1865, il exerce sur l’opinion publique une influence très généralisée. Il voit sa moisson lever – et ceci, après des années de célébrité tapageuse et comme telle plus aveuglante qu’éclairante, après un rayonnement personnel intense, après une emprise populaire incontestable acquise notamment par la vulgarisation journalistique de sa pensée (influence considérable de ses journaux), après un labourage idéologique profond exercé par des ouvrages difficiles, complexes et souvent touffus réservés en fait aux militants d’une intelligentzia socialiste. Mais ce « labourage » s’étend à toute l’Europe « jusqu’aux extrémités de la Sibérie », comme l’écrit Raoul Labry dans son Herzen et Proudhon.
Cette moisson que moudra la Commune, deux livres, testaments essentiels, vont contribuer à son mûrissement. Le Principe fédératif (1863), dont le titre entier est à lui seul un programme ( « Du Principe fédératif ou de la nécessité de reconstituer le parti de la révolution ») et, De la capacité des classes ouvrières, dont il dicte les conclusions sur son lit de mort (1865).
Ces deux livres présentent sous une forme simple l’essentiel de sa pensée. Ils précisent très nettement sa doctrine et son articulation bipolaire (fédéralisme mutuellisme) et poussent le monde ouvrier à combattre pour l’érection de ce fédéralisme autogestionnaire, à la fois modèle et méthode d’un socialisme démocratique et d’un collectivisme libéral.
Ces deux livres eurent un retentissement immense. Le premier eut une telle fortune que les milieux politiques même les plus éloignés du socialisme en vinrent à voir dans un fédéralisme politique une panacée universelle tout en rejetant soigneusement « la fédération agricole-industrielle » de ce fédéralisme proudhonien qui impliquait la socialisation effective des unités fédérées. L’épisode d’un Méline relisant Proudhon et son Principe fédératif à la veille de s’enfuir à Versailles est, dans son baroque, fort significatif d’une imprégnation proudhonienne chez les éléments en fait les plus antithétiques à sa pensée socialiste.
Quant au second ouvrage, il devint aussitôt, comme l’écrit si justement Gurvitch, « le livre de chevet du prolétariat français et européen ».
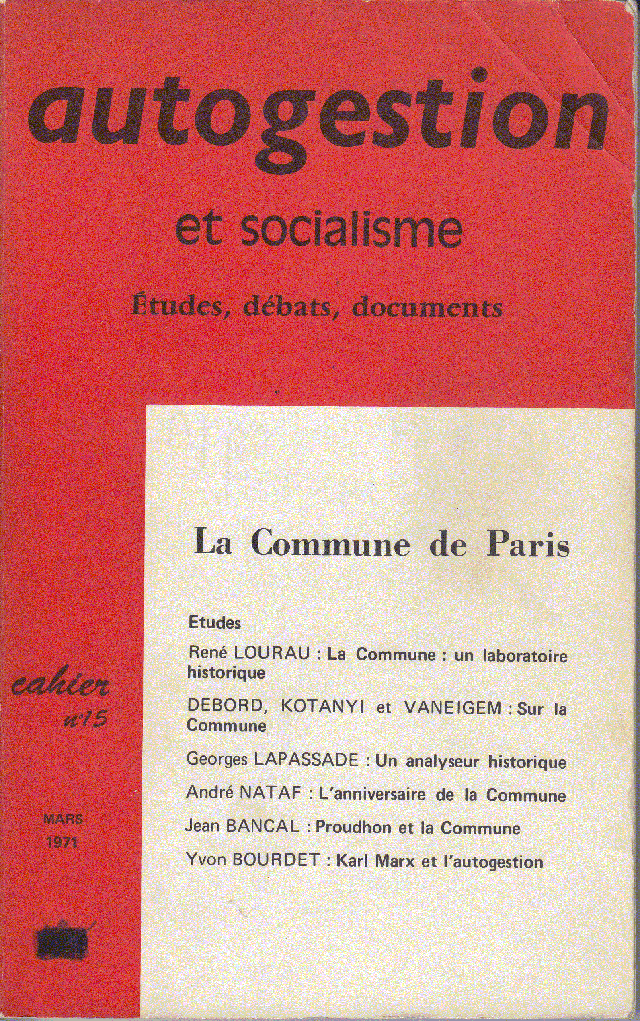
On sait l’importance accordée par les historiens de la Commune aux réunions publiques et aux clubs qui se sont multipliés lors des deux dernières années de l’Empire. En effet, ils donnent une bonne température de l’état de l’opinion et des influences idéologiques.
Or, que constate-t-on dans ces secteurs caractéristiques?
L’importance des sujets et des orateurs proudhoniens. Les Duchêne, les P. Denis, les Varlin, les Chemale, les Beslay, les Vallès, les Clémence, les Courbet, les Vermorel, les Longuet, les Lafargue, les Lefrançais, les Avrial, les Theisz, etc., exposent, développent, discutent et diffusent la pensée proudhonienne. On se contentera ici de citer deux épisodes pittoresques, particulièrement caractéristiques de cette fascination proudhonienne, l’un rapporté par Lefrançais, et l’autre par Jules Vallès.
« Il nous souvient, écrit Lefrançais, qu’un soir à la Redoute, présidant une réunion où la vie et les ouvrages de Proudhon devaient être examinés, nous dûmes résister aux injonctions d’un commissaire de police qui avait prétendu dissoudre la réunion parce que l’orateur énonçait qu’il allait examiner l’étude économique de Proudhon sur la nécessité de l’observation du Dimanche ». Ce commissaire pensait qu’il s’agissait d’une attaque à des convictions religieuses, ce qui était interdit par la loi 28
Aussi systématique est l’épisode de la préparation d’une réunion au faubourg Saint-Antoine que raconte Vallès dans L’Insurgé 29 : « Et que lui dirai-je, à ce faubourg Saint-Antoine… Je n’avais jamais eu assez d’argent pour acheter les œuvres de Proudhon. Il fallait qu’on me prête des volumes dépareillés que je lisais la nuit … Heureusement la Bibliothèque (Nationale) était là et j’ai… fourré mon nez et plongé mon cœur dans la source ».
En dehors des réunions publiques de style classique, l’influence de Proudhon s’exerçait dans les milieux étudiants du quartier latin et notamment dans les brasseries politiques comme la brasserie Serpente ou celle de la rue Saint-Séverin « chez Glaser » (Cf. Lepelletier, tome 2, p. 127). C’est là que Longuet, Vermorel, Vallès, Guyot, Lafargue, Fontaine et les groupe d’étudiants socialistes tenaient de véritables tribunes de propagande proudhonienne.
Longuet et Vermorel s’étaient faits publicistes et journalistes et leurs deux journaux respectifs, Rive Gauche et Le Courrier Français, devinrent des organes permanents d’un Proudhonisme actif.
Albert Thomas, dans le tome X 30 de l’Histoire socialiste dirigée par Jaurès insiste après Pelletier sur l’importance de ces journaux soulignée également par Albert Ollivier et M. Amoudruz 31.
Rive Gauche, né en novembre 1864, réunit des étudiants socialistes du quartier latin, dont Vaillant, l’ami intime de Longuet, et des internationalistes proudhoniens comme Fribourg. Sous son influence ce groupe d’étudiants adhère avec Longuet, dès sa formation, à la section parisienne de l’Internationale. Le Courrier Français groupe une équipe de Proudhoniens particulièrement brillante : Jules Vallès et Georges Duchêne assistent Vermorel. Il se caractérisa par la vigueur de son idéologie proudhonienne ; son influence fut très forte tant sur les milieux intellectuels que sur les dirigeants ouvriers et notamment ceux de l’Internationale. « Il fut lu et médité par tous les gens intelligents de la classe ouvrière de Paris » et Paul Lafargue, dont le Proudhonisme impénitent allait exaspérer son beau-père, Karl Marx, ne craignait pas d’écrire : « c’est le seul journal politique où un socialiste qui se respecte puisse écrire ». II faut aussi signaler l’action des « Écoles de France » qu’animaient Vermorel et son ami Tridon, et de La Marseillaise où Varlin et ses amis internationaux acquirent une influence considérable.
Parlant de toute cette presse proudhonienne et plus particulièrement des journalistes des deux premiers journaux, Albert Thomas conclut : « tous lisent, relisent, et commentent Proudhon ; Longuet, Lafargue, Vermorel, Pierre Denis … et une foule d’autres sont des Proudhoniens décidés. Socialisme mutuelliste, principe économique de la réciprocité et principe politique du fédéralisme sont les formules accoutumées. Au Courrier Français et à Rive Gauche collaborent les disciples directs du Maître … La déclaration par laquelle débuta le Courrier Français, le 20 mai 1866, est entièrement proudhonienne » 32.
Si actives dans les clubs et réunions publiques et si liées aux journaux socialistes proudhoniens, les Sections Parisiennes de l’Internationale furent le troisième centre privilégié de l’influence proudhonienne. Comme le reconnaissent si objectivement dans leur ouvrage collectif Bruhat, Dautry et Tersen, « l’Internationale Parisienne à la veille de la Commune est en majorité proudhonienne » ; elle comporte dans ses effectifs plus des deux tiers de Proudhoniens. Depuis le Congrès de Bâle de 1869 (qui n’a pas marqué, comme on l’a dit superficiellement, la défaite des Proudhoniens mais la victoire des Proudhoniens collectivistes et mutuellistes révolutionnaires sur les mutuellistes réformistes du style Tolain, Limousin et Fribourg), une équipe de Proudhoniens dits de gauche animée par Varlin et Malon avait pris la tête du mouvement parisien. Dans leur apparent éclectisme ils s’intitulaient collectivistes libéraux comme Varlin, Langevin, Clémence, etc., communistes non-autoritaires comme Lefrançais, Lafargue, Vaillant, etc., ou mutuellistes révolutionnaires (comme Theisz, Avrial, V. Clément, Pindy, etc.). En fait ils étaient d’accord sur l’essentiel et, en Province, à Rouen Aubry, mutuelliste révolutionnaire, Bastelica à Marseille (collectiviste libéral), et Richard à Lyon (qui s’avouait alors communiste non autoritaire) mais qui étaient tous fervents Proudhoniens, entretenaient une correspondance suivie avec Varlin et Malon et organisaient avec eux le grand réseau d’une fédération des Chambres ouvrières et des sociétés de résistance.
Malgré leurs différences apparentes d’étiquette -Proudhon, rappelons-le, avait violemment demandé de proscrire le label proudhonien 33 – leur programme économique était un : « remplacement du salariat par la fédération des producteurs libres (la fédération agricole industrielle de Proudhon), et leur plate-forme politique accouplait indissolublement transformation de l’État autoritaire en république fédérale et liquidation sociale.
Contrairement à l’idéal mutuelliste à la lyonnaise, vigoureusement dénoncé par Proudhon, et qui continuait à être préconisé par un Tolain, un Limousin ou un Fribourg, cette aile marchante du Proudhonisme
demande la révolution politique mais en la subordonnant à une transformation profonde de l’État et des institutions politiques.
Leur anti-dogmatisme les sépare complètement « du conservateur de la famille autoritaire » du type blanquiste (comme l’intitule Benoît Malon dans sa lettre à Richard du l 7 avril 1869 – ce dernier prétendant conserver au profit d’une dictature prolétarienne la structure centralisatrice de l’État bourgeois).
Ces positions des Proudhoniens internationaux étaient déjà très nettes l’année même de la mort de Proudhon. Et Charles Longuet, reconnu comme « le propagateur et le gardien des idées proudhoniennes » (Lepelletier, tome 2, p. 127), n’hésitait pas à écrire : « la révolution politique seule peut assurer au peuple le
triomphe de ses revendications » (Rive Gauche, 29 juillet 1865). « Mutuellistes et Proudhoniens» dits de gauche « se trouvaient unis sur la nécessité de liquidation sociale et les uns et les autres pensaient, écrit Albert Thomas, qu’elle devait commencer dès la révolution anti-impérialiste » 34.
Il rejettent donc « l’association » centralisatrice et étatique du communisme autoritaire pour « la coopération » mutuelliste et libérale, « la fédération libre des associations des producteurs ». C’est dans cette vue d’une révolution anti-autoritaire – et les trois procès faits aux sections parisiennes de l’Internationale et les emprisonnements de ses membres montrent que l’Empire ne s’y trompa pas – que Varlin et ses amis tissaient leur réseau de fédérations ouvrières.
Ainsi clubs, réunions publiques, journaux, action étudiante, action ouvrière, avec le noyau de l’Internationale, étaient-ils à la veille de la Commune autant de moyens de propagande et de diffusion qui contribuaient à donner à la pensée proudhonienne une influence incomparable.
Aussi Charles Andler, dans sa préface au tome X de !’Histoire Socialiste, pouvait-il écrire (p. 6),« le théoricien de l’action politique» à la veille de la Commune « fut Proudhon surtout ». « Ce penseur si peu indifférent aux formes politiques qu’il souhaitait un renouveau complet de la vie politique », allait donner à la Commune l’essentiel de son idéologie et de son programme. Cette « Commune de l’avenir » avec son fédéralisme et « ses conseils de corps de métier », annoncée au Congrès de Bâle par le proudhonien et futur communard Pindy, Proudhon, qui en était en quelque sorte le géniteur, en avait prédit l’avènement, la grandeur et les faiblesses.
« Il existe à Paris une élite d’hommes, ouvriers, étudiants, etc., qui me donnent parfois de grandes consolations. Ces hommes ne demandent qu’à marcher… Leur ferveur leur fait deviner toute la vérité … Il y a de formidables indignations dans l’air (lettre du 30 octobre 1864 à Buzon). Mais il avait pressenti en même temps ce qui en ferait la faiblesse : le parisianisme de la Commune, et son fatal mépris dans son messianisme révolutionnaire et dans son isolement, de l’importance stratégique de la province. N’écrivait-il pas : « que Paris fasse dans l’enceinte de ses murs des révolutions. A quoi bon? Si les départements maîtres d’eux-mêmes ne suivent pas, Paris en sera pour ses frais». Et il avait dénoncé aussi par avance ceux qui négligent l’alliance de « la Marianne des champs et de la Sociale des cités », et l’outrance « des faux révolutionnaires» qui, identifiant socialisme et dictature, suscitent la réaction qui les domine et les emporte.
Les proudhoniens de la Commune
La Commune va naître dans les circonstances les plus défavorables qui soient. Dans une nation vaincue et occupée, un Paris isolé, marqué par l’ambiguïté d’un socialisme trop exclusivement ouvriériste et d’un fédéralisme plus exemplaire que propagandiste, un Paris rempli par les redondances et les rodomontades d’un jacobinisme nourri de réminiscences historiques et d’un romantisme verbeux – va s’opposer avec plus de courage que d’efficacité à un provincialisme, composite mais massif, de royalistes réactionnaires, de républicains conservateurs et de masses rurales dont le radicalisme ne dépasse pas l’aspiration au développement et à la consolidation de la petite propriété paysanne. Malgré ce handicap énorme, ces manques évidents de force militaire, de propagande active, de programme provincial et paysan de cohésion doctrinale (l’opposition Proudhoniens et Blanquistes-Jacobins) en 72 jours héroïques les Parisiens vont ébaucher le modèle précité et anticipé des futures révolutions prolétariennes.
De ce modèle les Proudhoniens Communards furent par leur action, leurs écrits, leurs apports doctrinaux, par les institutions politiques et économiques qu’ils contribuèrent à faire naître, les ouvriers essentiels.
Les proudhoniens dans les comités centraux
Dans les deux Comités centraux, celui des vingt arrondissements et celui de la fédération de la garde, comme dans la Commune, les Proudhoniens occupèrent une place primordiale. Malgré l’abondance des éléments divers fournis par de nombreux documents et écrits, on n’a pour ainsi dire jamais donné une typologie suffisamment précise pour en faire ressortir toute l’importance.
Le « Comité central républicain des Vingt Arrondissements », ébauché dès le 5 septembre 1870 et dans lequel Lefrançais voyait à juste titre « une constitution non officielle de la Commune », est dominé par les Proudhoniens Pindy, Varlin, Lefrançais, Theisz, avec Pierre Denis, Langevin, Jules Vallès, Chemale, Beslay, etc. (Tous ces chefs du Comité central seront élus membres de la Commune, à l’exception de Pierre Denis et de Chemale.)
Aussi n’est-il pas étonnant que, comme nous le verrons, les manifestes de ce Comité (en particulier ceux du 22 septembre 1870, du 9 octobre 1870 et du 27 mars 1871) portent une estampille proudhonienne indiscutable. De même lors de sa formation (création le 20 février, réunion le 13 mars 187l) « le Comité central de la Garde Républicaine», doté d’une structure typiquement proudhonienne à base de délégations électives et de fédérations successives, est dès l’abord dominé par des Proudhoniens.
Jourde, Avrial, Longuet, Varlin, Vaillant marquent sa direction de leur forte personnalité. Cependant, après la constitution de la Commune où sera élue cette première équipe directrice du Comité, l’élément blanquiste et romantique révolutionnaire gagnera en importance et fera de ce dernier un élément perturbateur
qui pèsera sur toute l’organisation militaire et sur l’échec final de la Commune. A cette date, avec de tels chefs, « les Proudhoniens dominent le Comité central », constatent les historiens marxistes Bruhat, Dautry et Tersen. Et si ceux ceux-ci leur reprochent de n’avoir pas marché sur Versailles dès le lendemain du 18 mars (ce qui était pratiquement impossible vu le manque de préparation des troupes fédérées), ils leur rendent un particulier hommage devant leur vigueur à ne pas céder aux tentatives de la réaction intérieure. « C’était compter, écrivent-ils, sans le Comité Central, sans le réalisme révolutionnaire de la majorité de ses membres» 35.
Le Comité Central de la Garde, grossi de l’apport du Comité central des Vingt Arrondissements, sera l’acteur principal du 18 mars révolutionnaire. Dans le gouvernement provisoire du 18 mars les Proudhoniens occupent des postes essentiels. Varlin et Jourde, promus délégués aux finances par le Comité Central triomphant consolident, par leur action financière, la victoire obtenue en permettant le paiement rapide de la solde des gardes nationaux et en faisant face aux nécessités pratiques et aux impératifs économiques. Dans des conditions exceptionnelles Jourde s’attaque au problème des échéances et réorganise la comptabilité de la ville.
Vaillant est pour sa part chargé de l’intérieur, tandis que Longuet prend en main l’officiel et que Vallès est nommé délégué à l’instruction. Cependant les Blanquistes Duval et Rigaud prenaient en main la Guerre et la Police. A partir du 21 mars, le Comité central des Vingt Arrondissements et le Comité central de la Garde Nationale établissent leur liaison. Et Lefrançais, Theisz, Charles Beslay, P. Denis, Vaillant, entre autres Proudhoniens, sont nommés délégués permanents du Comité central des Vingt Arrondissements auprès du Comité central de la Garde Nationale. Les Proudhoniens des deux comités révolutionnaires établissaient ainsi officiellement leur fusion.
Les proudhoniens dans l’Assemblée de la Commune
Il n’est pas un auteur qui n’ait traité de la Commune et des Communards sans donner un tableau des répartitions de « partis » ou « tendances » de l ‘Assemblée de la Commune.
Or, quasiment, sans exception, non seulement l’exacte répartition entre majorité et minorité est faussée par la non-mention de groupes de neutres ou de fluctuents, mais surtout le fait de ne placer les Internationaux que dans la minorité et d’ignorer l’existence de Proudhoniens dans la majorité conduit à ne pas comprendre en profondeur la réelle unité et les véritables diversions de la Commune.
On connaît les diverses répartitions qui sont habituellement données des factions ou tendances de Communards.
Le schéma le plus court et le plus grossier est sûrement celui esquissé par Engels dans son introduction à la Commune de Paris (La guerre civile en France de Karl Marx). Selon lui, « les membres de la Commune se partageaient en une majorité de Blanquistes qui avaient déjà dominé le Comité central » ce qui est complètement inexact 36, « et une minorité de Proudhoniens, membres de l’Association Internationale des Travailleurs » (p. 16, Paris, 1901, trad. Longuet).
Ce schéma simpliste pouvait se traduire en l’équation suivante : Majorité = Blanquistes ; Minorité = Internationaux = Proudhoniens.
Charles Longuet, Communard de la minorité, Proudhonien et gendre de Marx a, dans les notes qu’il a crites dans la traduction française de l’introduction de Engels et du livre de Marx, n’a eu aucun mal à démontrer les erreurs et l’ignorance manifestées par une telle simplification (pp. 115-120, livre cité).
Da Costa, journaliste Blanquiste de la Commune donne dans son livre une répartition moins grossière et plus nuancée (38) et Henri Lefebvre l’a adoptée dans son remarquable ouvrage. Elle reste cependant très insatisfaisante.
Il distingue quatre tendances : les révolutionnaires Blanquistes au nombre de neuf 37 ; des révolutionnaires divers, « les uns proches de Blanqui, les autres Jacobins avancés, certains partisans du socialisme révolutionnaire romantique ». Ce qui donne en fait un amalgame assez remarquable de majoritaires et de minoritaires de la Commune, de toute une gamme de Jacobins plus ou moins avancés et de Proudhoniens non-internationaux (comme Vermorel, Vallès ou Arthur Arnould ou Cambon); des radicaux, comprenant des Versaillais comme Méline qui trahiront la Commune, ou des fidèles comme Rastoul ; enfin des républicains modérés qui comportent un groupe homogène de républicains conservateurs qui quitteront et trahiront la Commune.
Cette répartition qui oublie le clivage majorité-minorité et mêle dans deux groupes (républicains divers et Internationaux) des éléments hétérogènes, voire opposés, reste, comme on le constate, très défectueuse.
Lefrançais (ouvrage cité, p. 189) divise la Commune en trois blocs :
Le Parti Républicain conservateur, qui comprend tous les élus qui quitteront la Commune pour Versailles ; le Parti révolutionnaire dictatorial, parti de la majorité, appelé encore par Lefrançais « le parti révolutionnaire pur » composé, selon lui, de Jacobins et de Blanquistes. (Les uns « partisans de la dictature du groupe », les seconds de la « dictature d’un seul ».) Enfin, le groupe socialiste, qu’il identifie complètement avec la minorité qui votera contre le Comité de Salut public et pour la déclaration de la minorité 38.
Cette répartition tout en complétant et clarifiant les précédentes reste trop schématique et comporte des inexactitudes partisanes. La globalisation de la minorité avec le groupe socialiste ignore la présence dans la majorité d’internationaux collectivistes et de personnalités appartenant indiscutablement au Mouvement
socialiste (et notamment de Proudhoniens). D’autre part, elle comporte des indications particulières, nettement inexactes (Vaillant y est qualifié de Blanquiste).
Les mentions que l’on peut trouver dans Lissagaray (chapitre XI, Ed. Maspero, p. 17 l) restent sommaires et assez décousues. Celles contenues dans l’ouvrage d’Ollivier (p. 250) demeurent également très indicatives.
Aussi, compte tenu des précieuses remarques tirées des bibliographies individuelles de Communards, toutes ces répartitions doivent-elles être redressées en s’aidant notamment de trois sources :
- les remarquables listes de notes bibliographiques des livres de Bruhat, Dautry et Tersen (qui comportent cependant un certain nombre d’inexactitudes et d’oublis) ;
- les notes très précises de Longuet (en annexe au livre de Marx)
- et les précisions nuancées d’Arthur Arnould (livre cité, tome II, p. 85).
Ce dernier donne une répartition qui contraste avec la globalisation quelque peu partisane de Lefrançais (dont le livre par ailleurs, remarquable, a été particulièrement apprécié de Lénine).
Il évite le manichéisme, « socialiste démocrate » minoritaire et « révolutionnaire dictatorial » majoritaire. « La majorité », précise-t-il, (appelée par lui « révolutionnaire-Jacobins ») « sauf quelques individualités, n’était pas plus antisocialiste que la minorité n’était antirévolutionnaire. Elle (la minorité) ne répugnait à aucune mesure radicale pourvu que cette mesure lui parût de nature à produire le bien qu’on en espérait et ne fût pas la négation même du principe qui nous avait fait prendre les armes à la main » (la liberté).
Et il ajoute en incidence une mention d’importance capitale lorsque l’on veut comprendre comment l’Assemblée de la Commune a pu adhérer à un programme commun.
Parmi le gouvernement révolutionnaire Jacobin on comptait un certain nombre de membres de l’Internationale, d’hommes connus surtout pour la part prise au mouvement socialiste, de même que l’on comptait dans la minorité un blanquiste, Tridon (à vrai dire imprégné de Proudhonisme).
L’identité mythique bloc des Internationaux = minorité, qui est si souvent mise en avant, est démentie par cette affirmation. Ne résiste pas également l’image d’une majorité essentiellement bourgeoise par ses origines et d’une minorité strictement prolétarienne.
Quant aux notes de Longuet, elles démontrent à l’évidence ce qui fut une des faiblesses de la Commune : l’éclectisme et l’hétérogénéité de la majorité. « La majorité, écrit-il, comprenait des éléments très divers » : quelques « Blanquistes », « des Jacobins purs ou teintés de socialisme », « des Internationaux collectivistes », « des écrivains révolutionnaires d’esprit socialiste », quelques « vieux socialistes révolutionnaires » d’ancien style, des Proudhoniens comme « Vaillant », un fort groupe d’hommes politiques nouveaux « étrangers aux théories économiques», enfin quelques « personnalités bizarres et peu équilibrées » (comme Regère). Longuet oppose à cette distorsion de la majorité « la cohésion de la minorité » qui est intégralement socialiste et en grande partie proudhonienne. Il n’a cependant aucune peine à montrer que cette unité réelle reste une unité pluraliste ; en effet, cette minorité comporte dans sa majorité proudhonienne trois nuances (« mutuellisme modéré », « collectivisme très accentué » et « communisme libertaire ») et elle comprend deux fortes personnalités marxistes (Franckel et Serrailler), les seules de la Commune.
Pourquoi la majorité manifesta-t-elle pareille impuissance pratique? Pourquoi cependant un programme et des réalisations politiques (fédéralisme) économiques (mutuellisme autogestionnaire) présentés et promulgués par la minorité emportèrent-ils l’adhésion de l’ensemble de la Commune ?
La réponse à ces deux questions se trouve dans l’hétérogénéité de la majorité. En dehors de la question relevant du mythe de la dictature (Comité de Salut public) qui la ressoudait artificiellement et contradictoirement (ambiguïté de la dictature collective des Jacobins-socialistes autoritaires et de la dictature personnelle des Blanquistes), cette majorité perdait toute consistance idéologique.
Sur le plan d’un programme économique et politique les socialistes proudhoniens ou proudhonisants de la majorité et les autres Internationaux collectivistes se retrouvaient alors d’accord avec les Internationaux Proudhoniens et Marxistes (Franckel, Serrailler ) et les Proudhoniens non-internationaux de la minorité.
Une majorité idéologique se formait ainsi, se substituant à la majorité tactique (Comité de Salut Public).
La majorité tactique était donc unie par ce qui a divisé la Commune (la dictature du Comité de Salut
Public).
Par contre, la majorité idéologique était forte par ce qui unissait la minorité tactique et divisait la majorité tactique : l’existence, par-delà des frontières dictature-non dictature, d’un mouvement socialiste où Proudhoniens Internationaux, Proudhoniens non-internationaux et Proudhonisants jouent un rôle essentiel.
Si l’on effectue un recensement précis, indispensable mais jusqu’ici omis des Internationaux de la majorité et des Internationaux de la minorité d’une part, et des Proudhoniens ou Proudhonisants de cette majorité et de cette minorité, l’importance du groupe proudhonien et d’une majorité idéologique différant d’une majorité tactique se trouve singulièrement étayée.
La majorité comporte treize Internationaux certains : Assi, Dereure, Johannard, J. Durand, Martelet,
Champy, Trainquet, Babick, Vaillant, V. Dernay, Challin , E. Pottier, Miot 39
La minorité comprend quatorze Internationaux certains: Varlin, Malon, Theisz, Avrial, Pindy, Beslay, Lefrançais, Clémence et Gérardin, Langevin, Andrieux, Longuet, Franckel et Serrailler (le cas de Victor Clément restant incertain). On voit, par ce simple recensement statistique jamais donné, la fausseté du mythe historique d’une Internationale minoritaire de la Commune. En fait elle se partage à peu près également entre minorité et majorité tactique.
Comment un tel mythe a-t-il pu naître?
On peut en découvrir plusieurs raisons. Une raison de fait tout d’abord. Les personnalités internationalistes de la minorité étaient, dans leur ensemble, incontestablement plus fortes que celles plus ternes (à l’exception de Vaillant) de la majorité. Et cette différence était renforcée par la différence de leur importance relative dans les deux groupes. D’où naturellement un éclairage grossissant sur les Internationaux de la minorité.
Une raison politique s’ajoute sans doute à cette raison de fait. Marx et surtout Engels, à la fois pour masquer la division tactique de l’Internationale et l’union pratique constituée par l’idéologie proudhonienne ont mis l’accent sur l’Internationale, bloc unique, minorité éclairée et mère de l’idéologie communarde. Les Internationaux eux-mêmes, séparés par le vieux mythe qu’un des leurs, Miot (« Une vieille barbe », écrit Lissagaray) avait ressuscité (le Comité de Salut Public), restèrent d’autant plus discrets sur cette division tactique qui les culpabilisait qu’ils s’étaient retrouvés ensemble pour voter le programme politique et économique et les mesures préparées par le groupe minoritaire.
Or, cet élément minoritaire était proudhonien dans sa plus grande partie. Et c’est là que le Groupe Proudhonien des Communards prend une toute particulière importance. Cette importance est singulièrement renforcée par l’existence toujours omise de fortes personnalités proudhoniennes ou proudhonisantes au sein même de la majorité.
Un recensement précis du groupe proudhonien jusqu’ici différé s’impose et étaye cette constatation. Dans la minorité (définie par le vote de la déclaration de la minorité du 16 mai) on compte, sur ses vingt-trois membres, dix-huit membres se référant à l’idéologie proudhonienne (quinze Proudhoniens, trois Proudhonisants (éclectiques) trois sympathisants aux thèmes proudhoniens, et deux marxistes (Franckel et Serrailler).
Ce groupe de dix-huit Proudhoniens et Proudhonisants comporte une majorité de quinze Proudhoniens de gauche et une minorité mutuelliste (Beslay, Jourde, V. Clément) qui ne vont pas jusqu’à une collectivisation intégrale.
Ce qui donne nommément la répartition suivante : Proudhoniens collectivistes Varlin, Malon, Theisz,
Avrial, Lefrançais, Clémence, Langevin, Longuet, Pindy (tous membres de l’Internationale) Vallès, Vermorel,
Courbet ; Proudhoniens mutuellistes, Beslay, Jourde, Victor Clément ; Proudhonisants collectivistes, Arthur, Arnould, Andrieu, Tridon, auxquels il convient d’ajouter trois sympathisants probables, Ostyn, E. Gérardin, Arnold .
Dans ce grope proudhonien de la minorité, les personnalités de premier plan abondent. Varlin, le relieur, « l’honneur du prolétariat », figure d’exception, fondateur du syndicalisme ouvrier, organisateur de premier plan et animateur de la section française de l’Internationale est un Proudhonien convaincu. Considéré
comme l’un des promoteurs du programme économique de la Commune, dans ses actes comme dans ses écrits, il s’affirme comme un authentique disciple du grand socialiste français. Il est maintenant unanimement
reconnu comme tel par les historiens marxistes français (cf. notice bibliographique dans ouvrage de Bruhat, Dautry , Tersen : « il subit l’influence de Proudhon ») et ceci malgré quelques regrets et réserves, et par les historiens soviétiques de la Commune (cf. Lefebvre, p. 116) qui le classent parmi les Proudhoniens de gauche.
On a cependant beaucoup discuté autrefois sur la position de Varlin à l’égard des différentes tendances de la Première Internationale 40. La cause est maintenant complètement entendue. En dehors même de son action une étude des écrits de Varlin à la veille de la Commune en apporte une preuve 41. Ainsi Guy Grant a-t-il pu écrire : « Les membres de la Commune, dans la mesure où ils étaient socialistes, étaient des amis ou des disciples de Proudhon, notamment le plus pur d’entre eux, l’héroïque Varlin (La pensée de Proudhon, Bordas, p. 206). Comme son ami Malon, il garde cependant dans son Proudhonisme cet esprit d’ouverture et cet anti-dogmatisme demandés par Proudhon lui-même. Et si « les idées de Proudhon » restent sa charpente idéologique il n’exclut pas un certain radicalisme issu de Blanqui et de Bakounine mais, comme le souligne Gurvitch (ouvrage cité, p. 135), « il reste loin du Marxisme ». C’est son expérience pratique qui l’a conduit au Proudhonisme où il reconnaissait ses propres réflexions. Comme l’a fait remarquer dans son livre très documenté son biographe Maurice Foulon (Eugène Varlin, relieur, membre de l’Internationale, Ed. Montlouis, Clermont-Ferrand) « ses propres constatations l’amenaient pratiquement à travailler dans le sens des théories de Proudhon » et cela « avant même qu’il eût vraiment connu les ouvrages de Proudhon » par une lecture complète (ouvrage cité, p. 135). Par la suite, au contact de ses camarades du bureau parisien « qui depuis 1858 rencontraient fréquemment Proudhon chez Beslay », il lut et relut très attentivement Proudhon avec le sens pratique et le sérieux qui le caractérisaient. Il met l’accent alors « sur le caractère révolutionnaire du Proudhonisme » (Gurvitch, p. 138) trop ignoré des mutuellistes proudhoniens.
Gardant « comme Proudhon à l’égard de l’État autoritaire … une invincible répulsion » (Foulon, p. 132) qui J’éloigne de beaucoup de Marxistes (Franckel et Serrailler seront justement des marxistes non-autoritaires). il refuse que « le parti socialiste se laisse séduire par la théorie abstraite de la science sociologique » d’un État prolétarien autoritaire et centralisateur, et préconise « la libre disposition par les travailleurs eux-mêmes de leurs instruments de travail » grâce à la fédération des producteurs libres (cf. lettre à Aubry citée par Foulon. p. 132 et article de La Marseillaise du l l mars 1870). Pour lui « le salariat doit être remplacé par la fédération des producteurs libres », ce qui reprend les thèmes et les paroles mêmes du programme révolutionnaire de Proudhon (Mélanges I, Manifeste électoral du Peuple) et du Principe fédératif.
Autre grande figure de l’Internationale « parisienne », Malon (conformément à la recommandation même de Proudhon qui se refusait à construire un système mais s’en tenait à une méthode de pensée et d’action et quelques éléments de base tout en proclamant qu’il revenait « à tous de faire le reste») 42 est un homme qui « tient le plus grand nombre de toutes les forces diverses engagées dans la lutte » (cf. Albert Thomas, tome X, p. 370). Grand ami de Varlin (Proudhonien pour l’essentiel), il hait tout exclusivisme. « Aventurier de la pensée » (c’est l’expression même de Proudhon qui se disait « aventurier de la science et de la pensée »), « je fréquente, écrit-il, tous les partis démocrates radicaux, Proudhoniens positivistes, Proudhoniens collectivistes (conservateurs de la famille autoritaire ») 43. (Lettre à Richard du 17 avril 1869). Aussi, « considéré alors comme un Proudhonien de gauche» 44, pense-t-il que les Proudhoniens doivent « marcher de concert » avec les autres socialistes. Ainsi, écrit-il à son ami Richard, « nous pourrons faire beaucoup ».
Theisz et Avrial, artisans essentiels des mesures économiques de la Commune, étaient connus comme « des Proudhoniens » et « dans toutes les forces du terme des révolutionnaires et des hommes d’action » (Longuet). Marx, qui estimait particulièrement le premier constate, lors de son accueil à Londres, après la chute de la Commune, que « Theisz comme la plupart des socialistes qui pensent est arrivé Proudhonien » 45. Quant à Avrial, Internationaliste comme son ami le ciseleur Theisz, il fut le fondateur « du cercle d’études sociales » où l’on étudiait Proudhon et sa doctrine. Cet ouvrier mécanicien, homme de cœur et de caractère, se privait du strict nécessaire pour acheter des livres de Proudhon qu’il méditait longuement pour en inspirer son action 46.
Lefrançais, également international, était « un instituteur formé à l’anarchisme proudhonien » comme le constate André Decoufle 47.
Orateur écouté, il défend dans les clubs et réunions publiques d’avant la Commune et, dans ses ouvrages qu’il lui consacrera après sa chute 48, un communisme libertaire et une doctrine communaliste inspirée directement par le grand socialiste qu’il a lu, relu, cité, médité et commenté sans cesse.
Son principal livre, Étude sur le mouvement communaliste de 1871, est publié sous le patronage de Proudhon. De tous les publicistes modernes qui ont écrit sur ce sujet il n’en est pas qui l’ait mieux traité que Proudhon. Nul plus que Proudhon dans son ouvrage, « Le Principe fédératif » (Du Principe fédératif ou de la nécessité de reconstituer le parti de la révolution, 1863) n’a démontré plus clairement que l’action gouvernementale centralisatrice était la négation du droit politique, de toute justice et de toute économie 49.
Clémence, internationaliste et relieur comme Varlin reçut comme lui « l’influence de Proudhon » (Bruhat, Dautry et Tersen) et conçut le Proudhonisme en sa plénitude, c’est-à-dire comme un collectivisme libéral.
Langevin, internationaliste et tourneur en métaux, adopte « des positions politiques qui sont celles de la minorité proudhonienne » (Bruhat, Dautry et Tersen).
Charles Longuet est reconnu comme un Proudhonien actif et influent. Grand propagandiste dans Rive Gauche des idées proudhoniennes, animateur comme son ami Lafargue, autre gendre de Marx, du groupe étudiant des socialistes proudhoniens, il est non seulement étiqueté Proudhonien par les historiens marxistes (« de tendance proudhonienne » indiquent Bruhat, Dautry et Tersen dans leur notice bibliographique) ; mais il est considéré par les Communards comme un des principaux chefs de file du groupe proudhonien de la Commune. Lepelletier précise ; « c’était un disciple de Proudhon… la netteté de sa vision et sa clairvoyance intellectuelle en firent le propagateur et le gardien des idées proudhoniennes au sein de la Commune » (tome II, pp. 126-127). Et Hubert Bourgin n’hésite pas à écrire de son côté (livre cité, p. 81) : « Charles Longuet tenait de Proudhon toutes ses connaissances économiques » et son programme politique.
Vermorel, l’animateur du Courrier Français, qui était comme on l’a vu la tribune proudhonienne par excellence fut également avant la Commune un des plus intelligents propagandistes du Proudhonisme. Dans ses livres, Les Hommes de 1848 ( 1868), Les hommes de 1851 (1869), et surtout dans Le Parti Socialiste (1870), jugés comme « des ouvrages de grande portée » 50, il met sur pied un véritable programme proudhonien. Y théorisant les idées du grand socialiste il le cite et le commente sans cesse. Comme l’écrit Jean Vermorel 51 « les idées de Proudhon avait exercé sur l’esprit de Vermorel et de ses collaborateurs plus qu’une influence, mais une véritable fascination ». « Nourri de la lecture de Proudhon 52, et décidé à en réaliser le programme, cet homme, de la même trempe qu’un Varlin, après avoir été calomnié par les républicains non-socialistes a été finalement salué par tous les Communards » comme « ayant mérité de figurer dans la courte nomenclature des vrais amis du peuple » 53. L’écrivain populaire de grand talent, l’homme dont la verve rappelle indiscutablement celle de Proudhon, le publiciste et l’orateur entraînant les foules, Jules Vallès, avait adhéré avec enthousiasme, comme toute la jeunesse « qui pensait », aux idées du grand socialiste. Animant, avec Vermorel, le Courrier Français qui avait « relevé le drapeau socialiste, affirmant les grands principes dont Proudhon avait été le dernier confesseur » (Vermorel, Courrier Français, 18 juin 1868) il vulgarise également dans son Cri du Peuple les principes proudhoniens. Y présentant les candidatures des Internationaux lors des élections à l’Assemblée Nationale, il écrit : « on demande des députés, il faut leur envoyer huit mâles … huit socialistes … donner la parole aux neveux de Babeuf et de Proudhon » 54.
Pour lui, « qui n’avait jamais eu assez d’argent pour acheter les œuvres de Proudhon » et qui le lisait la nuit dans des livres dépareillés qu’on lui prêtait ou à la Bibliothèque Nationale, Proudhon était « la source » même du socialisme : « J’ai fourré mon nez et plongé mon cœur dans la source ». Il s’en imprégnait pour ses articles et il écrit pittoresquement : « lorsque j’avais avalé une gorgée de Proudhon, il en roulait des gouttes toutes rouges sur mon papier » 55.
Courbet, lui, était devenu Proudhonien par amitié. Proudhon était son compatriote, son ami. Il a peint de lui l’admirable tableau de l’Orangerie et Proudhon avait pris la défense du grand peintre et de son esthétique dans son Principe de l’Art et de la Destination Sociale, une des sources trop ignorée de la doctrine socialiste du grand réalisme dans l’art. Par conviction il avait ensuite défendu la doctrine proudhonienne dans tous les cercles artistiques et littéraires et lors des élections à la Commune il se recommandait de Proudhon dans sa profession de foi aux électeurs. « Je me suis toujours préoccupé de la question sociale et des philosophes qui s’y rattachent, marchant dans cette voie parallèlement à mon camarade Proudhon 56.
Beslay était aussi l’ami intime de Proudhon. Homme âgé, il avait connu et traversé comme homme politique plusieurs régimes. Sur le tard de sa vie il se convertit au socialisme, non sans conserver un certain nombre d’idées arrêtées et quelquefois rétrogrades dont il n’arriva pas à se défaire. Il raconte dans ses Souvenirs (1893, pp. 203-209) sa rencontre relativement tardive avec Proudhon. « Je ne connaissais pas, je n’avais jamais connu Proudhon avant son arrivée à l’Assemblée constituante et je suis devenu l’un de ses amis intimes». Cette confidence est suivie de l’épisode caractéristique concernant ses divergences avec Proudhon sur la banque du peuple (« Mes critiques … frappèrent Proudhon qui les regarda comme des préjugés inspirés par la routine »). S’il adhéra entièrement à son fédéralisme politique, il le considérait assez étroitement sur le plan économique, comme « un grand vulgarisateur des idées économiques» (p. 213). Il ne semble pas qu’il ait saisi, comme un Avrial, un Theisz, un Malon, un Varlin, un Longuet, un Vermorel, toute la vigueur de son collectivisme libéral.
Pindy, comme son ami Victor Clément, tous deux Internationalistes, sont tous deux avec Varlin, Theisz, Avrial, Malon, etc, organisateurs du vaste réseau de la fédération des associations ouvrières et des sociétés de résistance. Pindy avec Clément est classé pour sa position au Congrès de Bâle (1869) comme « un Proudhonien non collectiviste » (H. Bourgin). En fait s’il répugnait de se ranger sous l’étiquette collectiviste à cause de sa haine pour un socialisme autoritaire et étatique, il demande comme base du programme économico-politique de l’Internationale « la Commune de l’avenir » et « les conseils de corps des métiers » constitués en gouvernement démocratique.
Jourde, ami de Varlin, professe, à la veille de la Commune, un Proudhonisme un peu étroit (cf. Charles Longuet). Comptable, c’est le comptabilisme proudhonien qui le séduit dès l’abord. Absorbé par ses tâches d’administration de la Commune, il suivra cependant ses amis dans leur programme économique avancé. Avec « sa lucidité calme de bon comptable » (Lissagaray) il s’appuiera sur Varlin et Bastelica, l’internationaliste proudhonien Marseillais (qu’il chargera du service des Contributions Directes) pour mener à bien ses réformes financières.
A ces quinze Proudhoniens de la minorité dont nous avons tracé brièvement le portrait doctrinal, il
convient de joindre trois Proudhonisants. En premier lieu, Arthur Arnould, principal porte-parole de la minorité, esprit lucide et impartial exposera, dans son livre Petite Histoire Populaire et Démocratique de la Commune, un programme étroitement proudhonien. (Cf. tome III, en part. pp. 95-154.) C’est son grand ami et correspondant Jules Vallès qui l’imprégna de Proudhon. Il en parle avec effusion : « un ami personnel, un ami de vingt ans … dont j’ai toujours admiré le grand talent, l’esprit organisé et vigoureux. Je le vis avec joie révéler (à la Commune) un véritable sens politique, je veux parler de Jules Vallès. En dehors de lui il faut ajouter Malon, Pindy, Varlin, Avrial ». Au contact de tels amis, ce Proudhonisant deviendra complètement Proudhonien.pendant et après la Commune.
A ce petit groupe il convient d’ajouter Andrieu, dont les votes et les déclarations relèvent de la tendance proudhonienne et Tridon, l’ami intime de Vaillant, l’ami et collaborateur de Longuet (aux « Écoles de France ») et de Vermorel. Tridon est pourtant catalogué Blanquiste de la minorité. Cependant, comme le souligne Dommanget (Hommes et choses de la Commune) 57: « Après avoir débuté dans la vie publique comme Orléaniste, il se réclama ensuite de Proudhon ». Ce n’est qu’après qu’il fit la connaissance de Blanqui à la prison de Sainte-Pélagie et qu’il subit « cette influence magnétique » que le vieux révolutionnaire exerçait sur les jeunes romantiques. Devenu avant la Commune l’un des chefs du Blanquisme, la position puérilement extrémiste et le vide doctrinal de ses amis lui apparurent lors de la Commune. C’est alors que, fidèle au programme socialiste qui l’avait séduit d’abord dans le Proudhonisme, il rejoint dans ses votes et dans ses actions ses amis Proudhoniens de la minorité.
Quant à Ostyn, Arnold et E. Gérardin, ils peuvent être considérés par leurs votes et actions à la Commune comme des sympathisants au socialisme du grand Bisontin.
Comme on peut s’en rendre compte les Proudhoniens de la minorité apparaissent comme un groupe
composé de personnalités assez exceptionnelles. Les hommes de révolution, d’action et d’organisation abondent, les Varlin, les Avrial, les Theisz, les Vermorel. Les bons gestionnaires existent, comme les Jourde et les Beslay. Les théoriciens économiques (Vermorel, Varlin et Avrial avec Malon) et politiques (Longuet, Vermorel, Lefrançais avec Vallès), ont médité et précisé un programme économique et politique, celui que va adopter la Commune. Ils vont être aidés dans cette tâche par les Proudhoniens et les Proudhonisants de la majorité dont l’existence a toujours été oubliée.
Dans les très grandes figures de la majorité, on trouve en fait deux grands Proudhoniens, Vaillant et
Cambon, et un Proudhonisant au premier abord imprévu (car ses premiers démêlés avec Proudhon ont été célèbres) Delescluze.
Vaillant est généralement classé, tout à fait à tort, parmi les Blanquistes.
Lefrançais, qui n’aimait pas son goût pour un pouvoir fort mais non-dictatorial le classe, avec une certaine mauvaise foi, « parmi les plus ardents et les plus intelligents de la fraction blanquiste » des « révolutionnaires dictatoriaux ». Et Engels reprend cette assertion et en fait un Blanquiste influencé par le marxisme. Dans son Introduction à La Commune de Paris, il écrit : « les Blanquistes n’étaient alors socialistes… que par instinct révolutionnaire et prolétarien. Un petit nombre d’entre eux était parvenu grâce à Vaillant qui connaissait le socialisme scientifique allemand à plus de précision scientifique» 58. Les historiens marxistes, Bruhat, Dautry et Tersen reprennent l’étiquette et l’indiquent dans leur notice bibliographique et notent à propos du Congrès de La Haye de 1872 : « les Blanquistes que représente Edouard Vaillant». Or il s’agit d’une pure et simple erreur historique. Elle est dénoncée par Charles Longuet lui-même, fidèle Proudhonien en même temps que gendre et admirateur raisonné de Marx. « Il y a, écrit très courtoisement, mais très fermement Longuet (dans les notes de sa traduction), dans la forte introduction de Engels, quelques inexactitudes de fait qu’explique la date où elle fut écrite (1891) et l’éloignement de ceux qui pouvaient le mieux les lui signaler ». Aussi, après avoir démontré l’inexactitude de l’affirmation « d’une majorité de Blanquistes » dans la Commune et levé la restriction de la tendance proudhonienne à la seule minorité, il donne une précision et un témoignage capital au sujet de son « excellent et vieil ami Édouard Vaillant» 59. Et il semble très vraisemblable que ce soit Vaillant lui-même qui ait tenu à ce qu’il fournisse alors ces précisions. « Il me faut définir la position de Vaillant à qui Engels attribue le mérite d’avoir amené à une plus grande précision théorique un petit nombre de Blanquistes grâce à sa connaissance du socialisme scientifique allemand.
« Ici, Engels anticipe. Ce n’est ni avant ni pendant la Commune que Vaillant pouvait exercer cette influence théorique sur certains Blanquistes, mais après la Commune. Quant au résultat de cet enseignement, ce n’est pas moi qui ai qualité pour en juger, mais Vaillant lui-même. Ce dont je suis certain c’est qu’en 1871, Vaillant n’avait pas encore la connaissance approfondie de la doctrine marxiste que suppose la phrase citée. Peu de temps auparavant Vaillant était encore Proudhonien très révolutionnairement assurément, comme plusieurs de la même école. » (Et Longuet cite, dans le même passage, Vermorel, Avrial et Theisz comme des Proudhoniens très révolutionnaires.) « Et, ajoute-t-il, un esprit de cette valeur ne change pas de doctrine comme on change de linge » 60. Sans doute, remarque Longuet, dans la première année de son exil à Londres, « il fut profondément influencé par la lecture du Capital et par ses relations personnelles avec Marx. Comme Lafargue – envoyé par Marx à la Commune de Paris, puis à Bordeaux pour tenter en vain d’y déclarer une Commune bordelaise, et qui désespérait son beau-père qu’il admirait par son Proudhonisme impénitent – il garda sa conviction proudhonienne, comme sa carrière politique post-communale et son Jauressisme final en témoignent.
Cambon, l’une des personnalités de tout premier plan de la majorité, était un Proudhonien avoué comme le rappelle si justement Hubert Bourgin. Vieux lutteur de 1848, ayant passé presque dix années dans les prisons de l’Empire, il était devenu célèbre et très populaire par l’histoire de la vache à Cambon 61. Républicain socialisant imbu d’autorité, il se convertit au Proudhonisme vers les années 1859-1860. « Alors, écrit Hubert Bourgin, il est le disciple de Proudhon et son lieutenant politique dans la Nièvre où il fit, à partir de 1863, une active propagande en faveur de ses idées » (ouvrage cité, p. 81 ), insistant plus toutefois sur le fédéralisme politique de Proudhon que sur sa doctrine économique. Il sera, comme Delescluze et Vaillant, de ces éléments-charnières qui feront tout pour éviter l’éclatement de la Commune.
Delescluze, nous l’avons dit, doit être placé parmi les Proudhonisants. Que ces deux hommes ardents, Delescluze et Proudhon, se soient opposés violemment (le véhément Delescluze avait reçu le surnom de barre de fer), le fait est connu 62. On sait que Delescluze, alors rédacteur en chef de La Révolution Démocratique et Sociale, ne lui pardonna pas d’avoir préféré la candidature de Raspail à celle de Ledru-Rollin à la Présidence de la République. Il l’attaqua avec une grande violence et Proudhon rétorqua de même. Delescluze alla jusqu’à lui envoyer ses témoins, mais Proudhon refusa de se battre avec un homme qu’il estimait profondément.
Mais les deux hommes étaient d’une probité, d’une loyauté et d’un républicanisme à toute épreuve. Sur le tard, ils apprirent à s’estimer d’amitié et de pensée. Et le vieux jacobin indomptable, qui avait ressenti par ses dix-neuf années de prison les abus et les dangers d’un État autoritaire et centralisé, s’ouvrit aux idées sociales et au fédéralisme. Sans quitter cet autoritarisme, et ce goût du pouvoir qui le caractérisait, il admit les grandes lignes politiques et économiques du Proudhonisme. Aussi Gurvitch a-t-il pu écrire que « la déclaration du Peuple français lue le 19 avril à l’Hôtel de Ville et approuvée à l’unanimité par la Commune était rédigée par deux Proudhoniens notoires, P. Denis et Delescluze » (ouvrage cité, p. 137).
Arnould et Longuet, tous deux minoritaires, ont souligné l’influence primordiale et la position exceptionnelle de Delescluze et de Cambon dans la majorité. « Sans doute ces hommes de 48 apportaient avec eux des habitudes d’esprit et une conception de la république qui ne pouvaient pas cadrer avec celles beaucoup plus novatrices » de jeunes Proudhoniens de la minorité qui étaient ennemis de tout héritage jacobin. « Mais Delescluze… s’il ne partageait pas toutes les vues de la Commune » dans son aile marchante, « néanmoins comprit profondément le nouveau programme, en saisit la portée ». Avec Vallès et Denis, il contribua à en rédiger la partie politique. « Aussi jamais de sa bouche ne sortit une parole amère, une parole d’accusation contre la minorité. » (Or, sa véhémence était proverbiale.) « Cambon, ajoute Arnould, doit être également placé dans cette catégorie. Lui aussi s’occupait peu des divisions qui vers la fin parurent séparer la Commune en deux camps. Uniquement préoccupé du triomphe de la révolution, il y consacra toutes ses forces avec un dévouement, un courage, une abnégation qu’on ne saurait trop citer … Jamais il n’attaqua la minorité, jamais il ne montra contre elle d’irritation ni de passion. » Comme Delescluze, il rappela sans cesse « que l’ennemi était à Versailles» (ouvrage cité, tome II, pp. 85-86).
Lefrançais complète ce portrait en insistant sur l’importance de leurs prestiges personnels parmi les
Communards. « Le citoyen Delescluze en était sinon le chef (de la majorité) du moins le plus considéré, à cause de sa probité politique devenue primordiale et de son long dévouement à la république. Après lui venait le citoyen Cambon, loyal et dévoué, et pour cela estimé de tous » (Études sur le Mouvement Communaliste, ch. III, p. 191).
Vaillant, Cambon, Delescluze, trois personnalités primordiales de la majorité de la Commune, sont donc Proudhoniens ou Proudhonisants. Ils joueront un rôle essentiel dans l’adoption du programme politique social économique et éducatif de la Commune, identifié trop facilement à celui de la seule majorité. Mais ils ne furent pas les seuls majoritaires influencés par la doctrine proudhonienne. Il faut y ajouter Dereure, l’internationaliste grand ami de Varlin, dont le collectivisme économique s’inspirait des idées du grand Bisontin. D’autres internationalistes de la majorité tels Eugène Pottier, le célèbre auteur de l’Internationale (dédiée au Proudhonien Lefrançais, son grand ami), avait en fait, sur le plan économique et politique, des idées très proches de celles du grand Proudhonien de la majorité. De même J-B. Clément, grand ami de Vallès et, comme Pottier, « poète populaire … animé de l’esprit socialiste et du souffle de la révolution prolétarienne » (Longuet) reste dans la mouvance générale de l’idéologie proudhonienne. Aussi son comportement traduit-il ses tiraillements entre minorité et majorité tactique. Il hésite dans ses votes entre majorité et minorité, comme le remarquent Bruhat, Dautry et Tersen. A ce groupe des Proudhoniens de la majorité il conviendrait sans doute d’ajouter un certain nombre des autres internationalistes collectivistes qui sont catalogués dans la majorité, tels Assi, Victor Dernay et Chalain.
De cette analyse des Proudhoniens de la minorité et de la majorité résulte l’importance du groupe proudhonien de la Commune. Il ne se cantonne pas dans la minorité qu’il domine, puisque des fortes têtes de pont proudhoniennes existent au sein même de la majorité. Celles-ci font apparaître le caractère non-monolithique du bloc majorité–minorité puisque la majorité tactique (adhésion au Comité de Salut Public) ne coïncide pas avec la majorité idéologique (adhésion à l’idéologie proudhonienne) – et ceci d’autant plus qu’il existe au sein de l’Assemblée de la Commune une frange de fluctuants ou de neutres.
Sur ce dernier point, Longuet fait remarquer que « Vaillant comme Tridon ne manquèrent pas de juger sévèrement les faiblesses et les fautes de la majorité … L’irritation de Tridon … contre ses propres amis fit qu’il se rangea dans la minorité dont il signa le Manifeste tandis que Vaillant au contraire, blâma cette minorité d’avoir dévoilé le dissentiment qui bien avant la création du Comité de Salut Public existait au sein de l’Assemblée de la Commune. En fait, souligne Longuet, Vaillant, comme il le fit entendre dans le débat qui suivit la déclaration, n’appartint ni à la majorité ni à la minorité de la Commune » (ouvrage cité, p. 119).
Nous avons vu le cas de J.-B. Clément, mais il ne faudrait pas non plus oublier que, dans les premiers temps de la Commune, Vallès et Vermorel se placèrent dans la majorité « qu’ils quittèrent rapidement » 63. Il est à signaler également que Franckel et Arnold votèrent pour le Comité de Salut Public le Ier mai et cependant approuvèrent le 16 mai, par leur vote, la déclaration de la minorité. De même Longuet s’abstint lors du vote sur le Comité de Salut Public, mais adhéra par contre à la Déclaration de la minorité, tandis qu’à l’inverse Babick et Rastoul qui s’abstinrent le 1er mai ne souscrivirent pas à la déclaration du 16.
Au terme de ces analyses un groupe proudhonien d’une trentaine de personnes, en comptant les sympathisants, apparaît au-delà des divisions mêmes de l’Assemblée Communarde comme le noyau de son unité. Sans doute ne s’agit-il pas d’un parti mais bien d’un groupe avec toutes ses nuances, allant du Mutuellisme révolutionnaire au communisme libertaire en passant par un collectivisme libéral. Néanmoins, comme le souligne Longuet, en indiquant l’éventail des tendances proudhoniennes « en dépit de la différence plus apparente que réelle » des théories « interprétant la doctrine de leur maître commun », ils agirent toujours de concert. Et « Franckel et Serrailler, purs Marxistes et leurs camarades collectivistes adoptèrent leur programme politique et économique».
Dès lors le « Proudhonisme » qui fut, à l’aube même de la Commune, le nom donné au programme présenté pour les élections (cf. Tome XII de l’Histoire Socialiste, p. 148) devint une plate-forme politique dominante et permit de constituer autour un noyau d’une trentaine de Proudhoniens, militants ou sympathisants, une majorité idéologique qui, dans le grand moment du vote du 19 avril de la Déclaration du Peuple Français, se mua même en unanimité.
Ainsi Proudhon imprima « à son époque une morsure si profonde» 64, l’emprise de sa doctrine fut si forte que, non seulement il devint un ciment et un ciment durable entre tous les éléments socialistes de la Commune (Serrailler, comme Franckel purs Marxistes en restèrent imprégnés), mais que Marx lui-même devant l’emprise du Proudhonisme Communard décida, en stratège génial, de la récupérer en l’intégrant dans son propre fonds doctrinal. Ainsi, le mouvement socialiste français et international en recueillera t-il l’héritage ouvertement par sa descendance profondément proudhonienne ou implicitement par son inclusion au marxisme.
Cet héritage proudhonien, ce programme dont s’inspira par la suite tout socialisme démocratique, les
actions et les textes des Proudhoniens de la Commune vont nous en donner l’inventaire.
(a suivre)
Jean BANCAL, « Proudhon et la Commune », Autogestion et socialisme, N°15, Anthropos, Paris, Mars 1971, P.37-81.
Notes:
- La proclamation de la Commune, Gallimard, 1965. ↩
- Lepelletier, Histoire de la Commune de 187l, Mercure de France, 1912. Lefrançais, Étude sur le mouvement communaliste, Neuchâtel, 1871. Charles Longuet, La Commune de Paris – Karl Marx (traduction, préface et notes de Charles Longuet) Librairie Jacques, Paris, 1901. Albert Ollivier, La Commune, Gallimard, 1939. Henri Lefebvre, op. cit .. ↩
- Cf. nos ouvrages, Proudhon (Œuvres choisies et présentées), coll. Idées, Gallimard, et Proudhon : pluralisme et autogestion, Aubier, (2 tomes). ↩
- Dautry et Scheler, Le Comité central républicain, Ed. Sociales, p. 256. ↩
- Op. cit., pp. 154, 168. Cf. chap. VI sur la diffusion de « l’idéologie proudhonienne ». ↩
- Ibid. ↩
- Ibid. p. 154. ↩
- LaCommune … , Ed. Sociales. ↩
- Op. cit., p. 28. ↩
- Ibid., p. 119. ↩
- Ibid., p. 147. ↩
- Ibid., p. 59. ↩
- Ibid., p. 64. ↩
- Ibid., p. 285. ↩
- Lefebvre, op. cit., p. 57. ↩
- Auteur du célèbre livre, Histoire de la Commune de 1871, rééd, Maspero, 1ère édition 1876. ↩
- l’insurgé, (rééd.), Les Éditeurs Français Réunis, 1950. ↩
- Op. cit., tome 3, pp. 33-34. ↩
- Op. cit ; pp. 44-45. ↩
- Op. cit., pp. 31-32. ↩
- Proudhon, par Hubert Bourgin, p. 76. ↩
- Ibid., p. 82. ↩
- Proudhon et Marx – une confrontation, Centre de Docum. Univ., 1964, pp. 134-235-136. ↩
- Ibid. p. 136. ↩
- Karl Marx, Œuvres, t. Il, La Pléiade, Introd. pp. LIX et LXXX. ↩
- Ibid. ↩
- Capacité Politique, livre Il, Ch. XIII. Proudhon critique « cette timidité réformiste qui se fait une sorte de sagesse de suivre pas à pas la pratique bourgeoise et ferait consister volontiers leur mutuellisme en ce que la classe ouvrière aurait ses banquiers pendant que les entrepreneurs et les boutiquiers auraient les leurs ». ↩
- Op. cit., p. 46. ↩
- Op. cit., p. 100. ↩
- Cf. pp. 265-266, 280, 286, 292, 294. ↩
- Proudhon et l’Europe, Domat-Montchrestien, 1945, pp.139 à 141. ↩
- Histoire Socialiste, tome X, p. 287 · ↩
- n connaît la boutade de Proudhon: « On me dit qu’il y a je ne sais où des gens qui se disent Proudhoniens, ce doit être des imbéciles ». ↩
- Histoire Socialiste, tome X, p. 355 .. ↩
- Op. cit., p. 121. ↩
- Reprenant la mise au point de Longuet : « les Blanquistes étaient loin de dominer le Comité central» (p.115, op. cit.). Les historiens Marxistes Bruhat, Dautry , Tersen ont reconnu en fait que le comité central à l’aube de la Commune était dominé par une majorité de Proudhoniens avec un noyau actif de Blanquistes dont l’influence grandira après l’élection de l’Assemblée de la Commune. ↩
- En fait, si l’on effectue un recensement précis on compte 7 blanquistes purs : Ferré, Rigault, Eudes, Miot, Ranvier, Chardon, un ancien blanquiste, Protot, 1blanquiste très hétérodoxe, Tridon, puisque proudhonisant et minoritaire – Vaillant, on le verra, est catalogué blanquiste par erreur et Gournet ne deviendra blanquiste qu’à Londres. ↩
- Il fait mention également d’un sous-groupe de la majorité dit « fraction Gambettiste », composé de Ranc et d’Ulysse Parent. ↩
- Il est à souligner les très importantes erreurs courantes qui sont commises sur le nombre d’internationaux siégeant à la Commune. l’Histoire Socialiste tome XI, pp. 307-311 en décompte 17 ; Lissagaray, 13 (op. cit., p. 172) Gurvitch, (op. cit., p. 137) 15, Lefebvre, 16 (op. Cit., p. 361) Ollivier, 14 (op. cit., p. 250). Seuls Bruhat, Dautry et Tersen l’évaluent à « la trentaine» (p. 219), dont deux tiers de Proudhoniens. ↩
- J. Stebklov, dans Les grands de la Commune de Paris, Internationale Communiste, 2ème année, a écrit avec quelque peu de légèreté : « il a été jusqu’ici presque impossible d’établir à quelle tendance proprement dite appartenait Varlin, le plus en vue des vedettes ouvrières de cette époque». ↩
- Maurice Foulon, dans son livre, cite une abondance d’articles et de lettres de Varlin qui reprennent textuellement des expressions et des thèmes Proudhoniens. ↩
- « Pour ma part je donnerai les axiomes, je fournirai les exemples et les méthodes, je mettrai la chose en train. C’est à tout le monde de faire le reste … Personne sur terre n’est capable … de donner un système composé de toutes pièces … c’est le plus damné mensonge. La science sociale est infinie … mais nous pouvons en donner les principes puis les éléments, puis une part qui ira toujours grandissant ». (Lettre à Gauthier 2 mai 1841.) « Accepter pour amis, coreligionnaires et socialistes tous ceux qui se donnent à vous comme tels et sans leur faire subir d’examen …d’orthodoxie. Et ne vous occupez, ainsi que moi, qu’à bien définir, bien poser les cinq à six grandes questions qui forment la charpente du système». (Lettre à Langlois, 14 janvier 1862). ↩
- Notons l’ambiguïté que révèle l’expression de Malon. A la veille de la Commune il y avait les Collectivistes autoritaires dits conservateurs et les collectivités libéraux, la plupart Proudhoniens. C’est pour cette raison qu’un Pindy, tout en adhérant au collectivisme libéral, refusait J’étiquette collectiviste. ↩
- Dautry, Bruhat et Tersen, op. cit., p. 145. ↩
- Bruhat, Dautry et Tersen, p. 133. ↩
- CT. Procès, Mémoires et Correspondance de Roussel, pp. 268-269, Ed. Julliard. ↩
- La Commune de Paris 1871, éd. Cujas, p. 187. ↩
- Etude sur le mouvement communaliste 1871, La Commune et la Révolution. ↩
- Ibid., pp. 31-32. ↩
- Bruhat, Dautry et Tersen, op. cit. ↩
- Auguste Vermorel, par Jean Verrnorel, p. 37. ↩
- Histoire du mouvement social en France 1852-1901, Georges Weill. ↩
- Jean Laroque, 1871 – Souvenirs révolutionnaires, Paris, 1888. ↩
- Le cri du peuple, 24 février 1871. ↩
- Op. cit., p. 100. ↩
- Hubert Bourgin, op. cit., p. 81. Cf. également Vallès, L’insurgé, p. 89. ↩
- Ed. Coopérative de l’École émancipée, Marseille, p. 122. ↩
- Librairie Jacques, 1901, p. XLV. ↩
- Préface de La commune de Paris, p. IX. ↩
- Ibid., pp.118-119. ↩
- Avocat devenu fermier, obéissant au mot d’ordre du journal internationaliste La Marseillaise, il refuse de payer l’impôt par opposition politique. Le fisc saisit sa vache qui est rachetée grâce à une souscription nationale due à l’initiative de Rochefort. ↩
- On connaît aussi la lettre-libelle que Proudhon, du fond de sa prison de la Conciergerie, envoya Je 20 janvier 1850 aux « citoyens Ledru Rollin, Charles Delescluze, Martin et consorts, rédacteurs du Proscrit,Londres. Ce journal avait accusé Proudhon d’avoir desservi la cause républicaine en présentant l’image d’une république rouge qui aurait fait peur et aurait facilité l’ascension de Louis-Bonaparte. Et Proudhon ne craignait pas de rétorquer à ces républicains non-socialistes : « les idées socialistes vous pèsent, l’influence qu’elles exercent vous irrite, vous accusez de vos mécomptes les sectaires qui ont jeté la révolution hors des voies en l’exagérant … Dès que vous n’êtes plus socialistes, la contre révolution vous réclame… revenez au bercail de la politique modérée … mais qu’avez-vous besoin en signant votre prononciamento antisocialiste de prendre comme bouc émissaire le citoyen Proudhon ». ↩
- Bruhat, Dautry et Tersen, p. 136. ↩
- Ollivier, op. cit., p. 58. ↩