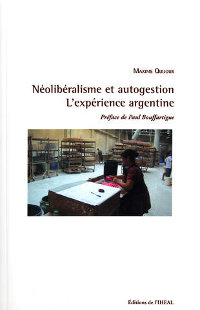Dans le récent film En guerre de Stéphane Brizé qui mettait en scène la fermeture d’une usine d’Agen décidée par une multinationale, le PDG de celle-ci justifiait le licenciement des 1100 personnes au nom de la totalité des salarié.e.s du groupe : « Ce n’est pas seulement question de centaines de salariés, il est question de 140 000 salariés du groupe Dimke dans le monde […] Refuser de voir la réalité de ce marché, revient en réalité à vouloir un autre monde, vivre dans un autre monde. Et bien, vous ne m’en voudrez pas, mais moi pour ma part, je vis dans le monde qui nous entoure, dans notre monde. Je vis, j’applique les règles de ce monde. » Face au désespoir de ces salarié.e.s, largement représentatif de la réalité contemporaine du monde du travail, il est justement urgent de préparer cet « autre monde » qu’évoque le PDG de cette fiction furieusement réaliste.
Au cœur de la problématique : l’investissement
L’investissement, c’est se priver momentanément de consommation pour acheter divers moyens de production ou réaliser de la recherche et développement. Cet investissement est incontournable dans nos sociétés modernes. Toute la question est de savoir qui le pratique.
Dans l’entreprise actuelle, deux types de personnages cohabitent : les salarié.e.s et les actionnaires. Les salarié.e.s travaillent dans l’entreprise et reçoivent un salaire en contrepartie de leur travail : ils peuvent le dépenser en totalité et ne participent donc pas à l’investissement de l’entreprise. Les actionnaires ont initialement investi dans l’entreprise (à la création ou lors d’une augmentation de capital) et ont reçu en échange un titre financier – l’action – qu’ils peuvent vendre à leur guise en réalisant une plus- ou moins-value. Ce qui fait la valeur de ce titre sont les espérances de dividendes qu’il peut laisser espérer 1 : en effet, le dividende est la seule rémunération de l’actionnaire et une entreprise qui ne verserait jamais aucun dividende n’a donc aucune valeur.
Dividendes et salaires sont rivaux : ce sont des flux de trésorerie qui sortent de l’entreprise et qui sont générés par le travail réalisé. On pourrait, à juste titre, estimer que les dividendes ne devraient pas exister et que leur montant devrait être intégralement versé en salaires aux travailleur.se.s de l’entreprise. À l’opposé, l’actionnaire estime qu’il a mis de l’argent dans l’entreprise et ne veut pas réaliser de perte sur cet investissement, ce qui est une position tout aussi légitime. À cet effet, il exige le versement de dividendes qui sont la preuve immédiate que l’entreprise en versera à l’avenir. Le problème de fond est qu’une fois un dividende versé, il détermine une valorisation et toute baisse ultérieure sera un signal négatif qui baissera immédiatement la valeur de l’action, ce qui fait dire à Laurent Amadéo (le délégué CGT d’En guerre interprété par Vincent Lindon) : « Ça n’est jamais assez, on ne leur fait jamais gagner assez d’argent. »
La valeur ajoutée est la valeur produite par l’entreprise sur une période de temps donnée : elle se partage entre salaires et bénéfices. Les actionnaires élisent la direction de l’entreprise qui dirige celle-ci dans le sens de leurs intérêts. Cette direction prend les décisions d’embauches et de licenciements et contrôlent donc le niveau des salaires de façon à pouvoir dégager un bénéfice. En assemblée générale, les actionnaires décideront la fraction du bénéfice qu’ils distribueront sous forme de dividendes et conserveront l’autre partie sous forme de réserves qui leur appartiennent pleinement et leur permettent de continuer à contrôler l’investissement et l’emploi.
Pour une politique de hausse de la part des salaires dans la valeur ajoutée
On comprend donc que vouloir toujours satisfaire les desiderata du patronat, en espérant obtenir en retour de l’investissement et de l’emploi, est une voie sans issue. On mesure aussi combien la formation des profits des entreprises est quelque chose de totalement artificiel, dépendant de la politique des gouvernements en place : ceux-ci n’ont eu de cesse de pratiquer une politique de baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée par différentes mesures telles que les baisses de cotisations, le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), les deux lois travail successives… De ce point de vue, c’est la politique exactement opposée qu’il faut mettre en place : une politique de hausse de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Il y a cependant un problème de taille : les bénéfices comportent, comme on l’a vu précédemment, une mise en réserve qui sert à l’investissement. Si la hausse des salaires dans la valeur ajoutée est telle qu’elle annule les bénéfices, comment se réaliseront alors les investissements ?
La première réponse à cette question est l’expropriation des actionnaires. Une telle politique aura fait perdre de la valeur aux entreprises et diminuer l’intérêt pour les actionnaires de poursuivre l’investissement. Il faudra donc transformer les entreprises en donnant le pouvoir aux salarié.e.s. La coopérative de travail (Scop) peut très bien faire l’affaire car la gestion du capital ne suit plus les règles financières de l’entreprise détenue par des actionnaires extérieurs. Si les Scop sont loin de sous-investir par rapport aux autres entreprises, il n’en reste pas moins vrai que les salarié.e.s des Scop préféreraient souvent moins investir et bénéficier de meilleures rémunérations s’ils avaient à leur disposition des financements raisonnablement fiables et à bon marché.
Orienter démocratiquement l’utilisation des investissements
La seconde réponse, liée à la première, consiste à constituer un Fonds socialisé d’investissements (FSI) qui fournira des lignes de crédit aux banques pour financer les entreprises. Son mode de constitution peut très bien être une cotisation à la charge des entreprises assise sur les salaires bruts : nous nous inscrivons ainsi dans la même logique de hausse de la part des salaires dans la valeur ajoutée à ceci près qu’une partie des prélèvements n’est plus destinée à être dépensée mais à investie. Ce FSI pourra alors fournir des lignes de crédit à moyen et long terme pour les banques – probablement, elles aussi, reprises par leurs salarié.e.s et usager.e.s – qui permettront à celles-ci de ne plus avoir à se refinancer sur les marchés financiers et donc de s’en passer.
Autre élément de rupture par rapport au système capitaliste : alors que l’investissement n’est aujourd’hui réalisé qu’en fonction de sa rentabilité – et non de son intérêt social et écologique – il deviendra désormais possible de flécher les investissements en fonction de leurs utilisations par l’établissement d’enveloppes budgétaires. Celles-ci peuvent correspondre à des finalités (transition énergétique, mobilité, outil industriel…), des modalités de crédit (crédit simple remboursé sur plusieurs années, ligne de crédit pour financer un Besoin en fonds de roulement, apports pour financer de la recherche et développement) ou encore une politique volontariste d’investissements dans certains territoires défavorisés. Ces budgets doivent faire l’objet de délibérations politiques dans l’ensemble de la population, réalisant ainsi une orientation de l’économie en fonction des besoins exprimés par toutes et tous et non en fonction de la rentabilité des investissements.
Pour en savoir plus sur la proposition de Fonds socialisé d’investissements :
Benoît Borrits
Au-delà de la propriété, pour une économie des communs
Chapitre 7 : Socialisation de l’investissement
La Découverte – Collection L’horizon des possibles
250 pages – 19 euros
Notes:
- En termes financiers, la valeur de l’action est donnée par la somme de la valeur actualisée des dividendes futurs. Pour cela, on établit un scénario de dividendes à venir. Pour chacun de ces dividendes, on donne une valeur « actualisée », c’est-à-dire dépréciée par le taux d’intérêt et une prime de risque déterminée par le marché. Plus le dividende est éloigné dans le temps, plus celui-ci est déprécié. ↩